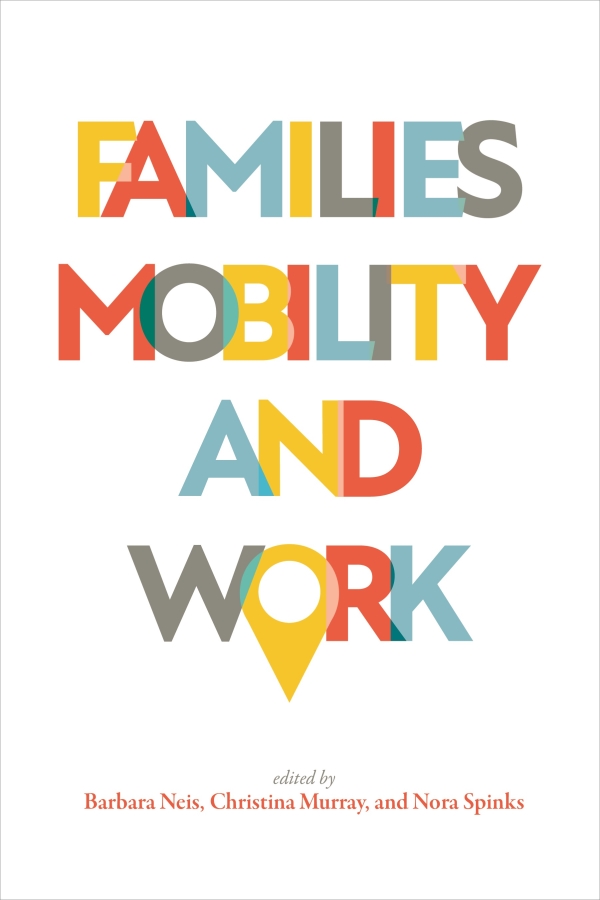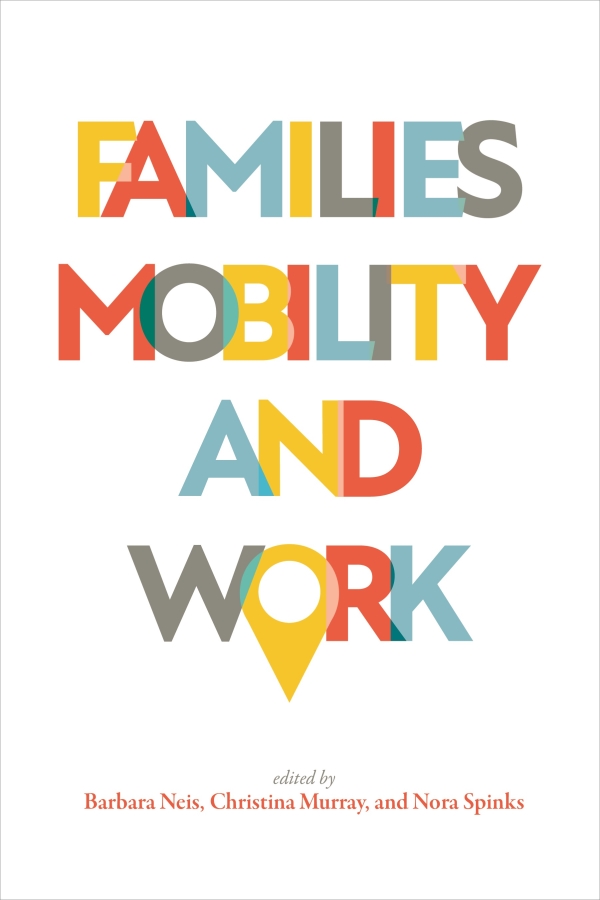Rachel Margolis, Ph. D.
Téléchargez cet article en format PDF.
Au Canada, quelque 7,1 millions de grands-parents et d’arrière-grands-parents procurent un apport unique, diversifié et précieux aux familles et à la société, entre autres par leur mentorat, leur rôle d’éducateurs et leur savoir-faire, ou en tant que dépositaires de la mémoire familiale. À l’instar de la population canadienne, le groupe démographique des grands-parents connaît un vieillissement rapide qui suscite certaines préoccupations dans les médias et l’opinion publique quant à l’impact éventuel de ce « tsunami gris ».
Toutefois, même s’il gagne en âge, le groupe des grands-parents serait en meilleure santé qu’il y a 30 ans si l’on se fie aux statistiques dans ce domaine. Il s’agit là d’une tendance éventuellement favorable aux familles, puisque la bonne santé des grands-parents leur permet de mieux contribuer à la vie de famille et d’aider les plus jeunes générations à assumer diverses responsabilités familiales, comme les soins aux enfants et le budget du ménage.
L’amélioration de la santé des grands-parents leur permet de mieux contribuer à la vie de famille et d’aider les plus jeunes générations à assumer leur diverses responsabilités familiales.
Le Canada vieillit, et les grands-parents aussi…
Le vieillissement du groupe démographique des grands-parents fait écho à celui de l’ensemble de la population canadienne. Selon les plus récentes données du Recensement de 2016, les aînés occupent désormais 16,9 % du poids démographique au pays, soit presque deux fois plus qu’en 1981 (9,6 %). Il s’agit de la proportion la plus élevée jamais enregistrée jusqu’ici, et cette croissance devrait se poursuivre au cours des prochaines décennies : si la tendance se maintient, les Canadiens de 65 ans ou plus représenteront près du quart de la population (23 %) d’ici 2031. En outre, la tranche des Canadiens les plus âgés (100 ans ou plus) connaît actuellement la croissance la plus rapide : on comptait 8 200 centenaires en 2016 (soit 41 % de plus qu’en 2011), et ils seront vraisemblablement 40 000 d’ici 2051.
Dans un tel contexte, le vieillissement global du groupe démographique des grands-parents n’est pas une surprise. Ainsi, alors que 41 % des grands-parents avaient 65 ans ou plus en 1985, cette proportion était passée à 53 % en 2011. La représentation des grands-parents âgés de 80 ans ou plus a connu une croissance encore plus marquée, passant pratiquement du simple au double pour atteindre 13,5 % en 2011 (contre 6,8 % en 1985).

Des grands-parents plus âgés compte tenu de l’espérance de vie
L’augmentation de l’espérance de vie figure parmi les facteurs qui sous-tendent le vieillissement du groupe démographique des grands-parents. Statistique Canada estime que l’espérance de vie à la naissance suit une courbe ascendante constante, qui atteignait 83,8 ans chez les femmes et 79,6 ans chez les hommes pour la période de 2011 à 2013. Il s’agit d’un gain d’environ une décennie de vie en à peine un demi-siècle : les hommes et les femmes vivent respectivement 9,5 années et 11,2 années de plus qu’en 1960-1962.
Par ailleurs, puisque le taux de mortalité recule chez les personnes de moins de 65 ans, le nombre de Canadiens à passer ce cap s’accroît. Selon les données colligées par Statistique Canada, 86 % des filles nées entre 1980 et 1982 pouvaient espérer franchir le cap des 65 ans, mais 92 % de celles nées entre 2011 et 2013 pouvaient en espérer autant. Chez les garçons nés durant les mêmes intervalles, la proportion est passée de 75 % à 87 %.
Du reste, les gens vivent aussi plus longtemps au sein du groupe des aînés, comme en fait foi l’augmentation constante de l’espérance de vie à l’âge de 65 ans. (Cette mesure s’avère particulièrement utile pour évaluer le bien-être des populations plus âgées puisqu’elle ne tient pas compte du taux de mortalité des personnes qui n’atteignent pas 65 ans.) Selon les estimations de Statistique Canada pour la période de 2011 à 2013, l’espérance de vie à l’âge de 65 ans se situait à 21,9 années pour les femmes et à 19 années pour les hommes, soit respectivement 3 années et 4,4 années de plus qu’en 1980-1982.
Les femmes deviennent mères plus tardivement qu’auparavant, ce qui se répercute sur l’âge auquel on devient grands-parents. Par conséquent, le groupe démographique des grands-parents augmente en âge.
Parmi les facteurs responsables du vieillissement du groupe démographique des grands-parents, il faut aussi tenir compte du fait que, en règle générale, les femmes deviennent mères plus tardivement qu’auparavant, et cette tendance de la fécondité fait augmenter l’âge auquel on devient grands-parents. Depuis 1970, l’âge moyen des mères à la naissance d’un premier enfant a suivi une ascension soutenue, passant de 23,7 ans pour atteindre 28,8 ans en 2013. De même, le nombre de mères âgées de 40 ans ou plus à la naissance d’un premier enfant est en hausse : on en comptait 3 648 en 2013, comparativement à 1 172 en 1993 (+210 %). Par conséquent, si les femmes sont de plus en plus nombreuses à retarder l’âge de la procréation, elles repoussent vraisemblablement l’âge de la grand-parentalité. De nos jours, les nouveaux grands-parents sont des baby-boomers, cette génération qui a différé l’âge de la procréation des femmes pour leur permettre de se consacrer à leurs études et d’acquérir de l’expérience professionnelle. Dans le sillage de celles-ci, la génération suivante tend aussi à avoir des enfants tardivement. L’effet cumulatif de ces deux générations influence certainement la tendance à la hausse de l’âge d’accession au statut de grands-parents.
Cependant, même si le groupe démographique des grands-parents se fait vieillissant, la grand-parentalité occupe une portion de l’existence plus longue qu’auparavant. De fait, si les grands-parents accèdent à ce statut plus tard, ils vivent aussi plus longtemps pour en profiter. Cet allongement favorise les occasions de nouer, d’entretenir et de consolider des relations avec les plus jeunes générations. D’après les conclusions de mes récents travaux, compte tenu du portrait démographique actuel au Canada, les femmes pourraient être grands-parents pendant 24,3 ans en moyenne au cours de leur vie, et les hommes durant 18,9 ans. Bref, ils auront plus ou moins deux décennies pour assumer ce rôle important pour la vie de famille.
Des grands-parents plus âgés, mais en meilleure santé
Selon les données de l’Enquête sociale générale (ESG), non seulement les grands-parents canadiens vivent-ils plus longtemps, mais ils sont également susceptibles de vivre en meilleure santé qu’auparavant. Alors que 70 % d’entre eux qualifiaient leur santé de « bonne, très bonne ou excellente » en 1985, cette proportion atteignait 77 % en 2011. Corollairement, la proportion de grands-parents estimant leur état de santé « passable ou mauvais » avait reculé de 31 % à 23 % dans le même intervalle. Dans l’ensemble, les grands-parents étaient 44 % plus susceptibles de s’estimer en bonne santé en 2011 qu’en 1985.
Durant le dernier demi-siècle, diverses tendances ont favorisé la santé des grands-parents et de l’ensemble des aînés au Canada. D’une part, d’importants progrès en santé publique ont amélioré la prévention, le dépistage et le traitement des maladies. Combinés à d’autres éléments, ces progrès ont contribué à réduire considérablement les décès causés par les maladies du système circulatoire (ex. : cardiopathies), soit l’un des principaux facteurs ayant permis d’allonger l’espérance de vie chez les hommes depuis 50 ans.
D’autre part, l’amélioration de l’état de santé des grands-parents au Canada est aussi attribuable à l’augmentation du niveau de scolarité au sein de ce groupe démographique. En effet, des études ont montré que l’éducation peut avoir des incidences favorables directes et indirectes pour la santé au cours de la vie. Parmi les retombées directes, on compte notamment l’amélioration de la littératie ou des connaissances en matière de santé, des rapports entre les patients et le système de santé, ainsi que de la capacité et de la volonté de ces derniers de faire valoir leur point de vue auprès des fournisseurs de soins de santé. Quant aux retombées indirectes, elles concernent notamment la diversification des ressources disponibles (notamment les revenus) et des possibilités d’emploi (travail à plus faible risque ou moins exigeant physiquement, emploi assorti d’indemnités en cas de maladie, etc.).
Il existe un lien entre le niveau d’éducation et l’état de santé : il s’agit là d’un facteur important puisque la proportion des grands-parents ayant fait des études postsecondaires a plus que triplé en trois décennies.
Il s’agit là d’importants facteurs à prendre en compte en contexte canadien, puisque la proportion de grands-parents ayant un diplôme d’études postsecondaires a plus que triplé au pays depuis trois décennies, passant de 13 % en 1985 à près de 40 % en 2011.
La santé des grands-parents au bénéfice de la famille
L’état de santé des grands-parents peut avoir des répercussions importantes pour les familles. De fait, lorsque la santé de l’un ou de plusieurs grands-parents se dégrade, les membres de la famille sont souvent les premiers à fournir et à structurer les soins pour contribuer à leur bien-être, et à en payer la facture. Cet état de fait n’est pas à négliger dans le portrait des soins à domicile au pays, puisque les aidants familiaux assument de 70 % à 75 % des soins à domicile fournis à l’ensemble des aînés, selon le Conseil canadien de la santé.
D’après l’ESG de 2012, près des trois dixièmes des Canadiens (28 %) affirmaient avoir prodigué des soins à un membre de la famille durant l’année précédente, et le motif le plus souvent évoqué à cet égard concernait les problèmes liés au vieillissement (28 % des aidants). De tous les bénéficiaires de soins au Canada, 13 % étaient des grands-parents, et ces derniers représentaient aussi le principal groupe de bénéficiaires des jeunes aidants (de 15 à 29 ans). De fait, les quatre dixièmes d’entre eux affirmaient que leur principal bénéficiaire était un grand-parent.
Même si 95 % des aidants disent s’acquitter plutôt bien de leur charge de soins, des études ont montré que de telles responsabilités entraînent parfois des répercussions négatives selon les contextes, notamment pour le bien-être, l’avancement professionnel et le budget de la famille. Ces risques guettent particulièrement ceux qui occupent aussi un emploi rémunéré, ce qui implique les trois quarts des aidants et le tiers de tous les Canadiens en emploi.
Par contre, lorsque les grands-parents sont en bonne santé, ce sont les familles elles-mêmes qui peuvent en bénéficier, de diverses façons. Non seulement ces grands-parents nécessiteront-ils moins de soins, mais ils seront mieux à même de contribuer de manière constructive à la vie de famille, entre autres en s’occupant des enfants et en participant financièrement au budget familial.
Des grands-parents pour s’occuper des enfants des générations montantes
Bon nombre de grands-parents jouent un rôle de premier plan en s’occupant de leurs petits-enfants, épaulant ainsi les parents de la « génération intermédiaire » qui tentent de conjuguer soins aux enfants et responsabilités professionnelles. Au cours des dernières décennies, certaines tendances socioéconomiques et contextuelles convergentes ont accentué l’apport important de ces grands-parents soucieux de participer aux soins aux enfants pour le bien-être des familles.
Bon nombre de grands-parents jouent un rôle de premier plan en s’occupant de leurs petits-enfants, épaulant ainsi les parents de la « génération intermédiaire » qui tentent de conjuguer soins aux enfants et responsabilités professionnelles.
Au Canada, le nombre de couples à deux soutiens est en hausse depuis 40 ans. Alors que seulement 36 % des familles avec enfants comptaient sur deux soutiens en 1976, cette proportion a pratiquement doublé pour atteindre 6 % en 2014. Or, plus de la moitié de ces couples (51 %) sont des parents qui travaillent tous deux à plein temps. Dans un tel contexte, les services de garde non parentaux sont de plus en plus sollicités. Les données de l’ESG de 2011 en font foi : alors que presque la moitié (46 %) de tous les parents disaient avoir eu besoin de services de garde quelconques pour leurs enfants de 14 ans ou moins durant l’année précédente, cette proportion était plus marquée chez les couples de parents à deux soutiens ayant des enfants de 0 à 4 ans (71 %) ou de 5 à 14 ans (49 %).
Compte tenu de l’évolution de la structure et de la composition des familles au fil des générations, un nombre accru d’entre elles se tournent désormais vers les services de garde non parentaux. Par exemple, la proportion de familles monoparentales a fait un bond important depuis un demi-siècle : alors que celles-ci représentaient 8,4 % de toutes les familles en 1961, elles occupaient une portion de 16 % en 2016. Les données recueillies dans le cadre de l’ESG de 2011 montrent que près des six dixièmes (58 %) des parents seuls ayant des enfants de 4 ans ou moins recouraient à des services de garde non parentaux.
Dans certains cas, en l’absence de génération intermédiaire (c’est-à-dire les parents), ce sont les grands-parents qui assument l’entière responsabilité d’élever leurs petits-enfants. Cette situation touchait 12 % de tous les grands-parents vivant sous le même toit que leurs petits-enfants selon l’ESG de 2011, qui fait état de 51 000 familles caractérisées par « l’absence d’une génération » au Canada. Les familles sans génération intermédiaire sont plus fréquentes parmi certains groupes, notamment chez les Premières Nations (28 %), les Métis (28 %) ou les Inuits (18 %), comparativement à 11 % au sein de la population non autochtone.
Enfin, lorsqu’il s’avère impossible de dénicher une place en service de garde structuré et de qualité au sein de leur collectivité, plusieurs parents se tournent vers les grands-parents. En 2014, les centres de la petite enfance réglementés ne pouvaient accueillir plus du quart (24 %) des enfants de 5 ans ou moins au pays. Même s’il s’agit là d’une amélioration notable par rapport au taux de 12 % enregistré en 1992, il n’en demeure pas moins que plus des trois quarts des enfants de ce groupe d’âge n’ont pas accès à une place en garderie réglementée. La disponibilité (ou le manque) de places en garderie n’est pas négligeable : pour les familles formées d’un couple de parents, il s’agit d’un élément déterminant susceptible d’influencer la décision de participer ou non au marché du travail.
Par ailleurs, le coût des services de garde pourrait également inciter certains parents à faire appel aux grands-parents pour s’occuper des enfants, particulièrement pour les familles vivant dans les centres urbains. En 2015, une étude sur le coût des services de garde dans les villes canadiennes a été réalisée à partir de données administratives sur les frais de garde et au terme de divers sondages téléphoniques aléatoires auprès de garderies à domicile ou de centres de la petite enfance. On a constaté que les tarifs les plus élevés au Canada étaient concentrés à Toronto, où le coût médian des services de garde non subventionnés était évalué à 1 736 $ par mois pour la garde à plein temps d’un nourrisson (moins de 18 mois) et à 1 325 $ pour les tout-petits (d’1 an et demi à 3 ans).
L’engagement des grands-parents peut favoriser le bien-être des enfants
Peu importe les raisons qui motivent les grands-parents à consacrer du temps à leurs petits-enfants, il n’en demeure pas moins que leur engagement dans la vie de famille peut contribuer au bien-être de ces derniers. Des études ont permis de constater que l’implication des grands-parents dans la vie de famille exerce un ascendant marqué sur le bien-être des enfants, et pourrait notamment favoriser leur engagement scolaire et l’adoption d’un comportement social positif. D’ailleurs, cette situation n’est pas seulement bénéfique aux enfants puisque, comme l’ont révélé d’autres travaux de recherche, les relations étroites entre grands-parents et petits-enfants ont des retombées positives pour la santé mentale des uns et des autres. Au sein des familles des Premières Nations, les grands-parents jouent aussi un rôle important auprès des générations montantes quant aux aspects culturels associés à la santé et à la guérison.
Selon certaines études, l’implication des grands-parents dans la vie de famille exerce un ascendant marqué sur le bien-être des enfants, et pourrait notamment favoriser leur engagement scolaire et l’adoption d’un comportement social positif.
Dans l’ensemble, l’amélioration de la santé des grands-parents représente une bonne nouvelle pour de nombreuses familles. En effet, plus ceux-ci sont en santé, plus ils seront en mesure de participer à diverses activités avec leurs enfants et petits-enfants. À cet égard, des études ont montré que l’état de santé des grands-parents influence directement la qualité de leurs interactions avec les jeunes.
Un appui financier important de la part de nombreux grands-parents
En outre, les grands-parents en meilleure santé sont plus susceptibles d’occuper un emploi rémunéré pour consolider leur propre situation financière ainsi que leur capacité d’aider les plus jeunes générations à cet égard.
Les grands-parents en meilleure santé sont plus susceptibles d’occuper un emploi rémunéré pour consolider leur propre situation financière tout comme leur capacité d’aider les plus jeunes générations.
Il n’existe pas beaucoup de données récentes portant précisément sur les tendances de l’emploi des grands-parents au Canada, mais l’augmentation du nombre d’aînés qui travaillent est largement documentée depuis quelques décennies. Pour la période de 1997 à 2003, le taux de participation des aînés au marché du travail a oscillé entre 6 % et 7 %, avant de connaître une hausse constante jusqu’à atteindre environ 14 % pour la première moitié de 2017 (le taux étant encore plus élevé pour le groupe des 65 à 69 ans, à hauteur de 27 %). Par conséquent, puisqu’environ 80 % des aînés au pays sont aussi des grands-parents, on peut penser qu’un nombre croissant de grands-parents occupent un emploi à l’heure actuelle.
Sachant que 8 % des grands-parents vivent au sein d’un ménage multigénérationnel, leur capacité d’y contribuer financièrement n’est donc pas à négliger. D’après les données du Recensement de 2016, ce type de ménage connaît la plus forte croissance à l’heure actuelle, en fonction d’une augmentation de près de 38 % entre 2011 et 2016, culminant à 403 810 foyers. De même, le nombre de familles sans génération intermédiaire connaît une tendance similaire, et ce mode de cohabitation s’avère plus fréquent parmi les familles autochtones et immigrantes, lesquelles occupent une portion grandissante du portrait familial au Canada.
Les ménages sans génération intermédiaire sont plus fréquents parmi les familles autochtones et immigrantes, lesquelles occupent une portion grandissante du portrait familial au Canada.
D’après les données de l’ESG de 2011, plus de la moitié (50,3 %) des quelque 584 000 grands-parents ayant adopté de tels modes de cohabitation affirmaient jouer un certain rôle sur le plan financier au sein du ménage. Toutefois, la participation au budget familial est variable et s’avère beaucoup plus élevée chez les grands-parents vivant au sein d’un ménage sans génération intermédiaire (80 %) ou d’un ménage multigénérationnel où la génération intermédiaire se compose d’un parent seul (75 %).
Diversification des liens familiaux avec les grands-parents
Au Canada, le vieillissement de la population totale en général – et du groupe démographique des grands-parents en particulier – pose certains défis sociétaux, notamment en ce qui a trait aux soins communautaires, au logement, au transport et à la sécurité du revenu. En contrepartie, l’augmentation de l’espérance de vie des grands-parents ainsi que l’amélioration globale de leur état de santé ouvre certains horizons pour les individus et leur famille. Plusieurs grands-parents contribuent déjà aux diverses responsabilités familiales en aidant les plus jeunes générations, entre autres pour les soins aux enfants et la gestion du budget familial, et cette tendance devrait se poursuivre au cours des années à venir. Il s’agit là d’une facette positive parfois oubliée lorsqu’il est question du « tsunami gris ».
Par ailleurs, puisque leur état de santé s’est généralement amélioré, bon nombre de grands-parents peuvent désormais entretenir de meilleures relations avec les plus jeunes au sein des familles, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. En misant sur leur capacité de s’adapter et de réagir au contexte socioéconomique et culturel, les grands-parents continueront de jouer un rôle important – et probablement grandissant – dans la vie de famille, au bénéfice des générations à venir.
Rachel Margolis, Ph. D., est professeure agrégée au Département de sociologie de l’Université Western Ontario.
Vous trouverez toutes les références et les sources d’information dans la version PDF de cet article.
Publié le 5 septembre 2017