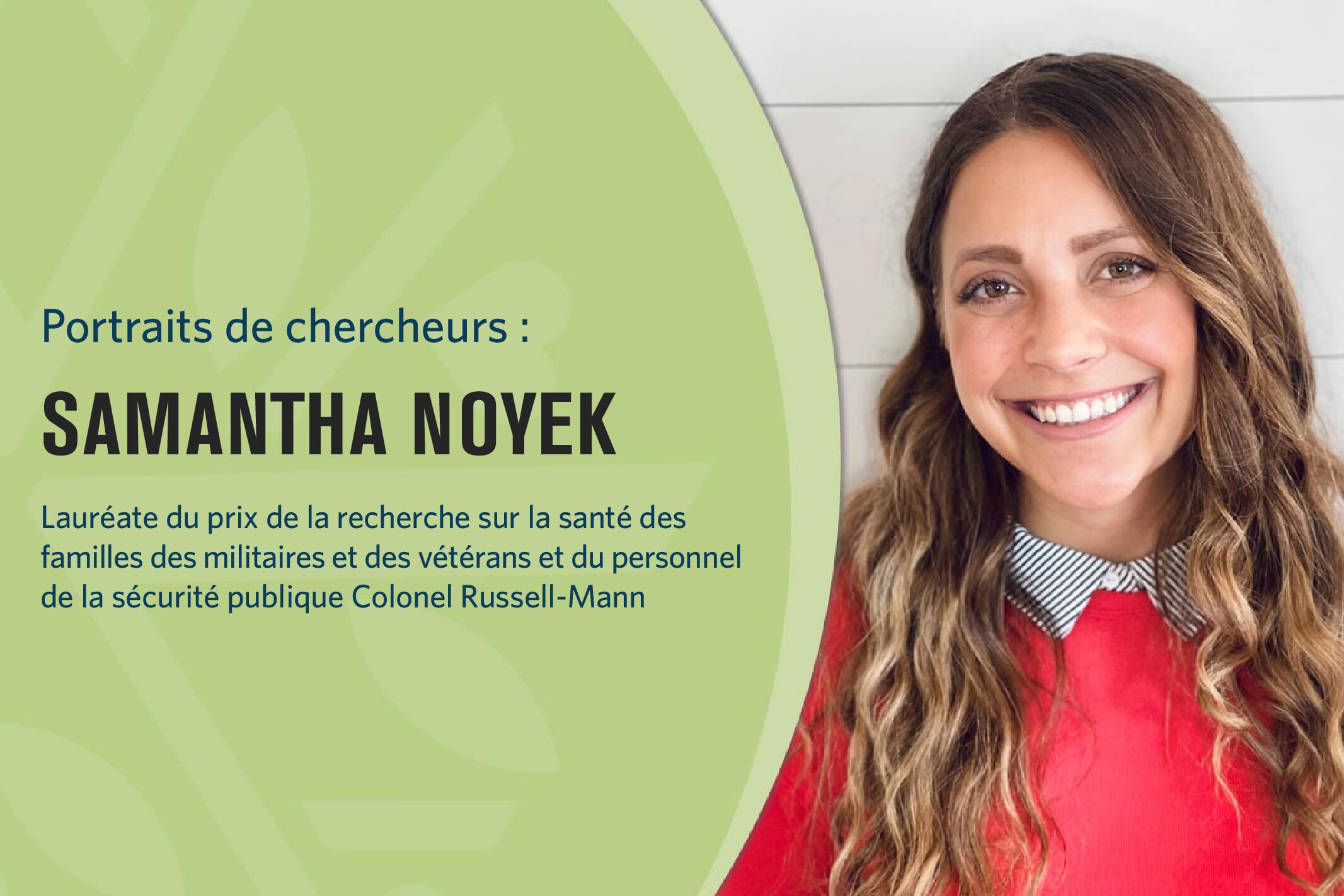
19 février 2025
Portraits de chercheurs : Samantha Noyek
Entretien avec Samantha Noyek, lauréate du prix de la recherche sur la santé des familles des militaires et des vétérans et du personnel de la sécurité publique Colonel Russell-Mann 2024
Emily Kenny
Samantha Noyek est boursière postdoctorale à l’Université McMaster (centre CanChild) ainsi qu’à KidsAbility (un centre de traitement pour enfants en Ontario). Elle dirige actuellement la mise en œuvre du programme ENVISAGE-Families à KidsAbility.
Dans notre tout nouveau Portrait de chercheurs, Samantha, lauréate du prix de la recherche sur la santé des familles des militaires et des vétérans et du personnel de la sécurité publique Colonel Russell-Mann 2024, discute avec Emily Kenny de l’Institut Vanier de la famille de son parcours de recherche et de ses projets à venir.
Parlez-nous de ce que vous avez appris grâce à vos recherches sur les familles, l’incapacité et le bien-être.
Il s’agit indéniablement d’une question importante, mais ce que j’ai avant tout appris, c’est la nécessité d’établir un lien authentique avec les gens avant de se lancer dans la recherche. Je me spécialise en recherches qualitatives, et ce qui me passionne, c’est de comprendre toute l’histoire qui se cache derrière un concept ou une question. Afin d’explorer les dessous d’une histoire, il est essentiel à mes yeux de permettre une véritable connexion humaine et d’être authentique avec les gens.
Votre présentation au Forum 2022 de l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV), « Peer Feedback on the Operational Stress Injury Social Support Program (2013-2018) » (Rétroaction des pairs sur le programme de soutien social aux blessés de stress opérationnel [2013-2018]), a été très appréciée par le jury. Pourriez-vous nous faire part de certaines conclusions ou perspectives importantes tirées de vos travaux de recherche?
Oui, bien sûr. Le programme SSBSO (soutien social aux blessés de stress opérationnel) existe depuis environ 25 ans et vient en aide aux vétéranes et vétérans, aux militaires en service ainsi qu’à leur famille. Je ne saurais m’attribuer le mérite de sa longévité et de son efficacité, mais le programme est hautement apprécié et les gens y voient une ressource précieuse.
Les sondages effectués auprès des pair·es nous ont permis de constater que les gens apprécient vraiment la souplesse du programme. Ce dernier offre un soutien à la fois individuel et collectif. Les participantes et participants se voient offrir des outils et du soutien au sein du groupe. L’une des principales observations soulevées par les participantes et participants était le fait de réaliser qu’elles et ils n’étaient « pas seul·es ». Certaines personnes affirmaient que le programme les avait aidées à traverser des périodes sombres et à prendre conscience de leur réelle valeur.
Une part importante des personnes interrogées étaient des vétéranes et vétérans, ainsi que des membres de leur famille. L’une des limites que nous avons remarquées est que les commentaires ont été collectés à l’aide de questionnaires papier, si bien qu’il nous a été impossible de colliger les observations de certains groupes de population. Il serait judicieux d’adapter notre approche pour y inclure une version en ligne et d’élargir l’examen des résultats. Pour l’instant, le questionnaire comporte quelques questions quantitatives et alloue un petit espace pour les commentaires. En tant que chercheuse qualitative, je crois qu’il serait fort utile de parler directement avec les bénévoles et les participantes et participants afin de mieux comprendre leur expérience avec le programme.
Vos travaux de recherche couvrent plusieurs thèmes liés à la santé et au bien-être des enfants et des familles. En quoi l’interaction et le croisement de ces thèmes influencent-ils le bien-être des familles, dans toute leur diversité?
J’ai entamé mon parcours en sciences de la réadaptation, une discipline qui a servi de base à mes recherches, et dans laquelle j’ai fait mon doctorat. À travers cette expérience, j’ai adopté une perspective biopsychosociale du bien-être, qui englobe les dimensions biologiques, psychologiques et sociales de la santé.
Pendant mon doctorat, j’ai travaillé avec des familles d’enfants en situation de handicap. J’ai par la suite travaillé avec des familles d’enfants ayant subi une intervention chirurgicale majeure, puis avec des familles de vétéranes et de vétérans. En explorant ces diverses sphères, j’ai constaté que les composantes essentielles au bien-être familial et au bon développement de leurs membres sont généralement similaires d’une famille à l’autre.
À CanChild, où je travaille actuellement, nous utilisons une adaptation de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF). Ce cadre s’appelle « Mes mots préférés », et il y en a six : famille, capacités, amis, forme, plaisir et avenir. Selon moi, ces six sphères sont, à des degrés divers, essentielles pour toutes les familles et elles influencent ma façon de concevoir le bien-être, en particulier au Canada.
Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels s’attaquer pour favoriser le bien-être global des familles des militaires?
Pour y répondre, cette question doit avant tout être posée aux familles concernées. J’ai travaillé avec la Dre Melanie Noel, qui dirige un projet extraordinaire avec des chercheuses et chercheurs ainsi que des partenaires familiaux et qui a pour but de comprendre ce que les familles attendent d’un programme portant spécifiquement sur la souffrance et la santé mentale. L’équipe a fait appel à des partenaires familiaux dès le commencement pour être en mesure de bien cerner les enjeux et de déterminer la meilleure manière de soutenir les familles.
Ce qui m’intéresse particulièrement, c’est de comprendre l’éventail de programmes familiaux disponibles – camps de fin de semaine, ateliers familiaux et autres. Je veux savoir pourquoi certains programmes profitent davantage à certaines familles qu’à d’autres, à quels moments et de quelle manière. Mais dans l’ensemble, il s’agit de demander directement aux familles ce dont elles ont besoin et de se servir de leurs perspectives pour façonner les programmes et les politiques.
Le programme ENVISAGE-Families offre du soutien aux personnes proches aidantes d’enfants présentant des troubles du développement. Quels ont été les effets les plus marquants liés à la mise en œuvre de ce programme chez KidsAbility, et comment répond-il aux besoins propres aux familles issues de différents milieux?
ENVISAGE est l’acronyme de « Enabling Visions and Growing Expectations » (Concrétiser des visions et faire face à des attentes grandissantes). Il s’agit d’une plateforme d’apprentissage en ligne permettant d’apprendre à son propre rythme et comprenant une série d’ateliers virtuels. Le programme a été développé en partenariat avec des parents, des cliniciennes et cliniciens ainsi que des chercheuses et chercheurs du Canada et de l’Australie. L’objectif est d’améliorer le bien-être des parents et de les accompagner afin qu’ils se sentent plus en confiance et en contrôle.
Je suis en train de l’implanter dans un centre de traitement pour enfants appelé KidsAbility, et je suis impatiente de voir les résultats. Nous venons tout juste de recevoir l’approbation éthique et nous avons rapidement commencé à recruter des familles. Nous n’avons donc pas encore de résultats significatifs. Les travaux antérieurs d’ENVISAGE ont toutefois montré des effets à long terme sur le bien-être, la confiance et le pouvoir d’agir des parents. Le programme leur apporte un réel soutien alors qu’ils traversent une période qui s’avère à la fois éprouvante et complexe.
L’une des particularités du programme ENVISAGE à KidsAbility est l’attention que nous portons aux familles en attente d’un diagnostic ou de services. L’attente est souvent synonyme de stress et d’incertitude pour les familles, et nous espérons qu’ENVISAGE les aidera à mieux gérer cette période en réduisant leur stress et en renforçant leur confiance en elles. Le programme établit également un langage commun entre les familles et les prestataires de services, ce qui facilite la collaboration et la compréhension.
En menant vos études doctorales, vous avez intégré diverses perspectives en interrogeant de multiples personnes liées à des participantes et participants éprouvant des problèmes de communication complexes. Que vous a révélé cette approche sur le rôle de la famille et de la communauté dans le soutien apporté à ces personnes, et comment ces renseignements pourraient-ils influencer les politiques et les pratiques?
Lors de mes recherches doctorales, j’ai interrogé jusqu’à cinq personnes proches de chaque participante et participant. Cette approche a permis de mettre en relief l’importance pour une personne que quelqu’un soit en mesure d’interpréter et de porter sa voix. Si l’ensemble des participantes et participants étaient incapables de parler de manière habituelle ou d’utiliser des outils standard, comme un clavier ou du papier et un crayon, toutes et tous étaient soutenus par une personne qui comprenait leur mode de communication, leurs désirs, voire leur essence, en tant qu’individus.
Ces personnes interprètes n’étaient pas toujours des membres de la famille – il pouvait s’agir d’une ou d’un ami·e proche, d’une cousine ou d’un cousin ou encore d’une ou d’un préposé·e –, mais leur soutien jouait un rôle essentiel. Il importe donc d’aller au-delà des relations individuelles et de recueillir la perspective de plusieurs personnes.
D’un point de vue stratégique, cette approche suggère qu’il serait bénéfique d’impliquer plusieurs voix dans les processus décisionnels, par exemple lors des rendez-vous ou de la planification des services. Elle souligne également l’importance d’offrir aux individus diverses méthodes pour répondre et communiquer, en adaptant le processus à leurs besoins particuliers.
Quelles méthodes avez-vous employées pour permettre aux familles d’accéder aux résultats de vos travaux de recherche et comment en évaluez-vous l’efficacité?
Il s’agit d’une question tellement importante, car bien souvent les chercheuses et chercheurs rédigent un article, le publient et le présentent lors de conférences, mais les communautés et les familles concernées n’ont souvent pas accès aux informations qu’il contient! Puisque les conclusions de ces recherches appartiennent en quelque sorte aux familles, il m’apparaît essentiel de leur communiquer l’information dans un format accessible.
J’ai créé des vidéos pour communiquer les résultats de mes travaux, bien que je ne sois pas une experte en production vidéo! J’ai suivi des cours de communication scientifique afin de rendre les images plus attrayantes et évocatrices pour les familles. Mais au-delà de cela, je pense qu’il est primordial d’inclure les familles dans la réflexion quant à la meilleure manière de leur transmettre l’information. Certaines préfèrent les fiches infographiques, les vidéos, voire les courts résumés en ligne. Le format devrait être choisi en fonction de ce qui leur convient le mieux.
Comment entendez-vous poursuivre vos recherches dans le domaine de la santé des familles? Y a-t-il des thèmes ou des sujets particuliers que vous aimeriez explorer davantage?
J’ai bien l’intention de poursuivre mes recherches dans le domaine de la santé familiale. Je suis actuellement boursière postdoctorale à l’Université McMaster, au sein du centre CanChild. Mon travail porte sur les familles d’enfants présentant des retards de développement soupçonnés ou avérés.
Depuis peu, je me concentre particulièrement sur l’accompagnement des familles aux dynamiques complexes et singulières. Je collabore notamment à certains travaux avec ma collègue, la Dre Maude Champagne. Ces travaux portent sur les enfants et les jeunes qui ont déjà été pris en charge par le système de protection de l’enfance, sur les familles qui ont adopté des enfants ainsi que sur les familles qui font face à des agressions de la part d’enfants ou de jeunes. Je suis très enthousiaste à l’idée d’explorer ces structures familiales atypiques et de réfléchir à la meilleure façon de soutenir leur bien-être.
Vous avez mentionné plus tôt que vous dirigiez également votre propre entreprise, pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet?
Au cours des deux dernières années, j’ai eu l’occasion de m’aventurer dans l’entrepreneuriat et j’ai fondé ma propre entreprise que j’ai appelée Our Well Being (notre bien-être). L’acronyme « O-U-R » signifie Outreach, Understanding et Research Well Being (sensibilisation, compréhension et recherche sur le bien-être). Cela m’a permis de réaliser divers projets impliquant l’évaluation de programmes, la rédaction de rapports pour différents organismes à but non lucratif, en plus d’avoir l’occasion de soutenir des projets familiaux, tous axés sur le bien-être. Je bien hâte de voir où cela me conduira, parallèlement à ma carrière universitaire et à mes recherches à l’Université McMaster.
L’un des projets qui me tiennent particulièrement à cœur consiste à aider les jeunes qui ont été pris en charge par le système de protection de l’enfance à réussir dans les métiers du bâtiment et de la construction. C’étaient deux domaines que je ne connaissais pas du tout au départ. Au cours de la première année où j’ai dirigé ce programme, je me suis efforcée de créer des liens avec ces secteurs et celui de la protection de l’enfance, ainsi qu’avec les personnes concernées. J’ai appris énormément; j’ai assumé le rôle de courtière de connaissances entre les deux milieux, tout en élaborant un programme destiné à aider les jeunes, au terme de leur prise en charge, à s’intégrer dans le monde du travail et la communauté.
En vous basant sur votre expérience et vos réalisations dans ce domaine, quels conseils donneriez-vous à d’autres chercheuses et chercheurs, principalement à celles et ceux qui s’intéressent aux questions familiales?
Impliquer les familles. Que vous employiez des méthodes de recherche qualitatives, quantitatives ou mixtes, il est crucial de donner la parole aux familles. Je coenseigne un cours intitulé « Family Engagement in Research » (la participation des familles à la recherche) à l’Université McMaster, au centre CanChild. Ce cours réunit des chercheuses et chercheurs, des stagiaires et des familles partenaires en vue d’aborder divers sujets, notamment l’éthique, les obstacles à la participation, les chartes de projet, la rémunération et l’importance de demander aux familles comment elles souhaitent s’engager.
Il est essentiel d’impliquer les familles de manière significative et appropriée dès le départ. Leur contribution façonne les travaux de recherche afin qu’ils soient plus utiles et pertinents.
Emily Kenny est coordonnatrice à la mobilisation des connaissances à l’Institut Vanier de la famille.
Pour ne rien manquer – InfoVanier
Mises à jour mensuelles à propos des publications, des projets et des travaux de recherches de l’Institut Vanier
