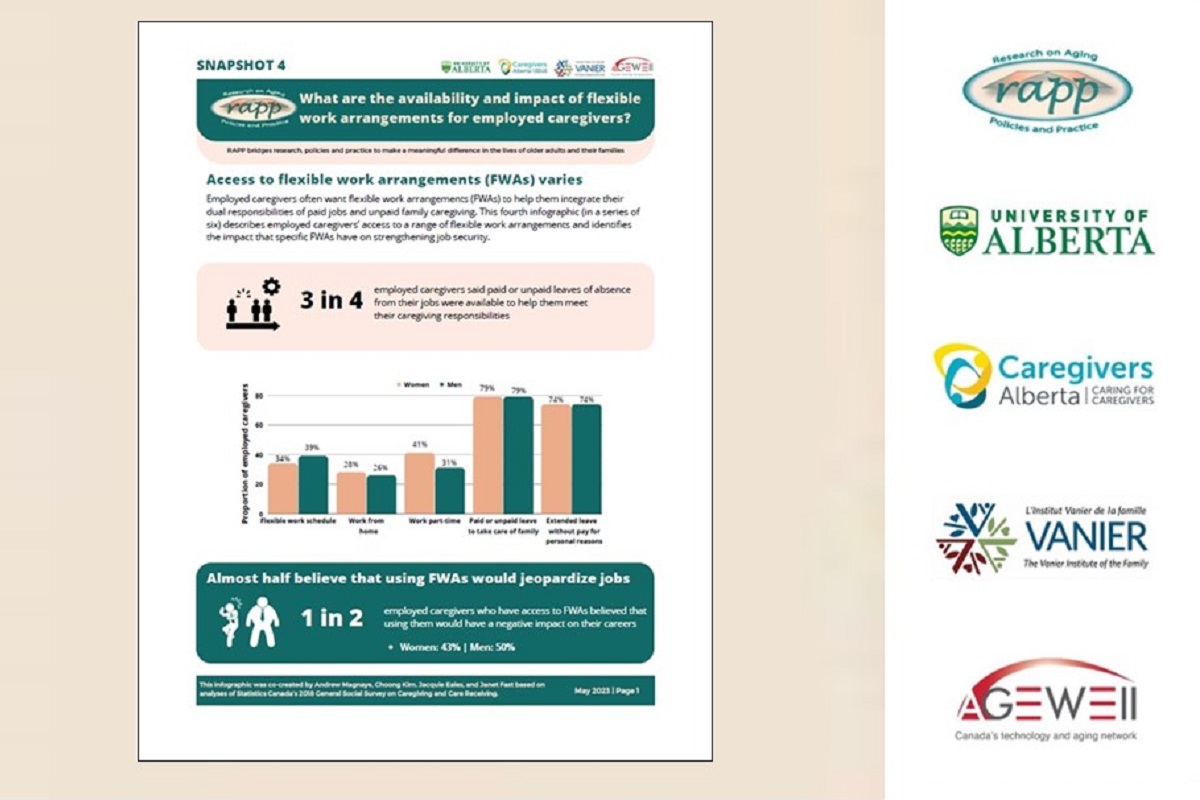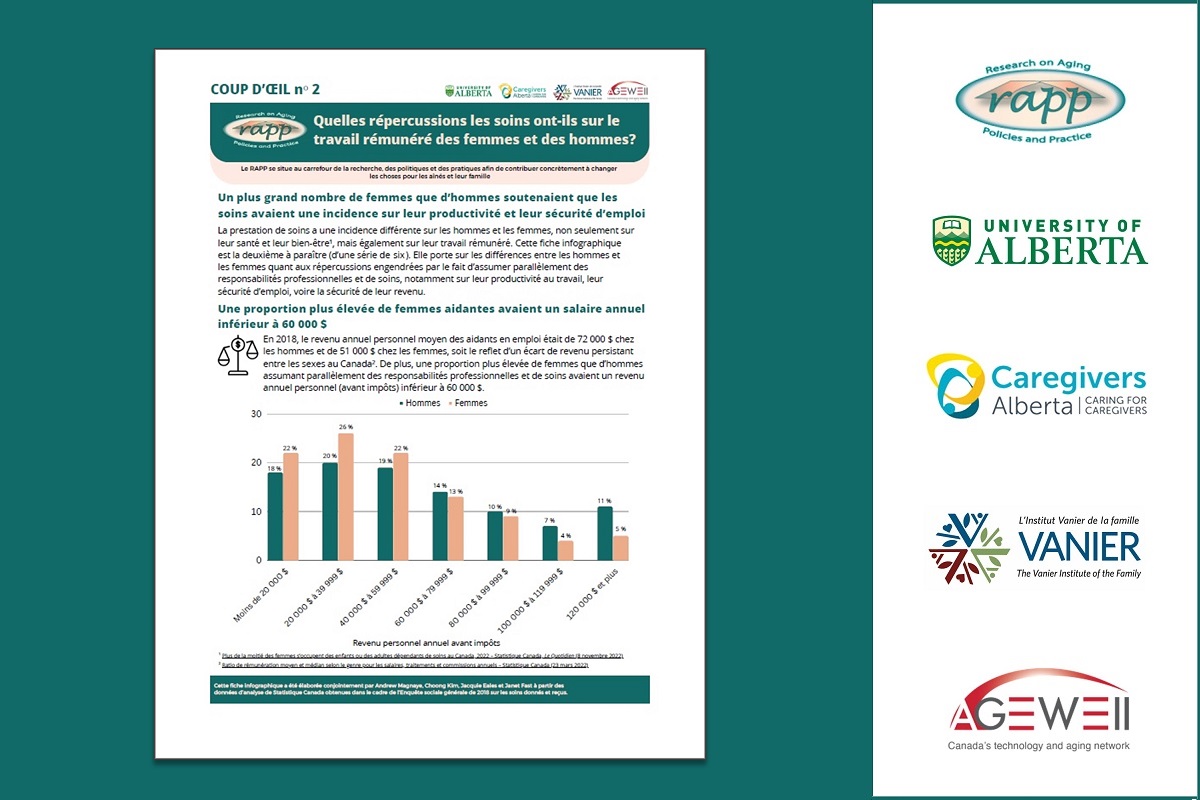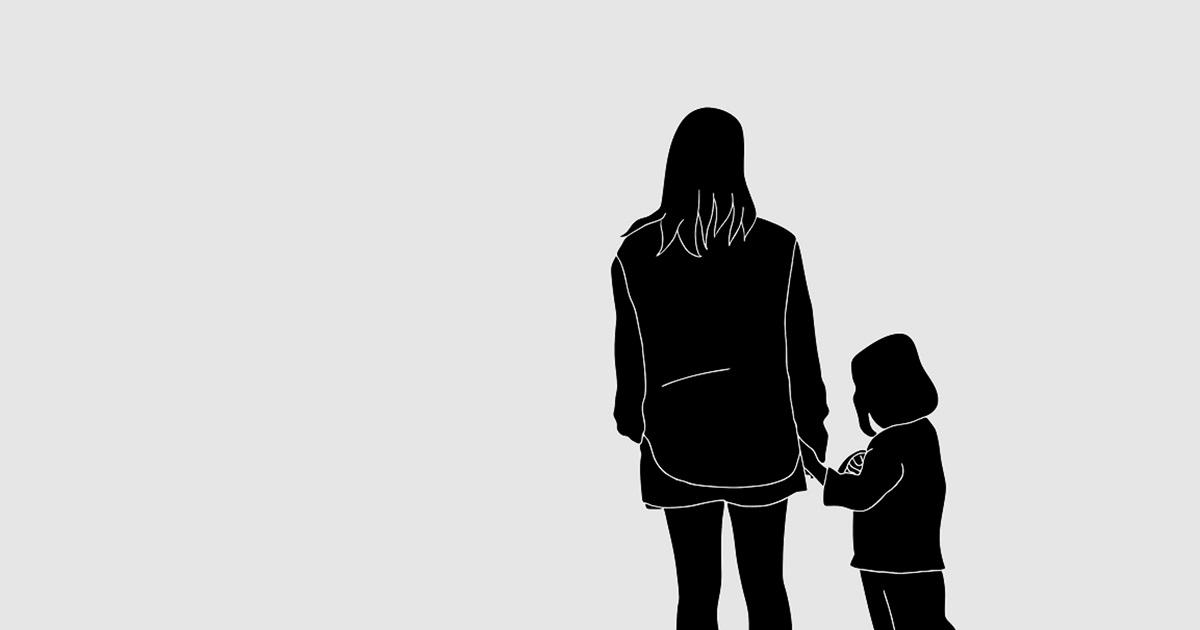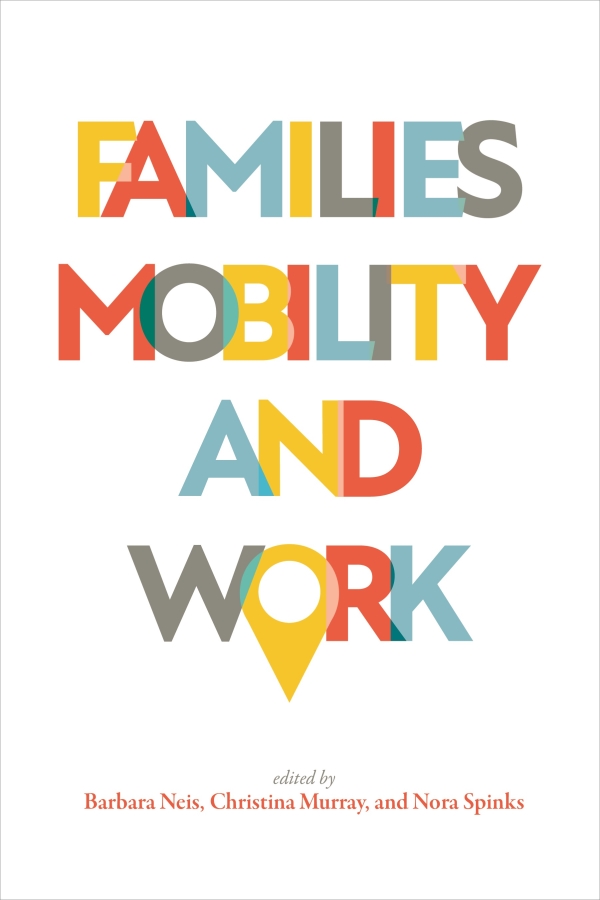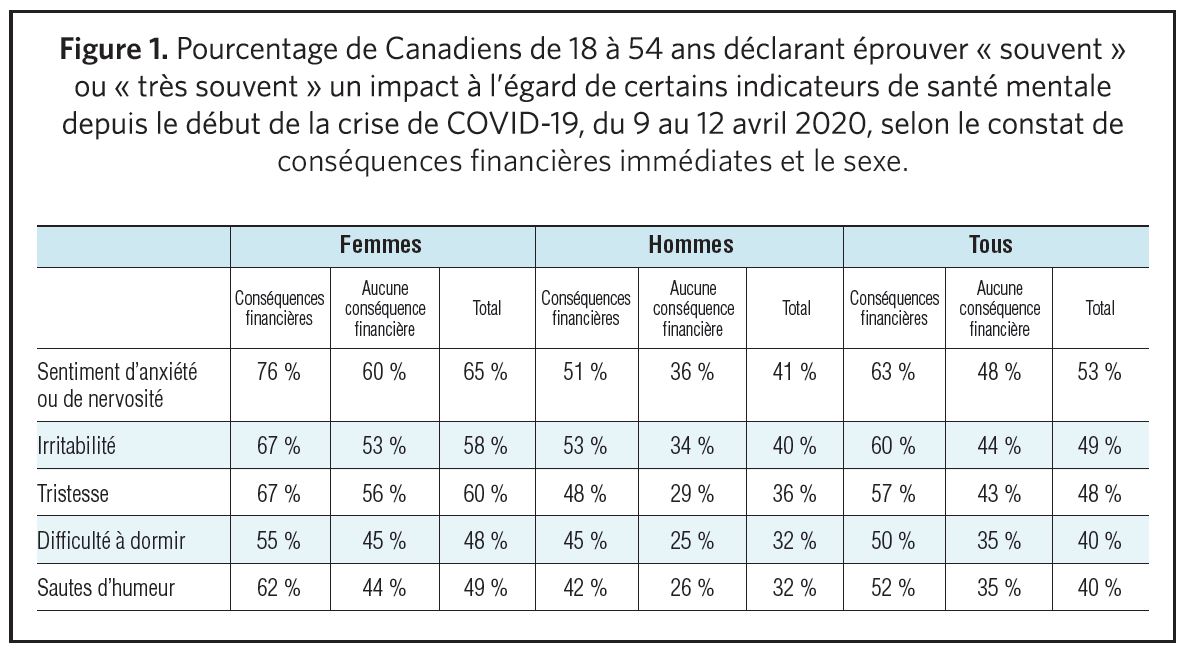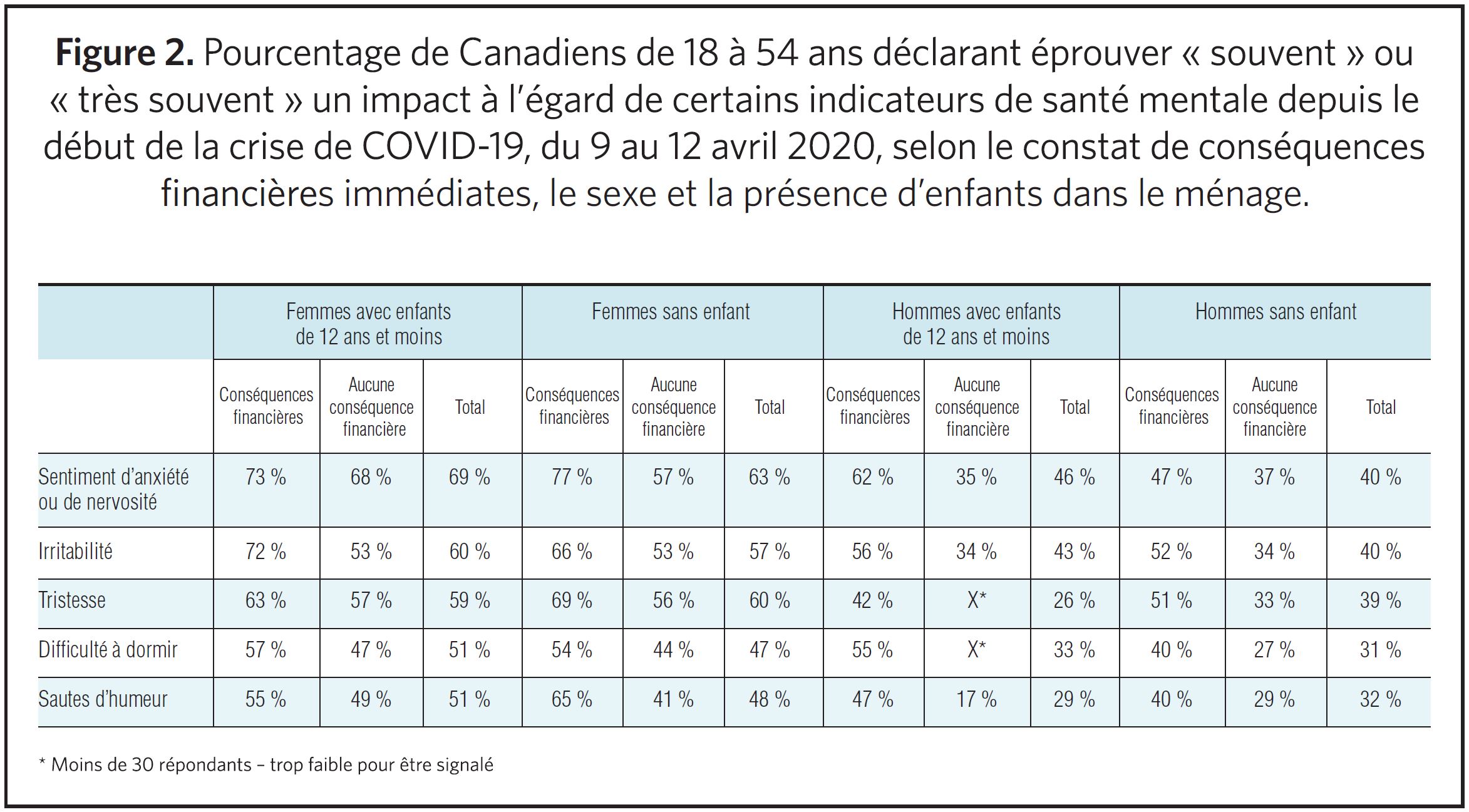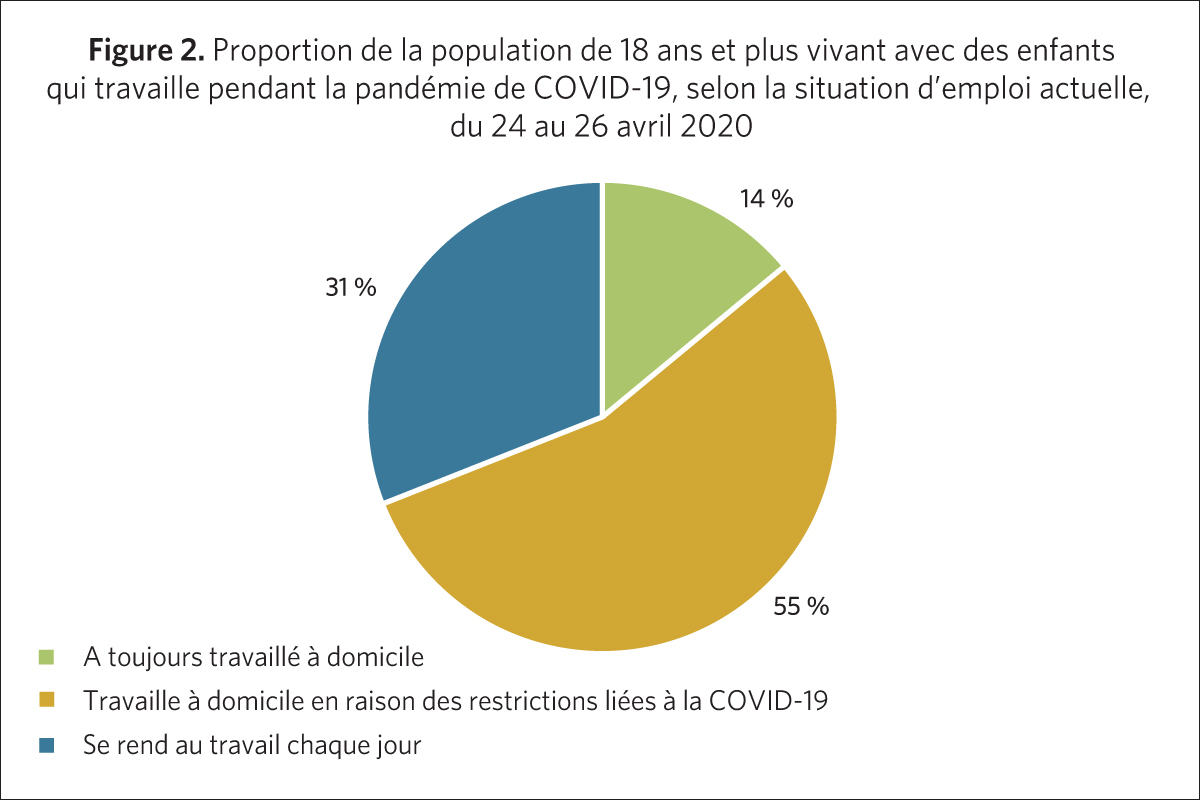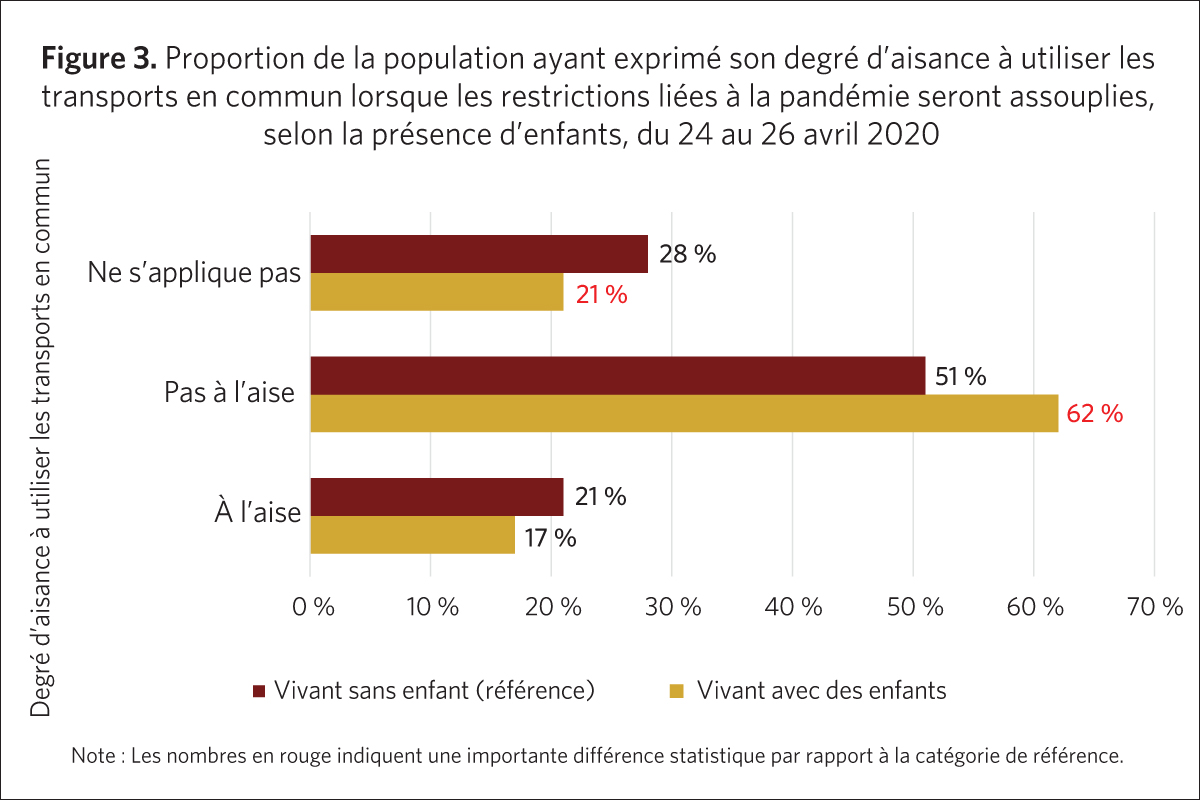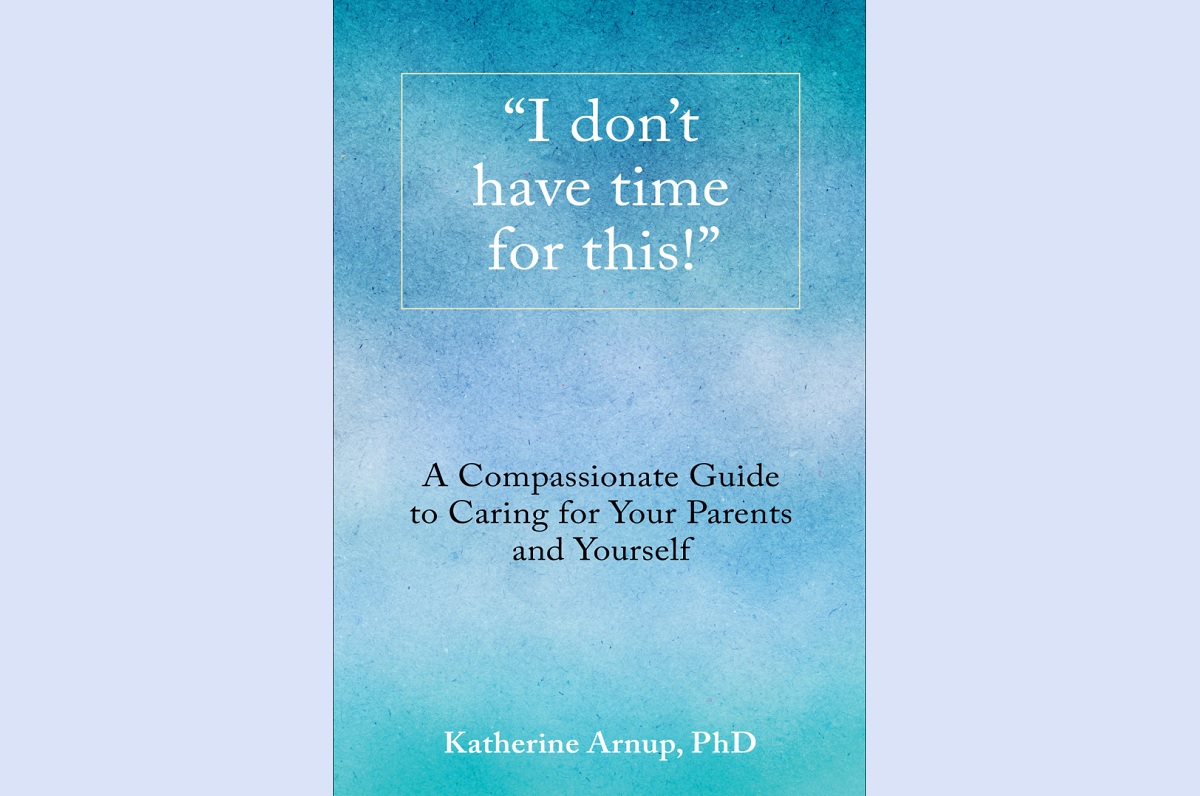S’il est vrai, comme le veut le dicton, qu’« il faut tout un village pour élever un enfant », il faut certainement toute une collectivité pour faciliter sa naissance. Tout au long de la période périnatale, plusieurs personnes prodiguent des soins aux femmes enceintes et aux nouvelles mères. Les réseaux et les relations sur lesquels s’appuient ces intervenants jouent un rôle majeur pour assurer la santé et le bien-être des nouvelles mères et de leurs nourrissons.
La naissance représente un jalon important et exaltant, qui voit la famille s’élargir et la venue d’une nouvelle génération. Il s’agit également d’une période cruciale pour le développement de l’enfant, très vulnérable à ce stade, mais également susceptible de bénéficier grandement d’un milieu sain.
La grossesse, la naissance, l’accouchement et les soins postnataux évoluent sans cesse au fil des générations. Compte tenu des avancées médicales et de l’amélioration globale des soins de maternité, de l’alimentation et du niveau de vie en général tout au long du XXe siècle, on a constaté des progrès considérables en ce qui concerne le taux de mortalité maternelle (décès d’une femme à la suite de complications de la grossesse ou de l’accouchement), le taux de morbidité maternelle (complications pour la mère en lien avec l’accouchement) et le taux de mortalité infantile.
Mortalité Maternelle et infantile au Canada
En 1931, la mortalité maternelle représentait 508 décès pour chaque tranche de 100 000 naissances vivantes, mais on ne comptait plus que 7 décès par tranche de 100 000, en 2015.
De 1931 à 1935, le taux de mortalité infantile moyen atteignait 76 décès pour chaque tranche de 1 000 naissances vivantes, mais se limitait à 4,9 décès par tranche de 1 000, en 2013.
À partir du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle, l’accouchement se passait généralement à la maison et les soins de maternité au Canada étaient dispensés au sein de la collectivité. En règle générale, il incombait aux familles et aux sages-femmes de prendre soin des femmes enceintes et des nouvelles mères. Toutefois, avec l’instauration des régimes d’assurance-maladie au XXe siècle, les hôpitaux et les services médicaux ont graduellement pris le relais pour encadrer les naissances et les soins de maternité, principalement sous la supervision de professionnels de la santé comme les médecins et les obstétriciens. On a parfois parlé de « médicalisation de la naissance » pour évoquer cette tendance.

Par conséquent, au début des années 80, la vaste majorité des femmes accouchaient désormais dans les hôpitaux régionaux, sous la supervision d’un médecin de famille ou d’un obstétricien, avec l’aide d’infirmières en obstétrique. Du même coup, les conjoints et les autres membres de la famille se retrouvaient en marge du processus de l’accouchement, souvent confinés à des salles d’attente. Après la naissance, les mères aussi étaient séparées de leurs bébés gardés en pouponnière, ce qui s’avérait parfois traumatisant tant pour la mère que pour son nourrisson.
Puis les centres hospitaliers ont progressivement instauré des politiques de cohabitation pour la mère et son bébé en vue de faciliter l’allaitement et de favoriser les liens d’attachement mère-enfant, au bénéfice de la santé et du bien-être de chacun. Dans le cadre de cette cohabitation, les infirmières ont commencé à transmettre de l’information aux nouvelles mères relativement à leur rétablissement, en leur donnant notamment divers conseils sur l’allaitement et les soins postnataux. Au fil de ces changements subséquents dans les pratiques de soins postnataux, on a réussi à raccourcir considérablement la durée d’hospitalisation des femmes suivant l’accouchement, qui est passée de cinq journées d’hospitalisation en moyenne en 1984-1985 dans le cas d’un accouchement vaginal, à une ou deux journées actuellement.
De nos jours, les conjoints sont beaucoup plus impliqués qu’autrefois dans l’accouchement et le processus périnatal. La plupart assistent à l’accouchement et assument ensuite un rôle accru dès les premières heures de vie de leur enfant de même qu’au cours des années suivantes. Il n’est pas rare d’entendre les couples modernes parler de l’accouchement comme d’une expérience conjointe, et cette tendance se reflète d’ailleurs dans les propos de plusieurs (« Nous attendons un enfant… », etc.).


Qu’est-ce que les soins de maternité?
Les soins périnataux ou de maternité (on emploiera ici soins de maternité) sont des termes génériques pour désigner le continuum de soins auprès de la mère et de son bébé, et ce, avant, pendant et après la naissance. On parle plus précisément des soins prénataux ou anténataux (c.-à-d. les soins durant la grossesse), des soins pernataux (soit durant le travail et l’accouchement) ainsi que des soins postnataux ou post-partum (c.-à-d. les soins à la mère et au nouveau-né après la naissance). Puisque la mère et l’enfant vivent tous deux d’importants changements au cours de la période périnatale, les soins de maternité supposent un large éventail de mesures de suivi et de soins de santé.
Les soins prénataux ou anténataux (on emploiera ici les soins prénataux) visent à surveiller et à favoriser la santé et le bien-être de la mère et de son fœtus en développement avant la naissance. Diverses techniques de surveillance et de diagnostic sont mises à contribution pour assurer la santé fœtale, notamment au moyen d’échographies et de prélèvements sanguins. Pendant cette période, la santé de la mère est aussi suivie de près par les professionnels de la santé. Les femmes enceintes reçoivent de l’information sur la grossesse, le développement du fœtus, le confort physique, les différents tests, la planification en vue de l’accouchement, ainsi que sur la préparation au rôle de parent.
La plupart des femmes (87 %) disent avoir reçu le soutien de leur partenaire, de leur famille ou de leurs amis durant la période prénatale.
Selon l’Enquête canadienne sur l’expérience de la maternité de 2009, la plupart des femmes (87 %) disent avoir reçu le soutien de leur partenaire, de leur famille ou de leurs amis durant la période prénatale. Au cours de cette période, ce soutien ainsi que les soins des praticiens de la santé s’avèrent particulièrement importants puisque plusieurs femmes (57 %) affirment que la plupart des journées sont stressantes. Durant la grossesse, le stress chez la mère peut affecter le bien-être du bébé, et parfois causer une naissance prématurée ou un faible poids à la naissance.
Selon la vaste majorité des femmes enceintes interrogées (95 %), les soins prénataux débutent généralement au cours du premier trimestre de grossesse. Parmi certains groupes toutefois, ces soins commencent parfois plus tard qu’au premier trimestre, notamment pour la tranche des 15 à 19 ans, pour les femmes moins scolarisées ou pour celles vivant au sein d’un ménage à faible revenu. À cet égard, l’une des principales raisons évoquées pour expliquer les soins tardifs en cours de grossesse concernait les difficultés d’accès à un médecin ou à professionnel de la santé.
Les soins pernataux ou intrapartum (on emploiera ici les soins pernataux) désignent les soins et l’assistance auprès des mères durant le travail et l’accouchement, notamment pour que la naissance se déroule dans un cadre sécuritaire et hygiénique, et pour surveiller la santé de la mère et de l’enfant tout au long du processus. La plupart du temps, ces soins sont prodigués en milieu hospitalier, où les mères bénéficient des services de divers professionnels de la santé, notamment des obstétriciens et des gynécologues (principaux fournisseurs de soins de santé durant l’accouchement, selon 70 % des mères interrogées), des médecins de famille (15 %), des infirmières ou des infirmières praticiennes (5 %) ou encore des sages-femmes (4 %).
L’importance du soutien affectif n’est pas négligeable durant cette période, qu’il provienne d’un conjoint ou partenaire, d’un ami, d’un membre de la famille, d’une sage-femme ou d’une accompagnante à la naissance (ou d’une combinaison de ces intervenants). Les études ont montré que les femmes qui bénéficient d’un soutien social constant seraient plus susceptibles d’accoucher rapidement (quelques heures de moins) et par voie vaginale, de considérer l’accouchement et la naissance comme un épisode heureux, et d’avoir moins recours à divers analgésiques.
Les études ont montré que les femmes qui bénéficient d’un soutien social constant seraient plus susceptibles d’accoucher rapidement et par voie vaginale, et de considérer l’accouchement et la naissance comme un épisode heureux.
Les soins postnataux ou post-partum (on emploiera ici les soins postnataux) visent à soutenir la mère et le nouveau-né après la naissance, ce qui suppose le suivi de leur état de santé ainsi que diverses évaluations de routine en vue de cibler tout écart par rapport à la courbe normale de rétablissement après l’accouchement, pour pouvoir intervenir au besoin.
La période postnatale couvre les six premières semaines de vie de l’enfant, soit une « phase critique » au cours de laquelle les professionnels de la santé fournissent divers soins et procèdent à plusieurs examens importants pour assurer le bien-être de la mère et de l’enfant, comme le confirme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Dans ses lignes directrices de 2013 concernant les soins postnataux, l’OMS cible les pratiques exemplaires à privilégier, entre autres en ce qui concerne les soins postnataux auprès des mères et des bébés durant les 24 premières heures (peu importe où l’accouchement a eu lieu), l’importance de garder la mère et l’enfant au moins 24 heures dans un établissement de santé sans précipiter le congé, et la nécessité de prévoir au moins quatre suivis postnataux durant les six semaines suivant l’accouchement.
D’après l’Enquête canadienne sur l’expérience de la maternité, plus des sept dixièmes des femmes (73 %) considéraient que leur santé était « excellente » ou « très bonne » après un délai de cinq à quatorze mois suivant l’accouchement. Cependant, plus des quatre dixièmes des Canadiennes (43 %) affirmaient avoir connu au moins « un gros problème » de santé post-partum au cours des trois premiers mois suivant l’accouchement, notamment des douleurs aux seins (16 % des femmes), des douleurs dans la région vaginale ou de l’incision de la césarienne (15 %), ou encore des maux de dos (12 %).
Le soutien postnatal peut aussi s’avérer important pour contrer la dépression post-partum, qui toucherait 10 à 15 % des mères dans les pays développés. Des études ont révélé que la dépression post-partum dépend de certains facteurs déterminants, notamment le stress vécu par la mère durant la grossesse, l’accessibilité à des mesures de soutien social, ainsi que les antécédents personnels de dépression. Selon les données de recherche, le soutien affectif du partenaire et des autres membres de la famille tout au long de la période périnatale contribuerait à réduire les risques de dépression post-partum et de troubles émotionnels chez la mère tout comme chez le nouveau-né.
Du reste, les services offerts en soins postnataux varient d’une région ou d’une collectivité à l’autre au Canada, qu’il s’agisse de soutien informationnel, de visites à domicile par une infirmière en santé publique ou un éducateur non-spécialiste de la santé, ou encore du soutien téléphonique d’une sage-femme ou d’une infirmière en santé publique.
Depuis quelques décennies, le secteur privé offre une panoplie grandissante de services postnataux, notamment des services intensifs d’accompagnantes post-partum pour s’occuper des nouveau-nés, de l’aide à l’allaitement naturel ou au biberon, ou encore des services de garde d’enfants, de préparation des repas ou d’aide aux tâches ménagères, etc. Toutefois, ces services privés ont un coût et, par conséquent, ne sont pas accessibles à toutes les familles.

D’où proviennent les soins de maternité?
Outre les soins et le soutien des proches et des amis, la réalité moderne des soins de maternité dépend aussi de nombreux professionnels de la santé qui contribuent chacun à leur façon au continuum de soins, notamment les médecins de famille, les obstétriciens ou gynécologues, les infirmières, les infirmières praticiennes, les sages-femmes de même que les accompagnantes à la naissance.
D’abord, les médecins de famille fournissent des soins à la plupart des nouvelles mères tout au long de la période périnatale. Ils sont susceptibles d’intervenir à tous les stades des soins de maternité ou des soins aux nourrissons, mais tous n’offrent pas nécessairement la gamme complète des soins. Par rapport aux décennies antérieures, on constate cependant un recul du nombre de médecins prodiguant des soins de maternité au Canada. En effet, la proportion des médecins de famille qui procèdent à des accouchements a fléchi au pays de 1997 à 2010, passant de 20 % à 10,5 %. De nos jours, une proportion croissante des tâches et des responsabilités de soins reviennent à d’autres professionnels de la santé, comme les obstétriciens ou les sages-femmes.
La plupart des médecins de famille qui participent aux soins de maternité ou aux nourrissons le font dans une approche de « soins partagés », c’est-à-dire que leur suivi ne dépasse pas un certain stade de la grossesse (souvent entre 24 et 32 semaines), après quoi les soins sont confiés à un autre fournisseur comme un obstétricien, une sage-femme ou un autre médecin de famille accoucheur. De fait, certains médecins de famille participent à l’accouchement, mais leur nombre varie considérablement d’une province à l’autre ou en fonction de la disponibilité d’autres fournisseurs de soins de santé.
Au Canada, les obstétriciens et gynécologues assument une part grandissante des soins pernataux, mais ce n’est pas le cas de tous ces spécialistes, et les proportions à cet égard varient d’une province à l’autre. Puisqu’ils possèdent une expertise et des connaissances spécialisées au sujet de la grossesse, de l’accouchement, de la santé sexuelle féminine et des soins génésiques (y compris une formation en chirurgie pour effectuer notamment des césariennes), plusieurs agissent également comme experts-conseils auprès des autres médecins, ou encore supervisent les grossesses à haut risque.
Les infirmières et infirmiers représentent le groupe le plus important en nombre parmi les fournisseurs de soins de maternité au Canada. Appelés à jouer un rôle actif tout au long de la période périnatale, ces intervenants prodiguent un éventail de soins, ce qui se traduit notamment par de l’éducation au sujet de l’accouchement, ainsi que par des services prénataux à domicile auprès des femmes ayant une grossesse à haut risque, de l’assistance durant l’accouchement, et parfois aussi des soins de suivi auprès des nouvelles mères. Après la naissance, les infirmières et infirmiers sont souvent appelés à transmettre de l’information aux nouvelles mères tout en les préparant en vue de leur congé, y compris en ce qui concerne l’allaitement, les soins du bain, les symptômes de la jaunisse, la sécurité pendant le sommeil, la santé mentale post-partum, l’alimentation, etc.
Quant aux infirmières praticiennes, ce sont des infirmières agréées assumant une gamme élargie de responsabilités en soins de santé. Dans bien des cas, elles fournissent des soins de première ligne en suivi de grossesse à faible risque, et interviennent à plusieurs niveaux (examens physiques, tests de dépistage ou de diagnostic, soins postnataux, etc.). Lorsqu’elles sont appelées à assumer ou à faciliter des soins de maternité, les infirmières praticiennes travaillent souvent au sein d’équipes multidisciplinaires en collaboration avec d’autres professionnels de la santé, dont les médecins et les sages-femmes. En milieu hospitalier, on les retrouve également en salle d’obstétrique et d’accouchement, dans les unités de soins post-partum, dans les unités néonatales de soins intensifs ainsi que dans les services de consultation externes. Compte tenu de leur expertise et de leur formation élargie, les infirmières praticiennes jouent un rôle important dans les collectivités rurales ou éloignées, où elles fournissent dans bien des cas la gamme complète des services de soins de santé.
Compte tenu de leur expertise élargie et de leur formation, les infirmières praticiennes jouent un rôle important dans les collectivités rurales ou éloignées, où elles fournissent dans bien des cas l’éventail complet des services de soins de santé.
Les sages-femmes, quant à elles, prodiguent des soins de santé primaires auprès des femmes enceintes et des nouvelles mères, et ce, durant toute la période périnatale. Assumant un rôle de plus en plus important dans le paysage moderne des soins de maternité au Canada, les sages-femmes procurent toute une gamme de services, comme demander des tests de dépistage et en assurer le suivi, accompagner les femmes qui accouchent à domicile ou dans les centres de naissances, superviser l’admission des mères qui doivent accoucher à l’hôpital, ou encore épauler les nouvelles mères pour faciliter l’allaitement, leurs premiers pas comme parents ou leur rétablissement post-partum. Selon les cas, les sages-femmes travaillent en consultation ou en collaboration avec d’autres professionnels de la santé.
Leur rôle a largement évolué au cours des dernières décennies, si bien qu’un nombre grandissant de sages-femmes sont désormais mises à contribution dans divers milieux, que ce soit à domicile, dans les collectivités, dans les hôpitaux, dans les centres médicaux ou dans les unités de soins. La formation et la spécialisation des sages-femmes sont de plus en plus encadrées, puisque ces dernières sont désormais reconnues et intégrées dans les réseaux de soins de santé de la plupart des provinces et territoires au pays (mais pas tous).

Parallèlement, les accompagnantes à la naissance (doulas) fournissent du soutien non clinique et non médical auprès des nouvelles mères et de leur famille, de concert avec les praticiens de la santé comme les médecins, les sages-femmes et les infirmières. Le rôle des accompagnantes à la naissance n’est pas réglementé, et vise surtout à offrir un soutien affectif et informationnel. Celles-ci ne prodiguent pas de soins directs et ne prennent pas en charge les accouchements.
Il existe différents types d’accompagnantes à la naissance, selon les stades de la grossesse. D’abord, les accompagnantes antepartum offrent du soutien affectif, physique et informationnel au cours de la période prénatale, qu’il s’agisse de renseigner les futures mères et leur famille au sujet des groupes de soutien existants ou des techniques pour favoriser le confort physique, ou encore de les aider dans certaines tâches comme les courses ou la préparation des repas. Ensuite, les accompagnantes à la naissance se chargent d’épauler les nouvelles mères et leur partenaire durant le travail et l’accouchement, en leur fournissant notamment du soutien affectif et informationnel tout en favorisant leur confort sur le plan physique. Enfin, les accompagnantes post-partum soutiennent les nouvelles mères après la naissance du bébé, en leur fournissant de l’information au sujet de l’allaitement et des moyens d’apaiser le nourrisson, tout en se chargeant parfois de quelques tâches ménagères et de la garde des enfants.
Finalement, les spécialistes en périnatologie s’occupent des soins liés aux grossesses à haut risque (ex. : maladie chronique de santé maternelle, naissances multiples, diagnostics génétiques). Ces intervenants ont une formation d’obstétricien ou de gynécologue, doublée d’une spécialisation axée sur les grossesses à risque. Au besoin, les obstétriciens et gynécologues dirigent donc leurs patients vers ces spécialistes en périnatalogie, et travaillent de concert avec eux pour assurer le suivi de la santé maternelle.
Une réalité particulière : l’accouchement en régions rurales ou éloignées au Canada
Les soins de maternité posent des défis uniques en régions rurales ou éloignées (y compris dans les régions nordiques du Canada), et ce, parce que les installations médicales et les équipements spécialisés sont parfois éloignés sur le plan géographique, parce que les fournisseurs de soins ne bénéficient pas d’autant de soutien de leurs pairs, et parce qu’il y a moins de médecins disponibles sur appel pour réaliser des césariennes et des anesthésies (et aussi moins d’installations et de services que dans les centres urbains à cet effet).
En milieu rural, les soins de maternité sont généralement pris en charge par des équipes formées de médecins de famille, d’infirmières et de sages-femmes. Dans certaines collectivités, il s’agit d’ailleurs des seuls professionnels de la santé offrant des soins de maternité. De fait, les médecins de famille en milieu rural sont beaucoup plus susceptibles de devoir assurer des soins obstétricaux que leurs homologues des centres urbains. Depuis quelques décennies cependant, plusieurs collectivités rurales sont confrontées à la fermeture des maternités et à une baisse du nombre de médecins de famille offrant des soins de maternité.
Compte tenu du nombre limité de services et de fournisseurs de soins de maternité dans les régions rurales et éloignées, plusieurs femmes enceintes doivent donc se tourner vers les centres urbains pour accoucher. Selon un rapport publié en 2013 par l’Institut canadien d’information sur la santé, plus des deux tiers (67 %) des femmes des milieux ruraux au Canada disent avoir accouché dans un hôpital urbain, et 17 % d’entre elles ont dû faire plus de deux heures de route pour donner naissance à leur enfant. La proportion est encore plus élevée dans les régions nordiques, alors que les deux tiers des mères interrogées au Nunavut et la moitié de celles interrogées aux Territoires du Nord-Ouest disent avoir accouché hors de leur collectivité.
Les deux tiers des mères interrogées au Nunavut et la moitié de celles interrogées aux Territoires du Nord-Ouest disent avoir accouché hors de leur collectivité.
Or, cette réalité affecte le bien-être de plusieurs femmes autochtones des régions nordiques, dont plusieurs doivent même prendre l’avion pour se rendre dans un centre hospitalier afin d’y recevoir des soins de maternité secondaires ou tertiaires loin de leur foyer, de leur territoire, de leur collectivité et de leur environnement linguistique. (Voir l’encadré Les sages-femmes autochtones au Canada.) La plupart des mères interrogées admettent qu’avoir dû s’éloigner de leur foyer pour accoucher s’était avéré stressant et avait eu des répercussions sur leur famille. En avril 2016, le gouvernement fédéral a annoncé des compensations financières pour que les mères autochtones puissent être accompagnées d’un proche lorsque l’accouchement doit se produire loin de la collectivité.
Dans les régions nordiques, le nombre d’hôpitaux communautaires offrant des soins obstétricaux a chuté depuis les années 80. Toutefois, plusieurs centres de naissances ont ouvert leurs portes pour combler le déficit, comme à Puvirnituq (Nunavik), à Rankin Inlet (Nunavut) et à Inukjuak (Québec). Ces installations permettent aux femmes ayant une grossesse à faible risque d’accoucher dans leur propre collectivité. Toutefois, les mères nécessitant une césarienne ou présentant des risques de complications doivent quand même se déplacer pour donner naissance à leur enfant.

Une réalité particulière : les femmes enceintes et les nouvelles mères arrivées depuis peu au Canada
Le Canada accueille plusieurs familles d’immigrants, qui représentent une proportion grandissante de la population. En 1961, 16 % des habitants du Canada disaient être nés à l’étranger, et cette proportion atteignait 21 % en 2011.
L’immigration influence la maternité, notamment en ce qui a trait au moment choisi pour avoir un enfant. Les études montrent que les naissances sont généralement peu nombreuses chez les immigrants au cours des deux années avant leur arrivée, mais la fécondité « rebondit » ensuite la plupart du temps. Selon les chercheurs Goldstein et Goldstein, « les choix des arrivants en matière de fécondité répondent plus souvent aux tendances du pays d’accueil qu’aux préférences qui prévalaient dans leur pays d’origine avant leur départ » [traduction].
Des études ont exploré un certain nombre de raisons pour lesquelles la fécondité peut être affectée par l’expérience de l’immigration, notamment la séparation temporaire du conjoint pendant le processus de migration, le choix volontaire de repousser une grossesse jusqu’à l’admissibilité aux diverses mesures de soutien (ex. : allocations pour enfants), ainsi que les perturbations financières pendant la migration et au début de l’installation (jusqu’à ce que les parents trouvent un emploi rémunéré).
Par ailleurs, les immigrants récents sont beaucoup plus susceptibles que les Canadiens nés au pays de se retrouver dans un ménage multigénérationnel (abritant au moins trois générations). En 2011, 21 % des immigrants de 45 ans ou plus (arrivés au Canada entre 2006 et 2011) déclaraient vivre une telle cohabitation, contre seulement 3 % des Canadiens nés au pays. Par conséquent, les femmes enceintes et les nouvelles mères vivant au sein d’un ménage multigénérationnel bénéficient éventuellement de la présence de proches capables d’offrir des soins et du soutien.
En ce qui concerne l’accès aux soins de maternité, les études ont montré que, même si plusieurs immigrantes ont généralement accès aux soins de maternité dont elles ont besoin, leur taux de satisfaction à cet égard semble varier considérablement selon les régions du pays. En effet, plusieurs affirment avoir rencontré des obstacles liés à l’accès ou à l’utilisation des services de soins de maternité, notamment parce qu’elles n’avaient pas été suffisamment informées des services (parfois à cause de la barrière linguistique), parce qu’elles ne disposaient pas de soutien suffisant pour accéder aux services (c.-à-d. naviguer à l’intérieur du système de soins de santé), ou à cause d’une disparité entre les attentes des femmes immigrantes et celles des fournisseurs de services. Dans certaines régions, les femmes immigrantes bénéficient d’un précieux soutien affectif, informationnel et logistique de la part des accompagnantes à la naissance (doulas) durant la période périnatale.
Selon les parents immigrants, le soutien social (famille, amis et membres de la collectivité) représente un facteur crucial pour favoriser l’accès aux soins de maternité. En effet, ce cercle de soutien peut jouer un rôle important pour jeter des ponts entre les nouvelles ou futures mères provenant de l’extérieur du Canada et le réseau de soins de maternité. Parfois, ces personnes peuvent intervenir auprès des fournisseurs de services et de soins de santé pour s’assurer que les mères bénéficient de soins de maternité « conformes à leur culture et respectueux de leur réalité culturelle » [traduction].

Les soins de maternité : en appui aux familles en pleine croissance au Canada
La grossesse et l’accouchement sont des moments charnières de la vie, non seulement pour les nouvelles mères, mais aussi pour leur famille, leurs amis et leur collectivité. La réalité familiale a beaucoup changé depuis quelques générations en ce qui a trait à la grossesse, à l’accouchement et à la période postnatale, mais certaines constantes demeurent : la valeur et l’importance des soins de qualité, la diversité des expériences vécues dans les différentes régions du Canada, sans compter la joie et l’excitation qui caractérisent ce jalon mémorable et significatif de l’existence.
Téléchargez cet article en format PDF.
Le contenu de cet article a été révisé par Marilyn Trenholme Counsell, OC, MA, MD, médecin de famille à la retraite, ancienne lieutenante-gouverneure (Nouveau-Brunswick), ex-ministre de la Famille (N.-B.) et sénatrice (N.-B.).
Vous trouverez toutes les références et les sources d’information dans la version PDF de cet article.
Publié le 11 mai 2017