Annie Pullen Sansfaçon est titulaire d’un Ph. D. en éthique et travail social (de la Montfort University, RU, 2007) et s’intéresse aux approches antioppressives et à l’éthique depuis le tout début de sa carrière. À partir de ces thèmes, elle a développé un axe de recherche visant à mieux comprendre les expériences d’oppression et de résistance des jeunes présentant une diversité de genre, comme les jeunes trans et non binaires, les jeunes bispirituel·les et les jeunes qui détransitionnent, en vue de développer de meilleures pratiques pour les soutenir. Elle s’intéresse également au soutien parental et social, ainsi qu’à l’incidence de celui-ci sur ces différents groupes de jeunes. Les projets de recherche qu’elle dirige tant au niveau national qu’international ont été publiés dans de nombreux articles scientifiques et cinq livres sur la question. Elle a cofondé et codirige actuellement le Centre de recherche sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et l’équité (le CRI-JaDE), et est chercheuse associée à l’École de travail social de la Stellenbosch University en Afrique du Sud.
Topic : COVID-19
Gaëlle Simard-Duplain
Gaëlle Simard-Duplain est professeure adjointe au Département de sciences économiques de l’Université Carleton. Ses travaux de recherche portent sur les facteurs qui ont une incidence sur la santé et la situation sur le marché du travail. Elle s’intéresse particulièrement à la relation entre les politiques et l’atténuation ou l’exacerbation des inégalités chez les familles, à la fois dans la dynamique au sein des ménages et dans les mécanismes de transmission intergénérationnelle. Pour ce faire, elle a principalement recours à des sources de données administratives, parfois liées à des données d’enquête ou à des méthodes de recherche quasi expérimentales. Gaëlle est titulaire d’un doctorat en sciences économiques de l’Université de Colombie-Britannique.
Andrea Doucet
Andrea Doucet est titulaire de la Chaire de recherche du Canada (niveau 1) sur l’égalité entre les sexes, le travail et les soins, professeure de sociologie et d’études sur les femmes et le genre à l’Université Brock, et professeure associée à la fois à l’Université Carleton et à l’Université de Victoria (Canada). Elle a publié de nombreux ouvrages sur les politiques soins/travail, les politiques en matière de congé parental, la paternité et les soins, la division entre les sexes et le travail rémunéré et non rémunéré des parents. Elle est l’autrice de deux éditions du livre primé Do Men Mother? (Presses de l’Université de Toronto, 2006, 2018), coautrice de deux éditions du livre Gender Relations : Intersectionality and Social Change (Oxford, 2008, 2017), et coéditrice du livre Thinking Ecologically, Thinking Responsibly: The Legacies of Lorraine Code (SUNY, 2021). Elle écrit actuellement sur les soins socio-écologiques et les liens entre les congés parentaux, les congés liés aux soins et les services de base universels. Parmi ses récentes collaborations de recherche, elle a notamment participé à un projet sur l’expérience de la maternité chez les jeunes Noires avec Sadie Goddard-Durant et divers organismes communautaires canadiens; à un projet axé sur les approches féministe, écologique et autochtone en matière d’éthique de soins et de travail de soin, avec Eva Jewell et Vanessa Watts; ainsi qu’à un projet sur l’inclusion et l’exclusion sociales dans les politiques de congé parental, avec Sophie Mathieu et Lindsey McKay. Elle est directrice de projet et chercheuse principale du Programme canadien de partenariats de recherche du CRSH, Réinventer les politiques soins/travail, et co-coordinatrice du International Network on Leave Policies and Research.
Barbara Neis
Barbara Neis est professeure titulaire émérite de la Chaire John Lewis Paton et professeure-chercheuse honoraire (à la retraite) du Département de sociologie de l’Université Memorial. Barbara a obtenu son doctorat en sociologie à l’Université de Toronto en 1988. Elle s’intéresse principalement aux interactions entre le travail, l’environnement, la santé, les familles et les communautés dans les milieux marins et côtiers. Elle a cofondé et codirigé le SafetyNet Centre for Occupational Health and Safety à l’Université Memorial et a été présidente de l’Association canadienne de la recherche en santé et sécurité au travail. Depuis les années 1990, elle a mené, supervisé et soutenu d’importants programmes de recherche en collaboration avec l’industrie de la pêche à Terre-Neuve-et-Labrador, notamment dans les domaines suivants : les connaissances des pêcheurs, les sciences et la gestion marines, la santé et la sécurité au travail, la reconstruction des pêcheries effondrées, et le genre et la pêche. Entre 2012 et 2023, elle a dirigé le Partenariat en mouvement, financé par le CRSH, un vaste programme de recherche multidisciplinaire explorant la dynamique de la mobilité professionnelle prolongée/complexe liée à l’emploi dans le contexte canadien, notamment son incidence sur les travailleuses et travailleurs et leur famille, les employeurs et les communautés.
Yue Qian
Yue Qian (prononcé Yew-ay Chian) est professeure agrégée en sociologie à l’Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver. Elle a obtenu son doctorat en sociologie à la Ohio State University. Ses recherches portent sur le genre, la famille et le travail, et les inégalités dans une perspective mondiale, et mettent particulièrement l’accent sur l’Amérique du Nord et l’Extrême-Orient.
Coup d’œil sur la recherche : Résilience collective des familles grâce au jeu numérique des enfants pendant la pandémie
Faits saillants d’une étude sur le jeu numérique et son rôle dans le renforcement de l’autonomie, de la créativité et de la résilience des enfants pendant la pandémie de COVID-19
Coup d’œil sur la recherche : Parents, école à la maison et conflits relationnels pendant la pandémie de COVID-19
Conclusion d’une étude sur les effets de l’enseignement à domicile sur les parents pendant la pandémie de COVID-19
Recours aux prestations de paternité pendant la pandémie de COVID-19 : Premières constatations au Québec
Sophie Mathieu, Ph. D., et Marie Gendron, présidente-directrice générale du Conseil de gestion de l’assurance parentale, présentent de récentes données de recherche sur le recours au congé de paternité pendant la pandémie au Québec.
Le divorce au Canada : L’évolution de deux tendances
Nathan Battams présente de nouvelles données de recherche sur les tendances en matière de divorce au Canada au cours des 30 dernières années.
Les répercussions de la COVID-19 : Les mères réfugiées ou nouvellement établies au Canada – Rapport final
Rapport final sur les conclusions du sondage « Les répercussions de la COVID-19 : Les mères réfugiées ou nouvellement établies au Canada ».
L’IMPACT DE LA COVID-19 : Sondage auprès des thérapeutes familiaux – Rapport final
Rapport final sur les conclusions du sondage intitulé « L’IMPACT DE LA COVID-19 : Sondage auprès des thérapeutes familiaux »
Les histoires derrière les statistiques : Devenir un nouveau père pendant le confinement
Entretien avec un nouveau père au sujet de son parcours vers la paternité pendant le confinement.
En bref : L’IMPACT DE LA COVID-19 en fonction du genre
Diana Gerasimov résume les nouvelles données de recherche sur les répercussions de la pandémie selon le genre.
La prestation de soins pendant la pandémie de COVID-19 : Quelles leçons en avons-nous tirées? (Vidéo – en anglais seulement)
Alex Foster-Petrocco présente les éléments à retenir ainsi que les faits saillants d’un récent webinaire sur la prestation de soins et la technologie pendant la pandémie de COVID-19.
Rapport : Le bien-être des familles au Canada
Nouveau rapport sur le bien-être au Canada, corédigé par le personnel de Statistique Canada et de l’Institut Vanier.
En bref : Le point sur les répercussions sociales et économiques de la COVID-19 après un an
Série En bref de l’Institut Vanier : Mobiliser la recherche sur les familles au Canada
Diana Gerasimov
22 mars 2021
ÉTUDE : Statistique Canada, « La COVID-19 au Canada : le point sur les répercussions sociales et économiques après un an », StatCan et la COVID‑19 : Des données aux connaissances, pour bâtir un Canada meilleur, no 11‑631‑x2021001 au catalogue (11 mars 2021). Lien : https://bit.ly/3133veQ
La COVID-19 a entraîné des répercussions socioéconomiques importantes pour les familles partout au Canada. Cependant, comme l’a écrit Anil Arora, statisticien en chef du Canada, dans un récent bilan des tendances de l’année écoulée, « cela a été le moment pour nous de faire preuve de résilience, d’apporter notre contribution et d’être innovateurs. »
Les données recueillies au cours des 12 derniers mois offrent un aperçu de la manière dont les différents secteurs et groupes de population ont réagi à la pandémie, aux mesures de santé publique et aux confinements économiques, et de la façon dont ces derniers les ont affectés.
Le respect des mesures de santé publique par les Canadiens demeure stable
- Durant la première moitié de la pandémie, 90 % des Canadiens ont pris des précautions, notamment en adoptant le port du masque et la distanciation physique.
- En septembre 2020 :
- Plus de 95 % des Canadiens ont dit suivre les recommandations, comme se laver les mains, porter un masque et maintenir une distance physique.
- Quelque 12 % des Canadiens ont déclaré avoir ressenti des symptômes liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Parmi ce groupe, 93 % ont affirmé respecter les recommandations de la santé publique.
- Près de 7 personnes sur 10 (67 %) ont déclaré avoir évité de quitter la maison pour des raisons non essentielles.
La vaccination contre la COVID-19 a commencé le 13 décembre 2020 et s’adressait principalement aux groupes prioritaires, notamment les personnes de 80 ans et plus, les travailleurs de la santé et les personnes vivant dans des établissements de soins pour personnes âgées. Le 5 mars 2021, la proportion de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin au sein de ces groupes était respectivement de 19 %, 53 % et 85 %.
Malgré l’intensification des efforts de vaccination, moins de Canadiens sont très susceptibles de se faire vacciner contre la COVID‑19
- En juillet 2020, 58 % des Canadiens ont signalé être très susceptibles de se faire vacciner. En septembre 2020, ce pourcentage était passé à 48 %.
- Par ailleurs, 49 % des Canadiens étaient très peu susceptibles de se faire vacciner.
La vaccination est cruciale pour protéger les travailleurs de la santé, parmi lesquels les minorités visibles sont surreprésentées
Avant la pandémie, les minorités visibles étaient surreprésentées dans certains postes, comme aides-infirmiers, préposés aux bénéficiaires et associés au service de soins aux patients. Cette tendance s’est poursuivie pendant la pandémie : en janvier 2021, 19 % des Canadiens noirs occupaient un emploi et 20 % des Canadiens d’origine philippine travaillaient dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale.
La COVID-19 a eu des répercussions indirectes sur les soins de santé et la santé mentale
En raison de l’annulation de l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes par mesure de précaution face à la pandémie, les programmes de dépistage du cancer ont notamment été retardés. D’après un modèle de simulation du cancer, OncoSim, on prévoit une augmentation des cas de cancer une fois que le dépistage aura repris. Une suspension du dépistage pourrait accroître le nombre de cas diagnostiqués à un stade avancé ainsi que le nombre de décès des suites du cancer.
Avec l’assouplissement des restrictions et la réouverture des écoles, la santé mentale des Canadiens s’est améliorée.
- En novembre 2020, 62% des Canadiens ont déclaré être en excellente ou en très bonne santé mentale, en hausse par rapport à 55 % (juillet 2020) et tout près du niveau d’avant la pandémie, soit 68 % (2019).
Bien que la santé mentale globale des Canadiens se soit améliorée à la suite de l’assouplissement des restrictions, les travailleurs de la santé continuent de signaler une détérioration de leur santé mentale.
- Parmi eux, 33 % ont déclaré une très bonne ou une excellente santé mentale et 33 % ont déclaré une santé mentale passable ou mauvaise.
- En tout, 7 travailleurs de la santé sur 10 ayant participé à une collecte de données par approche participative ont déclaré une détérioration de leur santé mentale pendant la pandémie.
La COVID-19 a eu des répercussions inégales au Canada
La pandémie de COVID-19 a révélé l’inégalité de ses répercussions.
- Les secteurs comptant la plus forte proportion (25 % ou plus) de groupes de population désignés comme minorités visibles affichaient un taux de mortalité lié à la COVID-19 environ deux fois plus élevé que ceux comptant la proportion la plus faible (moins de 1 %).
- À l’été, 57 % des Autochtones interrogés ayant des maladies chroniques ont déclaré que leur état de santé global était « légèrement pire » ou « bien pire » qu’avant la pandémie.
- Aussi, 64 % des Autochtones ont déclaré que leur bien-être mental était « bien pire » ou « légèrement pire ».
Les répercussions disproportionnées de la COVID-19 sur les communautés autochtones pourraient intensifier les inégalités déjà observées. Avant la pandémie, le taux de chômage des Autochtones était 1,8 fois plus élevé que chez les non-Autochtones, ce qui témoigne des disparités de longue date qui existent au sein du marché du travail.
En décembre 2020, le taux de chômage chez les Autochtones était de 3 % à 4 % plus élevé que chez leurs homologues non autochtones.
La COVID-19 a eu des répercussions multiples sur le travail et le budget des familles
Malgré l’assouplissement des restrictions des mesures de santé pendant l’été et l’automne, l’activité économique est demeurée inférieure au niveau observé avant la pandémie. Les groupes de minorités visibles, les Autochtones, les travailleurs à faible rémunération et les jeunes Canadiens font partie des groupes qui sont touchés de façon inéquitable par les répercussions économiques de la COVID-19.
- Environ 4 travailleurs canadiens sur 10 occupent un emploi qui pourrait vraisemblablement être exercé à domicile.
- À la fin de 2020, la COVID-19 avait touché 1,1 million de travailleurs par le biais des pertes d’emploi ou des réductions importantes des heures travaillées.
- En janvier 2021, le nombre de Canadiens travaillant à domicile a augmenté de près de 700 000, atteignant 5,4 millions, ce qui dépassait les 5,1 millions de personnes qui travaillaient à domicile lors du premier confinement, en avril 2020.
- En janvier 2021, 512 000 travailleurs étaient des chômeurs de longue date, soit 27 % de l’ensemble des chômeurs. Cette proportion était inférieure à 16 % avant la pandémie de COVID-19.
Diana Gerasimov est titulaire d’un baccalauréat en communication et études culturelles de l’Université Concordia.
L’IMPACT DE LA COVID-19 : La famille et sa réalité, ses traditions et ses rituels
26 février 2021
Si la pandémie de COVID-19 a affecté les familles partout au Canada, perturbant ainsi nos habitudes, nos rôles et nos relations, elle n’a pas pour autant interrompu la vie familiale. Que ce soit pour se réunir afin de célébrer des étapes de vie importantes ou pour apporter du soutien dans les moments difficiles, les gens font preuve de créativité et de diversité pour continuer de faire ce que font les familles, souvent en ayant recours à la technologie.
Selon un récent sondage de la firme Léger1, certaines familles ont organisé leurs traditions, leurs célébrations et leurs rassemblements – qu’ils soient heureux ou tristes – par le biais de plateformes de vidéoconférence comme Zoom et Teams de Microsoft. Ces expériences ne font certes pas le poids face à la chaleur des câlins et des discussions en personne avec nos proches, mais ces adaptations permettent à plusieurs familles de continuer de sourire, de rire, de pleurer et de vivre leur deuil ensemble. Les données montrent que pour la plupart d’entre elles, ces réunions virtuelles sont moins significatives qu’en personne, mais pour beaucoup, elles valent quand même mieux que rien.
L’IMPACT DE LA COVID-19 : Le mariage et les noces
Dans les premiers mois de la pandémie, en raison des mesures de santé publique qui restreignaient les rassemblements en personne à l’échelle du Canada, plusieurs couples qui avaient prévu de se marier ont décidé de reporter leur projet de mariage. Mais avec le prolongement des restrictions relatives aux événements sociaux, certains ont décidé d’aller de l’avant et d’officialiser leur union de façon virtuelle, se réunissant avec leur famille et leurs amis à l’aide de plateformes de vidéoconférence.
Le sondage a révélé que :
- au cours de la dernière année, 7 % des répondants avaient assisté à un mariage par le biais d’une plateforme de vidéoconférence (ex. : Zoom, Teams de Microsoft);
- les répondants comptant des enfants dans leur ménage (13 %) étaient plus de deux fois plus susceptibles que ceux vivant sans enfant (5 %) d’avoir participé à un mariage en ligne;
- la probabilité d’avoir pris part à un mariage en ligne diminuait avec l’âge :
- 12 % des personnes de 18 à 34 ans;
- 8 % des personnes de 35 à 54 ans;
- 2 % des personnes de 55 ans et plus.
- parmi ceux qui ont assisté à un mariage en ligne, une légère majorité a affirmé que l’expérience leur a semblé moins significative qu’en personne; les répondants ayant des enfants ainsi que les jeunes étaient plus susceptibles d’indiquer qu’elle était plus significative.
- Un peu plus de la moitié (54 %) ont affirmé que l’expérience était moins significative, alors que 25 % ont dit qu’elle était « sensiblement pareille ». Toutefois, 21 % ont trouvé cette expérience « plus significative »;
- Les répondants comptant des enfants dans leur ménage (32 %) étaient plus de deux fois plus susceptibles que ceux n’ayant pas d’enfant (12 %) de déclarer que cette expérience était plus significative;
- La probabilité d’affirmer que l’expérience était plus significative diminuait fortement avec l’âge :
- 32 % des personnes de 18 à 34 ans;
- 14 % des personnes de 35 à 54 ans;
- 0 % des personnes de 55 ans et plus.
L’IMPACT DE LA COVID-19 : Le deuil et le sentiment de perte
Les familles vivent également leurs deuils en ligne, alors que plusieurs d’entre elles tiennent des funérailles sur les plateformes de vidéoconférence (ex. : Zoom, Teams de Microsoft). Les répondants au sondage étaient deux fois plus susceptibles de déclarer avoir participé à des funérailles en ligne (14 %) qu’à un mariage en ligne (7 %).
- Environ 1 Canadien interrogé sur 7 (14 %) a déclaré avoir participé à des funérailles sur une plateforme de vidéoconférence au cours de la dernière année.
- Les répondants comptant des enfants dans leur ménage (16 %) étaient plus susceptibles que ceux n’ayant pas d’enfant (13 %) d’avoir pris part à des funérailles en ligne.
- La probabilité d’avoir participé à des funérailles en ligne augmentait avec l’âge :
- 12 % des personnes de 18 à 34 ans;
- 14 % des personnes de 35 à 54 ans;
- 16 % des personnes de 55 ans et plus.
- Lorsqu’on a demandé aux répondants ayant assisté à des funérailles en ligne dans quelle mesure leur expérience leur a semblé significative comparativement à des funérailles en personne :
- plus du tiers ont répondu que cette expérience était « sensiblement pareille » (25 %) ou « plus significative » (9 %), alors que les deux-tiers restants (66 %) ont confié qu’elle était « moins significative »;
- les répondants comptant des enfants dans leur ménage (14 %) étaient deux fois plus susceptibles que ceux vivant sans enfant (7 %) d’affirmer que cette expérience était plus significative;
- le groupe d’âge le plus jeune était le plus susceptible de déclarer que cette expérience était plus significative :
- 17 % des personnes de 18 à 34 ans;
- 4 % des personnes de 35 à 54 ans;
- 8 % des personnes de 55 ans et plus.
Afin de maintenir des liens familiaux solides pendant la pandémie de COVID‑19, il est fondamental de faire preuve d’adaptabilité et de créativité. Même si ce sondage a montré clairement que les familles s’ennuient de leurs rassemblements en personne, l’adaptation virtuelle des mariages, des funérailles et d’autres réunions de famille se poursuivra, dans une forme ou une autre, après la pandémie de COVID‑19 (peut-être en parallèle aux événements en personne), car elles permettent aux membres de la famille et aux amis qui vivent loin de garder le contact et de vivre les événements familiaux importants avec leurs proches.
Note
- Un sondage a été mené par la firme Léger pour le compte de l’Association d’études canadiennes les 12 et 13 février 2021 auprès de 1 535 répondants. Alors qu’aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste, l’échantillon national de 1 535 répondants aurait, à des fins comparatives, une marge d’erreur de ±2,5 %, et ce, 19 fois sur 20.
Célébrer la famille choisie au sein de la communauté LGBTQ+
Gaby Novoa
18 février 2021
Le 22 février 2021, c’est le jour de la Famille choisie, soit l’occasion de célébrer les relations significatives entre les membres de la communauté LGBTQ+ à l’échelle nationale1, 2. Les familles formées par choix, et de façon délibérée, jouent un rôle fondamental dans la vie de nombreuses personnes LGBTQ+, alors que s’y inscrivent des relations étroites procurant soins, affirmation et sentiment d’appartenance.
Les études démontrent que la marginalisation due à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre d’une personne est liée à des taux plus élevés de rejet familial, de problèmes de santé mentale, de toxicomanie et d’exposition à la violence chez les personnes LGBTQ+, comparativement à leurs homologues hétérosexuels et/ou cisgenres3. Ces vulnérabilités sont encore plus importantes chez les personnes présentant une identité intersectionnelle sur le plan notamment de la race, de la classe sociale, de la religion ou des capacités/incapacités. Les familles choisies, les amitiés et les liens communautaires positifs sont donc essentiels, puisque les relations sociales sont des facteurs clés du bien-être et de la résilience4.
Les familles choisies se heurtent à davantage d’obstacles bien qu’elles remplissent des rôles sensiblement similaires à ceux des familles biologiques
La Fondation Émergence, un organisme à but non lucratif du Québec qui s’emploie à soutenir et à servir la communauté LGBTQ+ par l’éducation et la sensibilisation, fait valoir l’importance de la famille choisie5. Julien Rougerie, chargé de programmes pour l’organisme, soutient que les rôles au sein des familles choisies et biologiques sont souvent identiques : fournir de l’amour, du soutien, des soins et des relations.
Toutefois, la différence pour les familles qui ne sont pas unies par les liens du sang est que leurs rôles sont souvent entravés par davantage d’obstacles, à commencer par le manque de reconnaissance formelle de leurs liens comme étant valides ou « légitimes ». À titre d’exemple, des recherches ont montré que les personnes âgées LGBTQ+ vivant dans des maisons de soins de longue durée ne parviennent pas toujours à obtenir les accès ou les autorisations nécessaires pour voir leurs proches lorsque les protocoles et les règlements en vigueur ne s’appliquent pas à ceux et celles dont le statut familial ne cadre pas avec l’image traditionnelle que l’on se fait de la famille et des membres qu’elle comporte. De plus, la crainte de révéler son orientation sexuelle peut conduire une personne à taire l’identité de son partenaire ou de son conjoint. Lorsque les institutions, comme les systèmes de soins de santé ou de soins de longue durée, ne reconnaissent pas ces diverses formations familiales, elles bloquent la voie aux soins et à des liens pourtant essentiels.
Une étude a révélé qu’en dehors de leur partenaire, 59 % des adultes gais/lesbiennes et bisexuels âgés de 50 ans et plus se tournent de prime abord vers leurs amis en cas d’urgence, alors que seulement 9 % d’entre eux contactent plutôt un « membre de la famille »6. M. Rougerie souligne que les personnes âgées LGBTQ+ souffrent souvent de l’éloignement de leur famille biologique ou de la rupture avec celle-ci, alors qu’elles ont grandi dans un contexte socioculturel et politique ouvrant la porte à davantage de stigmatisation et de sanctions autour d’une sexualité « hors norme ». La dépendance et l’interdépendance avec la famille choisie revêtent donc une signification particulière chez les personnes âgées LGBTQ+, pour qui les aidants à un âge avancé sont souvent des membres de leur famille choisie.
La famille choisie et le bien-être sont interreliés
En prévision du jour de la Famille choisie, l’Institut Vanier a demandé aux personnes s’identifiant en tant que LGBTQ+ d’exprimer ce que signifient de tels liens à leurs yeux. Un grand nombre de réponses et de réflexions ont mis en relief les notions de réconfort, de sécurité et de force :
« Ma famille choisie prend de plus en plus d’importance dans ma vie. Elle me donne l’impression de vivre une certaine fraternité, de la confiance et de la camaraderie. Elle permet de bâtir des réseaux qui sont solides, comme le sont les points d’attache et les spirales d’une toile d’araignée. »
« Pour moi, la famille choisie est la communauté de soutien dont on s’entoure. Ce sont les relations les plus étroites qu’on entretient – quelle que soit leur nature – et qui font qu’on se sent vraiment chez soi. »
« La famille choisie est sincère, saine, sécuritaire, forte, pleine de ressources, d’émotions, d’habitudes. C’est une communauté, une création qu’on partage (par l’alimentation notamment), une communion et un rituel. »
« Pour moi, la famille choisie, c’est un groupe de personnes vers lesquelles on peut se tourner quand on est confronté à des difficultés ou qu’on a quelque chose à célébrer, des personnes sur qui on peut compter sans qu’elles portent de jugement, surtout lorsqu’il s’agit d’orientation sexuelle et de questions qui touchent les fréquentations ou l’identité de genre. Il ne s’agit pas vraiment d’être toujours ensemble ou même d’être les meilleurs amis, mais plutôt de savoir qu’on peut se confier à quelqu’un et trouver du réconfort auprès de lui, et être certain qu’on nous aime pour ce qu’on est EN PLUS DE notre côté queer, et non pas malgré lui. »
« La famille choisie signifie qu’il reste toujours une place, et que celle-ci est pour toi. »
« Pour moi, la famille choisie, c’est réclamer quelque chose que tu n’avais pas auparavant. »
« Avoir une famille choisie est une extension de l’amour qu’on a envers soi. Choisir de m’entourer de personnes qui m’aiment et me soutiennent est la meilleure façon de me reconnaître et de me valoriser. »
« La famille choisie est comme une grande réunion de famille, mais sans chaises inconfortables, sans ambiance pénible (chargée de secrets) et sans règles tacites étranges sur ce qu’on peut ou ne peut pas dire. Il s’agit plutôt d’un ensemble de personnes qui entrent et sortent de ma vie. Je me tourne vers eux et ils sont là pour moi. Tout n’y est pas rose : ils m’apprennent des choses difficiles (notamment comment éviter la jalousie et comment faire mon deuil). Dans les bons moments comme dans les moments difficiles, je me sens privilégié d’avoir la famille que j’ai choisie. »
« La famille choisie est un lieu sans jugement. Un endroit où on se sent en sécurité et fidèle à soi-même. C’est un endroit “où on n’a pas besoin de se faire tout petit, de faire semblant ou de jouer la comédie”7. »
« La famille choisie est celle qui vous aide à maintenir un climat de paix dans lequel vous pouvez vous montrer sous votre vrai jour. »
« Pour moi, une famille choisie est avant tout une famille liée par la confiance et une sorte de loyauté toute simple parce qu’elle reconnaît et anticipe le changement et la croissance. »
[traductions]
Nos sincères remerciements à ceux et celles qui ont accepté de partager leurs réflexions.
Gaby Novoa, Carrefour du savoir sur les familles au Canada, Institut Vanier de la famille
Notes
- Friends of Ruby – un organisme de soutien axé sur le bien-être progressif des jeunes LGBTQI2S par le biais de services sociaux et d’aide au logement – a lancé le jour de la Famille choisie en février 2020. Lien : https://www.friendsofruby.ca/
- Nathan Battams, « Entretien avec Lucy Gallo au sujet des jeunes LGBTQI2S et du jour de la Famille choisie », L’Institut Vanier de la famille (février 2020).
- Jonathan Garcia et autres, « Social Isolation and Connectedness as Determinants of Well-Being: Global Evidence Mapping Focused on LGBTQ Youth » dans Global Public Health (octobre 2019). Lien : https://bit.ly/3p8BCMg
- Ibidem
- Fondation Émergence. Lien : https://bit.ly/3aeMS5F
- Fondation Émergence, « Assurer la bientraitance des personnes aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans » (2018). Lien : https://bit.ly/3psjb5n
- Les mots cités sont une traduction des paroles de la chanson « Family » de Blood Orange.
L’IMPACT DE LA COVID‑19 : Les relations de couple au Canada
Ana Fostik, Ph. D.
9 octobre 2020
Lorsque les milieux professionnels et les écoles ont fermé en mars 2020 en vue d’atténuer la propagation de la COVID-19, la vie de famille dans l’ensemble du Canada a été grandement bouleversée. Ce contexte particulier a intensifié la tension au sein des couples, alors que bon nombre d’entre eux se sont retrouvés confinés ensemble 24 h/24, 7 j/7 – parfois avec des enfants – tout en devant rapidement adapter leur domicile afin de partager des espaces de travail et/ou d’apprentissage. Compte tenu de ces ajustements à la fois importants et imprévus par rapport à la vie professionnelle et familiale, en plus des incertitudes et des craintes persistantes liées au coronavirus lui-même, certains se sont demandé si les effets de la COVID-19 pourraient entraîner une hausse des taux de séparation et de divorce.
Des millions de familles ont dû demeurer à la maison pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de COVID-19. Or, pour de nombreux parents d’enfants d’âge scolaire, cela impliquait qu’ils scolarisent eux-mêmes leurs enfants tout en continuant de travailler à domicile, en plus de devoir partager les ressources (p. ex. : bureaux de travail, bande passante Internet). D’autres ont pour leur part dû faire face au chômage ou à une baisse de revenus, et se sont retrouvés à passer beaucoup plus de temps que d’habitude avec leur partenaire ou leur conjoint. Chez les couples hétérosexuels, l’inégalité des rôles entre les sexes au sein du ménage a également pu être amplifiée dans un contexte où ils passent plus de temps ensemble : des conflits sur la répartition du travail rémunéré et non rémunéré ont pu ainsi survenir, et ce, particulièrement chez ceux qui doivent scolariser leurs enfants à la maison tout en continuant à travailler à domicile.
Le contexte de la pandémie a diverses répercussions sur les couples
Les recherches ont démontré que les périodes de stress peuvent accroître les tensions dans les relations de couple, alors que les difficultés économiques ont été identifiées comme une source de conflit au sein de ceux-ci (couples mariés et en cohabitation)1. Ainsi, étant donné que la pandémie a eu des incidences sur le marché du travail et les finances familiales dans tout le pays, la dissolution des couples pourrait connaître une hausse.
Lorsqu’interrogée sur les conséquences possibles de la pandémie sur la stabilité des relations de couple, Céline Le Bourdais, professeure émérite en sociologie de la chaire James McGill, soutient que les effets sur les couples peuvent être négatifs, mais qu’ils peuvent également être positifs2. Ainsi, chez ceux qui disposaient de peu de temps ensemble avant l’adoption des mesures de santé publique et des restrictions en matière de mobilité, celle-ci suggère qu’il pourrait y avoir un effet positif sur leur relation, dans la mesure où la pandémie amènerait les deux partenaires à travailler à domicile – à condition qu’ils aient tous deux accès aux ressources adéquates et à l’espace nécessaire pour s’y adonner. Pour d’autres, toutefois, le confinement à la maison dans ce contexte incertain pourrait avoir créé de nouvelles tensions ou eu pour effet d’intensifier d’anciens conflits.
Cela pourrait notamment être le cas des couples et des familles dont l’espace à la maison est restreint, ainsi que de ceux qui ont de faibles revenus. Mme Le Bourdais souligne également que la pandémie pourrait avoir compliqué la vie de couple des personnes « vivant chacun chez soi », c’est-à-dire les couples dont les membres vivent dans des logements séparés (soit 9 % des personnes de 25 à 64 ans en couple en 2017)3. Le défi aurait en outre été encore plus grand pour les couples dont les membres demeuraient dans des régions différentes entre lesquelles les mouvements étaient limités en vertu des mesures de santé publique.
Selon Benoît Laplante, professeur de démographie familiale à l’Institut national de la recherche scientifique de Montréal, « les tensions vont augmenter dans les couples, c’est certain. Est-ce que ça va se manifester rapidement par des ruptures dans des conditions où il est difficile de déménager, de se trouver un nouvel appartement, difficile de mettre sa maison en vente? C’est embêtant4 .» En d’autres termes, si l’augmentation du stress et des conflits au sein du ménage peut accroître la probabilité que les couples envisagent une séparation ou un divorce, les conditions socioéconomiques peuvent pour leur part compliquer la logistique associée à la dissolution de leur union.
Chômage et instabilité au sein du couple : une relation complexe
L’une des principales conséquences des mesures de confinement est l’augmentation fulgurante des taux de chômage – du jamais-vu pour les générations actuelles – touchant 14 % des adultes sur le marché du travail en mai 20205. Des recherches antérieures ont mis en relief un effet en apparence contradictoire du chômage sur la stabilité des unions : en moyenne, les risques de séparation d’un couple augmentent lorsque l’un des partenaires se retrouve au chômage. (Chez les couples hétérosexuels, cela se produit plus souvent lorsque c’est le partenaire masculin qui se retrouve au chômage.) Toutefois, alors que notre société connaît dans l’ensemble des taux de chômage élevés, on constate que les taux de séparation et de divorce stagnent, voire diminuent.
Des recherches effectuées dans 30 pays d’Europe et aux États-Unis entre 2004 et 2014 ont clairement montré que lorsque les hommes de couples hétérosexuels se retrouvent au chômage, les risques qu’ils divorcent augmentent6, 7. Des recherches réalisées aux États-Unis entre 1980 et 2005 ont pour leur part révélé que les taux de chômage selon les États étaient associés de façon négative à la séparation et au divorce (en tenant compte de plusieurs caractéristiques de chacun des États et des effets de la période)8. Ainsi, à mesure que le chômage dans les États augmentait, les taux de séparation et de divorce diminuaient.
Lors de l’étude d’une période légèrement différente (de 1976 à 2009), mais toujours aux États-Unis, Mmes Hellerstein et Sandler Morrill ont quantifié l’effet négatif du chômage sur le taux de divorce selon les États et constaté qu’une augmentation de 1 point de pourcentage du chômage était associée à une diminution du taux de divorce de 1 %9.
Des résultats similaires ont été obtenus lors de l’étude de 29 pays d’Europe entre 1991 et 2012 : une augmentation du chômage a été associée à une diminution du taux de divorce dans ces pays (en tenant compte de plusieurs variables, tant sur le plan individuel qu’à l’échelle du pays), bien que l’effet ne soit pas très important – celui-ci n’étant lié qu’à environ 1,2 % du taux de divorce moyen au cours de cette période10. Par ailleurs, dans le cadre d’une autre étude portant sur les tendances au Canada entre 1976 et 2011 chez les personnes de 25 à 64 ans, une telle association entre les taux de chômage et le divorce et la séparation n’a pas pu être établie.
Plusieurs séparations et divorces sont retardés en périodes de difficultés économiques
Ce qui de prime abord peut sembler paradoxal – à savoir la baisse des taux de divorce lors de conjonctures économiques difficiles, alors que les couples seraient soumis à un stress accru – pourrait être en partie dû au coût que représente le divorce ou aux aspects connexes à la fin d’une relation de couple.
Une étude ayant analysé l’effet du niveau de revenus sur la probabilité des divorces aux États-Unis entre 1979 et 2009 a révélé que plus les revenus augmentaient, plus le taux de divorce dans chaque État augmentait également11. Des données plus récentes concernant les États-Unis montrent que les taux de divorce au pays ont diminué pendant la Grande Récession de 2008 : au cours de la période de 2009 à 2011, les chercheurs ont estimé qu’environ 4 % des divorces qui auraient autrement été enregistrés n’ont pas eu lieu – toutefois, par la suite, les taux de divorce sont revenus à leur niveau précédent12. Cela pourrait indiquer que les divorces sont simplement reportés lors de moments difficiles financièrement, sans pour autant être évités13. Les chercheurs présument donc que les coûts associés au divorce (p. ex. : les frais de justice, le besoin d’un nouveau logement ou la perte de revenus au sein du ménage) sont trop élevés lorsque la situation économique se révèle moins favorable pour que de nombreuses personnes envisagent une séparation ou un divorce14.
Au cours de la Grande Dépression de 1929, on a également assisté à une baisse des taux de divorce (entre 1930 et 1933) et à une augmentation subséquente de ceux-ci (de 1934 jusqu’au milieu des années 1940)15, ce qui, selon le sociologue et démographe de la famille Andrew Cherlin, peut être interprété comme un simple report pour des raisons économiques16. En effet, les taux de divorce au cours d’une année donnée sont influencés par le moment auquel le divorce est envisagé; par conséquent, toute baisse des taux de divorce observée pourrait simplement indiquer un report des séparations lors de périodes plus difficiles sur le plan économique17, les individus étant confrontés à l’incertitude quant à leurs perspectives économiques et financières futures. Une étude sur les liens entre les cycles économiques et les taux de divorce aux États-Unis de 1978 à 2009 a conclu que les effets négatifs des récessions sur le divorce dans ce pays étaient effectivement temporaires plutôt que permanents18.
Les données empiriques confirment donc un lien entre l’économie et l’attitude face au divorce : lorsque l’économie stagne ou connaît un ralentissement, les taux de divorce et de séparation en font autant. C’est particulièrement le cas dans les pays où les taux de divorce étaient déjà élevés avant le ralentissement économique19. Cela peut indiquer que la perception qu’ont les gens de la situation économique influence leur décision de divorcer ou de se séparer, même s’ils ne sont pas directement touchés par ledit bouleversement économique20.
Une nouvelle recherche afin de faire la lumière sur la complexité des répercussions sur la vie de famille
Lorsqu’on lui a demandé comment se portaient les couples au Canada, M. Laplante a répondu : « Il est très difficile de le savoir… » Bien que les conflits puissent être appelés à s’intensifier, cela ne signifie pas nécessairement qu’un plus grand nombre de personnes se sépareront ou divorceront, du moins à court terme, alors que les couples au Canada ont été confrontés au même type de tensions économiques qu’aux États-Unis pendant la récession de 2008. Il insiste sur le fait qu’aux États-Unis, moins de couples se sont séparés au cours de cette période, ceux-ci étant nombreux à ne pas avoir eu les moyens de le faire, certains partageant notamment une hypothèque.
Afin de mieux comprendre le phénomène, M. Laplante travaille sur un projet qui devrait lui permettre d’évaluer si les changements dans la composition des ménages, y compris le départ d’un conjoint ou d’un partenaire, ont été plus importants après le mois de mars 2020 qu’au cours des années précédentes au Canada. Il compare son initiative à celle qui consiste à estimer la surmortalité pendant la période associée à la COVID-19 en vue d’évaluer l’ampleur de la pandémie. Ainsi, il évaluera si « un nombre plus important ou une diminution du nombre de ruptures » peut être observé au Canada au cours de la période de pandémie, comparativement aux années précédentes.
Les relations, comme celles que vivent les familles, sont diverses et complexes, et les couples ont dû s’adapter et réagir à un contexte unique et en constante évolution tout au long de l’année 2020, parfois tout en élevant des enfants. Bien qu’il soit encore trop tôt pour avoir une idée précise de l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur les taux de séparation et de divorce au Canada, de nouvelles recherches continueront à guider ceux qui s’emploient à étudier, à servir et à soutenir les familles.
Ana Fostik, Ph. D., Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Notes
- J. Halliday Hardie et A. Lucas, « Economic Factors and Relationship Quality Among Young Couples: Comparing Cohabitation and Marriage » dans Journal of Marriage and Family, vol. 72, no 5 (2010), p. 1141-1154.
- C. Le Bourdais (17 juin 2020). Communication personnelle [courriel].
- Statistique Canada, « Histoire de famille : les couples vivant chacun chez soi » dans Infographies, no 11-627-M au catalogue de Statistique Canada. Lien : https://bit.ly/2GJDIl1
- B. Laplante (26 mai 2020). Entretien individuel [entretien individuel]. Révisé dans un souci de clarté.
- Statistique Canada, « Enquête sur la population active, mai 2020 » dans Le Quotidien (5 juin 2020). Lien : https://bit.ly/2I0RL6D
- P. Gonalons-Pons et M. Gangl, Why Does Unemployment Lead to Divorce? Male-Breadwinner Norms and Divorce Risk in 30 Countries (CORRODE Working Paper #6) [Frankfurt: Goethe University, 2018]. Lien : https://bit.ly/2F2QE5f (PDF)
- H. Ariizumi, Y. Hu et T. Schirle, « Stand Together or Alone? Family Structure and the Business Cycle in Canada » dans Review of Economics of the Household, vol. 13, no 3 (2015), p. 135-161.
- P. Amato et B. Beattie, « Does the Unemployment Rate Affect the Divorce Rate? An Analysis of State Data 1960–2005 » dans Social Science Research, vol. 40, no 3 (2011), p. 705-715.
- J. K. Hellerstein et M. Sandler Morrill, « Booms, Busts, and Divorce » dans The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, vol. 11, no 1 (2011).
- R. González-Val and M. Marcén, « Divorce and the Business Cycle: A Cross-Country Analysis » dans Review of Economics of the Household, vol. 15, no 3 (2017), p. 879-904.
- A. Chowdhury, « ’Til Recession Do Us Part’: Booms, Busts and Divorce in the United States » dans Applied Economics Letters, vol. 20, no 3 (2013), p. 255–261.
- P. N. Cohen, « Recession and Divorce in the United States, 2008–2011 » dans Population Research and Policy Review, vol. 33, no 5 (2014).
- B. Ambrosino, « Recent U.S. Divorce Rate Trend Has ‘Faint Echo’ of Depression-Era Pattern », Johns Hopkins University (2014). Lien : https://bit.ly/2Pgln0h
- Amato et Beattie, « Does the Unemployment Rate Affect the Divorce Rate? An Analysis of State Data 1960–2005 ».
- R. Schoen et V. Canudas-Romo, « Timing Effects on Divorce: 20th Century Experience in the United States » dans Journal of Marriage and Family, vol. 68, no 3 (2006), p. 749-758.
- Ambrosino, « Recent U.S. Divorce Rate Trend Has ‘Faint Echo’ of Depression-Era Pattern ».
- Schoen et Canudas-Romo, « Timing Effects on Divorce: 20th Century Experience in the United States ».
- J. Schaller, « For Richer, If Not for Poorer? Marriage and Divorce Over the Business Cycle » dans Journal of Population Economics, vol. 26, no 3 (2013), p. 1007-1033.
- González-Val and Marcén, « Divorce and the Business Cycle: A Cross-Country Analysis ».
- T. Fischer et A. C. Liefbroer, « For Richer, for Poorer: The Impact of Macroeconomic Conditions on Union Dissolution Rates in the Netherlands 1972–1996 » dans European Sociological Review, vol. 22, no 5 (2006), p. 519-532. Lien : https://bit.ly/36Dai2U
L’IMPACT DE LA COVID-19 : La retraite et le budget de la famille au Canada
Edward Ng, Ph. D.
3 septembre 2020
La COVID-19 a eu d’importantes répercussions sur le marché du travail, la vie professionnelle et le budget de la famille au Canada. En raison des mesures de santé publique et de la crise économique, bon nombre d’organismes et d’entreprises des quatre coins du pays ont rapidement mis à pied certains de leurs employés ou leur ont fait faire une transition vers le télétravail. Cela a fait grimper le taux de chômage de 8 % à 14 % entre les mois de mars et de mai 2020, soit le plus haut pourcentage jamais enregistré depuis 19761, date depuis laquelle des données comparables sont disponibles. Un sondage mené du 10 au 12 avril 2020 par la firme Léger, l’Association d’études canadiennes (AEC) et l’Institut Vanier de la famille a révélé que plus du tiers des Canadiens de 18 ans et plus ont éprouvé des difficultés financières en lien avec la pandémie de COVID-19 (c.-à-d. perte d’emploi temporaire ou permanente, perte de salaire ou de revenus)2.
Or, ces nombreuses incertitudes sur le marché du travail peuvent avoir des effets importants sur les aspirations de nombreuses familles, comme le projet d’acheter une maison, d’avoir un enfant3 ou de poursuivre des études postsecondaires. Ce contexte a également eu une incidence sur la retraite, les préretraités comme les retraités ayant dû s’adapter et réagir à l’évolution de la situation afin de soutenir leur famille. La condition des retraités est toutefois unique en ce qui touche les répercussions financières de la COVID-19, car ils ne font pas partie de la population active, et les aînés ont accès à d’autres formes de soutien du revenu. Comme leur capacité de fournir un soutien financier à la famille est déterminée par leur situation financière personnelle, le fait de mieux comprendre leur réalité et les expériences qui leur sont propres apportera certainement un éclairage sur cet aspect des effets de la COVID-19 sur les familles au Canada.
Les projets de retraite sont déterminés par le budget de la famille et l’aide disponible
Alors qu’une proportion croissante de Canadiens demeure sur le marché du travail passé la cinquantaine et au-delà de l’âge traditionnel de la retraite, à savoir 65 ans, le nombre de personnes retraitées a globalement augmenté en raison du vieillissement de la population. Selon Statistique Canada, l’âge moyen à la retraite pour l’ensemble des travailleurs au Canada était de 64,3 ans en 2019. Cela dit, de nombreux Canadiens âgés continuent de travailler bien au-delà de la soixantaine. En 2017, près du tiers des Canadiens de 60 ans et plus disaient avoir travaillé (ou désiré travailler) au cours de l’année précédente, la moitié d’entre eux (49 %) affirmant l’avoir fait (ou souhaité) « par nécessité »4.
Avant la pandémie de COVID-19, quantité de Canadiens exprimaient déjà des inquiétudes quant à leur préparation financière à la retraite. Selon l’Enquête canadienne sur les capacités financières de 2019, 69 % des Canadiens qui ne sont pas encore à la retraite s’y préparent financièrement, que ce soit par leurs propres moyens ou par l’intermédiaire d’un régime de pension de leur employeur5. Par ailleurs, plus du tiers des Canadiens de 55 ans et plus interrogés ont dit craindre de ne pas avoir suffisamment d’économies (37 %) ou de ne pas être en mesure de couvrir leurs dépenses en soins de santé en vieillissant (34 %)6.
Les retraités âgés ont accès à un soutien du revenu par l’entremise de prestations du régime de pension du gouvernement, qui sont offertes à tous les Canadiens de 65 ans qui vivent au pays depuis au moins 10 ans. En plus des régimes de retraite privés, de l’épargne-retraite ou de placements de retraite personnels, les régimes publics de soutien au revenu pour les aînés, tels que la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), le Supplément de revenu garanti (SRG) et le Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec, fournissent aux retraités âgés canadiens des sources de revenu fixes et relativement stables qui peuvent les aider à se protéger en contexte d’instabilité économique, comme le bouleversement économique entraîné par la pandémie de COVID-19.
En mai 2020, en raison du stress financier imposé aux retraités et aux aînés, le gouvernement fédéral a fait l’annonce d’une aide financière supplémentaire pour les aînés, soit le versement d’un paiement unique de 500 $ à ceux et celles qui reçoivent à la fois la SV et le SRG, afin de les aider à assumer les coûts supplémentaires attribuables à la crise sanitaire7.
Les placements des retraités sont touchés, mais le budget de la famille se porte mieux
Un sondage mené par la firme Léger, l’AEC et l’Institut Vanier de la famille au début du mois de mai a fourni l’un des premiers aperçus des répercussions financières de la pandémie sur les retraités8. Parmi les répondants, seul 1 retraité sur 59 a dit avoir subi des pertes de revenus en raison de la crise de la COVID-19, comparativement à près de la moitié (47 %) des préretraités (figure 1).
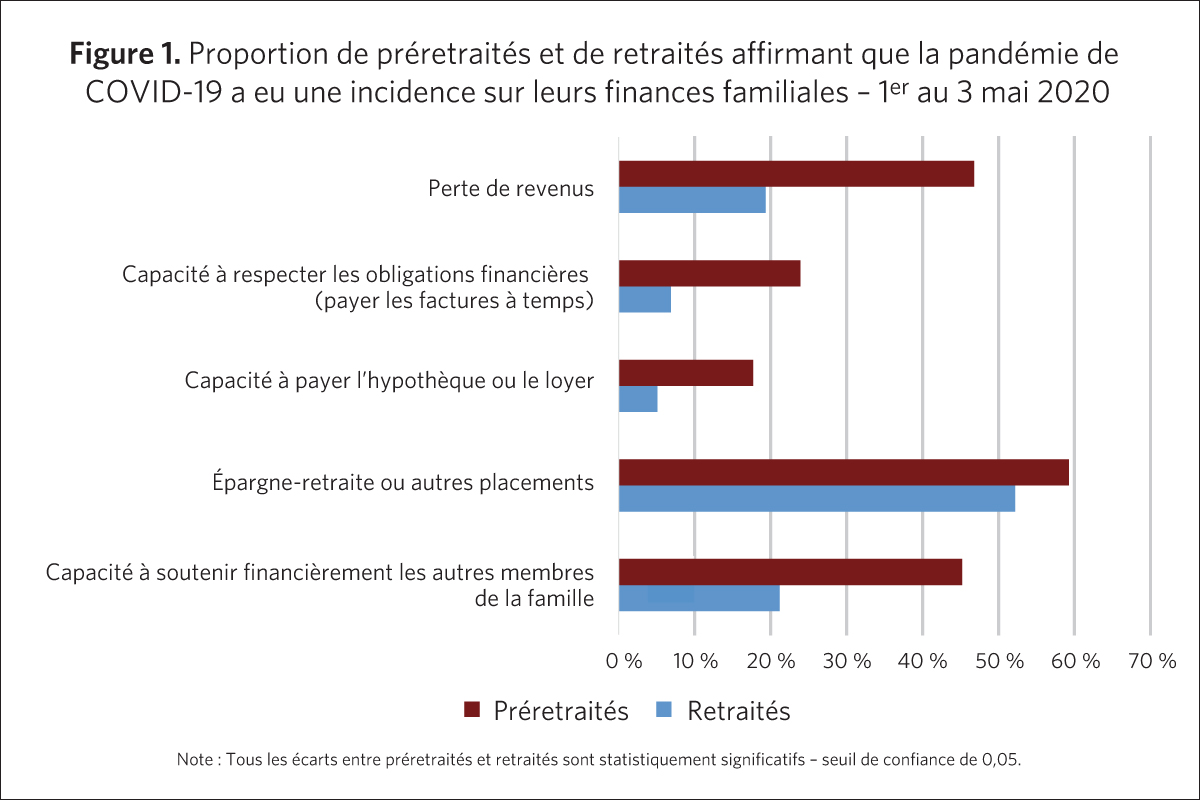
Les données du sondage ont en fait démontré que certains (7 %) retraités éprouvent des difficultés à respecter leurs obligations financières, comme le paiement de factures, ce qui est également le cas de près de 1 préretraité sur 4 (24 %). De même, 1 retraité sur 20 (5 %) dit avoir de la difficulté à payer son hypothèque ou son loyer, contre près de 1 préretraité sur 5 (18 %).
Si les retraités ont accès aux programmes publics de soutien du revenu, nombre d’entre eux ont également accès à d’autres sources de revenus émanant notamment de l’épargne ou d’autres placements. (En 2015, 50 % des aînés au pays ont dit recevoir des revenus de placements)10. La pandémie de COVID-19 a engendré des incertitudes et des turbulences sur les marchés financiers qui ont ajouté un stress considérable sur les investisseurs en général, et c’est en ce sens que les retraités ont été le plus durement touchés. Selon les données du sondage, plus de la moitié (52 %) des retraités ont fait état d’une incidence négative sur leur épargne-retraite ou d’autres placements, bien que cette incidence ait été plus importante chez les préretraités (59 %).
Les retraités apportent un soutien financier aux autres membres de leur famille
La famille procure une certaine forme d’assurance contre les chocs financiers soudains. Ainsi, étant donné que certains retraités ont été moins exposés aux bouleversements économiques liés à la pandémie, ils constituent une source potentielle de soutien financier pour leurs enfants ou les plus jeunes membres de leur famille, qui pourraient avoir été plus sévèrement touchés. Dans le cadre d’une étude portant sur les répercussions des graves récessions économiques, quelque 28 % des ménages aux États-Unis ont affirmé avoir reçu une aide financière de leur famille et de leurs amis pendant la crise financière de 200811.
De quelle façon la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté la capacité des retraités de soutenir d’autres membres de leur famille au Canada? Lorsqu’on leur a posé la question, environ 1 retraité sur 5 (21 %) a déclaré que la pandémie avait perturbé sa capacité d’aider financièrement d’autres membres de la famille. Chez les préretraités, ceux-ci étant davantage exposés au bouleversement économique provoqué par la crise sanitaire, la proportion était de 45 %. Ainsi, les retraités qui recevaient une aide au revenu de leurs enfants ou petits-enfants (dont certains pourraient être des préretraités) ont peut-être aussi été indirectement touchés.
Le tiers des Canadiens interrogés doivent revoir leur projet de retraite
Alors que les familles continuent de composer avec les effets de la pandémie de COVID-19, les données montrent que de nombreux travailleurs y adaptent leur projet de retraite. Une étude menée récemment aux É.-U. a révélé que 39 % des travailleurs américains revoyaient le moment de leur départ à la retraite12, et ce, principalement pour des raisons financières (p. ex., peut-être ont-ils dû utiliser une partie de leurs économies, certains de leurs placements peuvent avoir perdu de la valeur pendant la pandémie, le montant d’argent dont ils auront besoin à la retraite demeure incertain).
Un sondage distinct effectué au Canada suggère qu’une tendance similaire pourrait être observée au pays : le tiers (33 %) des adultes prévoyant prendre leur retraite soutiennent qu’ils le feront plus tard que prévu en raison de la COVID-1913. Quelque 8 % des répondants ont par ailleurs déclaré qu’ils prendraient leur retraite plus tôt que prévu, possiblement en vue d’échapper à l’incertitude et aux turbulences persistantes sur le marché du travail (s’ils en ont les moyens financiers).
Bien que la situation ne permette pas encore de dégager clairement tous les effets de la pandémie de COVID-19 sur la retraite au Canada, les données préliminaires montrent que les retraités sont en moyenne moins touchés financièrement, tandis que les préretraités semblent avoir été plus exposés aux répercussions économiques. En outre, les sondages démontrent que l’incertitude accrue a une incidence sur la planification de la retraite, et il sera important de poursuivre les recherches afin de mieux en comprendre les répercussions sur les finances et le bien-être des familles de façon plus générale.
Edward Ng, Ph. D., Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Notes
- Statistique Canada, « Enquête sur la population active, mai 2020 » dans Le Quotidien (Ottawa : Statistique Canada, 2020). Selon l’Enquête sur la population active, de février à avril 2020, 5,5 millions de travailleurs canadiens ont été touchés par la crise économique liée à la COVID-19, ce qui comprend une baisse de l’emploi de 3,0 millions ainsi qu’une augmentation de 2,5 millions des absences du travail associées à la COVID-19. Lien : https://bit.ly/3jmKoE1
- Ana Fostik et Jennifer Kaddatz, « Les finances familiales et la santé mentale pendant la pandémie de COVID‑19 » (26 mai 2020).
- Voir Ana Fostik, « Incertitude et report : Les conséquences de la pandémie sur la fécondité au Canada », L’Institut Vanier de la famille (30 juin 2020).
- Myriam Hazel, « Raisons de travailler chez les 60 ans et plus » dans Regard sur les statistiques du travail, no 71-222-X au catalogue de Statistique Canada (14 décembre 2018). Lien : https://bit.ly/3hr39W9
- Agence de la consommation en matière financière du Canada, Les Canadiens et leur argent : principales constatations de l’Enquête canadienne sur les capacités financières de 2019 (novembre 2019). Lien : https://bit.ly/2EGLrPK
- RBC, Sondage RBC sur l’autonomie financière à la retraite de 2017 (14 février 2017). Lien : https://bit.ly/3loed8L
- Justin Trudeau, premier ministre du Canada, « Le premier ministre annonce un soutien supplémentaire pour les aînés canadiens », Gouvernement du Canada (12 mai 2020). Lien : https://bit.ly/31v2GNb
- Le sondage, réalisé par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger, du 1er au 3 mai 2020, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
- Par retraité, on entend toute personne de 45 ans et plus ayant déclaré être à la retraite dans le cadre du sondage, lorsqu’interrogée sur son statut actuel. Les préretraités représentent d’autres répondants du même groupe d’âge ayant dit occuper une profession autre que celle de personne au foyer ou d’étudiant. S’il n’y a pas d’âge obligatoire pour la retraite au Canada, les données du sondage ont en outre révélé que près de 4 % des personnes de 65 ans et plus demeurent en emploi, alors qu’environ 29 % des retraités du même groupe d’âge avaient en réalité moins de 65 ans.
- Statistique Canada, « Sources de revenu et impôts (16), statistiques du revenu (4) en dollars constants (2015), âge (9), sexe (3) et année (2) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Recensement de 2006 – Données-échantillon (20 %) et Recensement de 2016 – Données intégrales (100 %) » dans Tableaux de données, Recensement de 2016 (12 septembre 2017). Lien : https://bit.ly/3bazLRT
- National Research Council, « Assessing the Impact of Severe Economic Recession on the Elderly: Summary of a Workshop » (Washington, DC: The National Academies Press, 2011). Lien : https://bit.ly/2X8b9mU
- Edward Jones Canada, The Four Pillars of the New Retirement (25 juin 2020).
- Ibidem
Rapport : La COVID-19 et la parentalité au Canada
3 septembre 2020
En juin 2020, l’Institut Vanier a produit le rapport Familles « en sécurité à la maison » : La pandémie de COVID-19 et la parentalité au Canada en prévision de la rencontre d’un groupe d’experts des Nations Unies intitulée Families in Development : Focus on Modalities for IYF+30, Parenting Education and the Impact of COVID-19 (Le développement des familles : Regard sur les modalités du 30e anniversaire de l’AIF, l’éducation parentale et les conséquences de la COVID-19). Maintenant disponible en français et en anglais, ce rapport aborde la réalité, les liens et le bien-être des familles pendant la pandémie de COVID-19, en plus d’explorer les ressources, les politiques, les programmes et les initiatives actuellement en vigueur afin de soutenir les familles et la vie familiale.
Le rapport Familles « en sécurité à la maison » répertorie les ressources fédérales, provinciales et territoriales qui ont été créées dans le but de compenser, d’atténuer ou de réduire les répercussions financières qu’ont subies les familles en raison de la pandémie de COVID-19. En plus des interventions gouvernementales, le rapport propose un résumé de la gamme diversifiée de services offerts en soutien aux familles, pour la période allant de la préparentalité à la parentalité d’adolescents, et qui s’adressent aux parents de l’ensemble du Canada, y compris ceux qui sont membres des communautés autochtones et des 2SITLGBQ+ ainsi que les nouveaux arrivants.
La rencontre de ce groupe d’experts a été organisée par la Division du développement social inclusif du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES), et a permis à des experts de disciplines variées du monde entier de se réunir virtuellement afin de discuter des conséquences de la COVID-19, d’évaluer les progrès réalisés et les questions émergentes en lien avec la parentalité et l’éducation, et de planifier les célébrations imminentes du 30e anniversaire de l’Année internationale de la famille (AIF).
Familles « en sécurité à la maison » : La pandémie de COVID 19 et la parentalité au Canada
Nora Spinks, Sara MacNaull, Jennifer Kaddatz
Vers la fin de 2019, la nouvelle liée à l’apparition du nouveau coronavirus (COVID‑19) commençait à se répandre partout dans le monde. À l’instar de nombreux autres pays, le Canada commençait alors à envisager la possibilité, pendant des semaines, voire des mois, que les familles soient tenues de vivre en isolement chez elles, que les horaires scolaires et professionnels subissent des changements, et que des répercussions inconnues affectent le bien-être des familles ainsi que les liens qui les unissent.
En 2020, au cœur de la pandémie de COVID-19, les citoyens du monde entier apprennent à composer avec de nouveaux modes de vie et à s’y adapter tout en demeurant « en sécurité à la maison ». Depuis le 10 mars 2020, les Canadiens s’efforcent de respecter les directives de distanciation physique et sociale mises de l’avant par nos gouvernements et établies sur les recommandations des responsables de la santé publique. Au cours des trois derniers mois, nombre de parents ont dû exercer leur rôle dans un contexte de grande incertitude et d’imprévisibilité, et ce, tout en assumant leurs engagements professionnels, leurs responsabilités de soins à la maison et à l’extérieur du foyer, et l’éducation à domicile des enfants de tous âges. Malgré l’impossibilité de planifier et l’incertitude par rapport aux semaines et aux mois à venir, la plupart des familles maintiennent une bonne santé physique et mentale en prenant soin les uns des autres et en traversant la tempête avec leurs voisins et leurs communautés à distance.
En cette période sans précédent, l’Institut Vanier de la famille a réorienté son approche afin d’œuvrer à comprendre les familles au Canada en ce contexte marqué par des changements radicaux sur les plans socioéconomique et environnemental. Les activités quotidiennes des individus et des familles au Canada, leurs réflexions, leurs sentiments et leurs occupations sont tout autant de facteurs importants à considérer et à saisir à court, à moyen et à long termes.
C’est dans ce contexte que des représentants de l’Institut Vanier ont cofondé le Réseau COVID‑19 sur les impacts sociaux, un groupe multidisciplinaire composé d’éminents experts canadiens ainsi que de certains de leurs homologues internationaux. Le Réseau a déterminé des enjeux importants, des indicateurs clés ainsi que des données sociodémographiques pertinentes qui permettront de formuler des réponses fondées sur des données probantes concernant les dimensions socioéconomiques de la crise de la COVID-19 au Canada. Par ailleurs, afin de bien cerner la réalité des familles pendant la pandémie, l’Institut Vanier a mobilisé à l’interne les connaissances provenant d’autres sources disponibles, notamment des données quantitatives d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, comme Statistique Canada et UNICEF Canada, ainsi que des renseignements qualitatifs fournis par des individus, des familles et des organismes de partout au pays. L’analyse de ces résultats a permis de mettre en lumière les caractéristiques de la vie de famille avant et durant la pandémie, donnant un aperçu de ce que les Canadiens craignent et de ce qu’ils sont impatients de faire une fois que les mesures de santé publique seront levées.
Conformément à ses principes fondamentaux, l’Institut Vanier honore et respecte les points de vue des diverses familles en adoptant une perspective familiale et une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), lorsque c’est possible1. En examinant l’impact de la pandémie de COVID-19 ainsi que l’ensemble « des coûts et des conséquences » qui y sont associés, y compris les modèles de fécondité, les responsabilités parentales, les relations familiales, la dynamique familiale et le bien-être de la famille, l’Institut mobilise les connaissances de ceux qui s’emploient à étudier, à servir et à soutenir les familles. Il vise à favoriser une prise de décisions éclairées et fondées sur des données probantes lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de programmes destinés à toutes les familles au Canada.
L’expérience de la pandémie de COVID-19 au Canada
Au 31 mai 2020, 1,6 million de personnes avaient subi un test de dépistage de la COVID-19 au Canada (soit environ 4,5 % de l’ensemble de la population). Parmi celles-ci, 5 % étaient infectées par le virus, et 8 % en sont décédées2. Les aînés se trouvant dans des établissements de soins de longue durée qui sont décédés de la COVID-19 représentent environ 82 % de l’ensemble des décès reliés au virus3.
Dans cette pandémie, les familles ressemblent à tout autre « système » : leurs forces et leurs faiblesses sont magnifiées, amplifiées et intensifiées au fur et à mesure qu’elles adaptent leurs relations, leurs interactions et leurs comportements aux changements de routine, d’habitudes et de réalité. Les liens familiaux, le bien-être de la famille et la réalité des jeunes ont tous été profondément affectés par la situation.
LES LIENS FAMILIAUX
- Environ 8 adultes sur 10 (de 18 ans et plus) mariés ou vivant en union libre ont déclaré qu’eux et leur conjoint se soutenaient mutuellement depuis le début de la pandémie de COVID‑19 (figure 1). Ce pourcentage ne varie que légèrement pour ceux qui ont des enfants ou des adolescents à la maison (77 %), comparativement à ceux qui ne comptent pas d’enfant de moins de 18 ans au sein de leur ménage (82 %)4.
- Moins de 2 adultes sur 10 qui entretiennent une relation sérieuse ont affirmé se disputer davantage depuis le début de la pandémie (figure 1)5.
- Six parents sur 10 ont affirmé passer plus de temps à discuter avec leurs enfants qu’ils ne le faisaient avant le début du confinement6.
- Dans les ménages comprenant de jeunes enfants à la maison, les adultes étaient près de deux fois plus susceptibles d’avoir augmenté le temps consacré à créer de l’art, de l’artisanat ou de la musique que ceux qui n’avaient pas d’enfants ni d’adolescents à la maison7.

En revanche…
- Le tiers des adultes se sont dits très ou extrêmement inquiets à propos des tensions familiales engendrées par le confinement9.
- 10 % des femmes et 6 % des hommes étaient très ou extrêmement préoccupés par la possibilité de violence à la maison10, 11.
- Environ 1 Canadien sur 5 avait des proches aînés vivant dans un foyer ou un établissement de soins et, parmi eux, 92 % des femmes et 78 % des hommes se disaient très ou assez préoccupés pour leur santé12.
LE BIEN-ÊTRE DE LA FAMILLE
- Dans la cadre d’un sondage en production collective (crowdsourcing) mené par Statistique Canada du 24 avril au 11 mai 2020, plus des trois quarts des participants ont indiqué que leur santé mentale était très bonne ou excellente (46 %) ou encore bonne (31 %) pendant la pandémie13.
- Près de la moitié (48 %) des participants à une initiative d’approche participative de Statistique Canada ont déclaré que leur santé mentale était « à peu près identique », « un peu mieux » ou « beaucoup mieux » qu’elle ne l’était avant le début de la pandémie14.
- Environ la moitié des adultes ont dit se sentir anxieux, nerveux ou tristes « très souvent » ou « souvent » depuis le début de la crise sanitaire15.
- Parmi tous les groupes d’âge et dans toutes les semaines de sondage, les femmes ont exprimé une crainte plus vive que les hommes à l’idée de contracter le virus ou qu’une personne de leur famille immédiate le contracte (figure 2)16.

- Les Canadiens craignaient davantage qu’un proche contracte la COVID-19 qu’ils ne craignaient la contracter eux-mêmes. Voici le pourcentage des adultes qui ressentaient « beaucoup » ou « énormément » d’inquiétude concernant :
- leur propre santé: 36 %
- la santé d’un membre de leur ménage : 54 %
- la santé des personnes vulnérables : 79 %
- le risque d’engorger le système de santé : 84 %18, 19
- Plus de 4 adultes sur 10 vivant avec des enfants de moins de 18 ans à la maison ont affirmé avoir éprouvé « très souvent » ou « souvent » de la difficulté à dormir depuis le début de la pandémie20.
- Lorsqu’on leur a demandé de décrire leur principal état d’esprit au cours des dernières semaines, les Canadiens étaient plus susceptibles d’affirmer qu’ils étaient inquiets (44 %), anxieux (41 %) et qu’ils s’ennuyaient (30 %); pas moins du tiers (34 %) ont aussi indiqué qu’ils se sentaient « reconnaissants »21.
- Les femmes étaient considérablement plus susceptibles que les hommes d’indiquer ressentir de l’anxiété ou de la nervosité, de la tristesse ou de l’irritabilité ou avoir de la difficulté à dormir pendant la pandémie22.
- Tous groupes d’âge confondus, les adultes ont continué de faire de l’exercice pendant la pandémie, alors que les deux tiers des adultes de 18 à 34 ans ont affirmé faire de l’exercice aussi souvent ou même plus souvent pendant la pandémie qu’ils n’en faisaient avant qu’elle débute. Les proportions étaient semblables chez les adultes de 35 à 54 ans (62 %) ainsi que chez les 55 ans et plus (65 %)23.
- Les jeunes adultes (de 15 à 49 ans) étaient plus susceptibles de signaler une consommation accrue de malbouffe que les adultes plus âgés24.
- Les banques alimentaires ont connu une augmentation moyenne de 20 % de leur demande. Certaines banques alimentaires locales, comme celles de Toronto, en Ontario, ont enregistré des hausses atteignant 50 %25.
- Parmi les personnes de 15 ans et plus, 9 personnes sur 10 ont indiqué que la pandémie n’avait pas eu d’effet sur leur consommation de produits du tabac ou de cannabis26. Un peu moins de 8 personnes sur 10 ont affirmé que la pandémie n’avait pas affecté leurs habitudes de consommation d’alcool27.
RÉALITÉ DES ADOLESCENTS
- Les jeunes de 12 à 19 ans ont indiqué avoir obtenu la plupart des renseignements sur la COVID‑19 et les mesures de santé publique de leurs parents28.
- Les adolescents de 15 à 17 ans ont éprouvé plus d’anxiété que ceux de 12 à 14 ans29.
- Parmi les adolescents de 15 à 17 ans, 50 % ont indiqué que la pandémie avait eu « beaucoup » ou « assez » d’effets négatifs sur leur santé mentale, par rapport à 34 % chez les adolescents de 12 à 14 ans. Près de 4 adolescents sur 10 âgés de 12 à 17 ans ont signalé « beaucoup » ou « assez » d’effets négatifs sur leur santé physique30.
- Pendant le confinement, ce qui a le plus manqué à environ la moitié des enfants et des adolescents, tous groupes d’âges confondus, est leurs amis31.
- Bien que 75 % des adolescents aient déclaré avoir continué leurs travaux scolaires malgré l’isolement, nombre d’entre eux ont affirmé avoir manqué de motivation (60 %) et ne pas avoir aimé ce fonctionnement (57 %) (c.-à-d. l’apprentissage en ligne ou les cours virtuels)32.
- De nombreux jeunes ont dit faire plus de travaux ménagers et assumer davantage de tâches pendant la pandémie33.
- Les adolescents plus âgés (de 15 à 17 ans) avaient plus de difficulté à dormir, se sentaient plus anxieux ou nerveux, tristes et irritables. Les adolescents plus jeunes (de 12 à 14 ans) étaient plus susceptibles de se sentir heureux que les plus vieux (figure 3)34.

Réponse à la pandémie de COVID-19 au Canada
Depuis mars 2020, les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral ont instauré une variété de prestations, de crédits, de programmes, d’initiatives et de fonds visant à soutenir les familles de partout au Canada. Ces nouvelles ressources ont pour but de compenser, d’atténuer ou de réduire les répercussions financières de la COVID-19 subies par les familles dans cette période d’incertitude. On retrouve notamment les mesures suivantes :
AUGMENTATION TEMPORAIRE DE L’ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS (ACE)
L’Allocation canadienne pour enfants (ACE) est un versement mensuel non imposable fait aux familles admissibles afin de les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. Le montant du versement varie en fonction du nombre d’enfants, de l’âge des enfants, de l’état matrimonial et du revenu familial net indiqué sur la déclaration d’impôts de l’année précédente. L’ACE peut inclure la Prestation pour enfants handicapés ainsi que tous les programmes connexes offerts par le gouvernement provincial ou territorial36.
Pour les familles qui bénéficient déjà de l’ACE, un montant supplémentaire de 300 $ par enfant a été ajouté à l’allocation en mai 2020. Par exemple, une famille ayant deux enfants aura reçu 600 $ en plus de son versement mensuel habituel de l’ACE, qui pouvait atteindre une somme maximale de 553,25 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans et de 466,83 $ par mois pour chaque enfant de 6 à 17 ans37, 38.
PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE (PCU)
En avril 2020, le gouvernement fédéral du Canada a instauré la Prestation canadienne d’urgence (PCU) afin de soutenir les travailleurs touchés par la pandémie de COVID-19.
La PCU verse 2 000 $ à chaque période de quatre semaines aux travailleurs qui ont perdu leur revenu en raison de la pandémie. Y sont admissibles les adultes qui ont perdu leur emploi ou qui sont malades, en quarantaine ou qui prennent soin d’une personne qui a contracté la COVID-19. Elle s’applique aux salariés, aux travailleurs contractuels et aux travailleurs indépendants qui ne sont pas en mesure de travailler. La prestation permet également aux travailleurs de gagner jusqu’à 1 000 $ par mois tout en percevant la PCU39.
En raison de la fermeture des écoles et des services de garde de l’ensemble du Canada, la PCU est offerte aux parents qui travaillent et qui doivent rester à la maison sans rémunération afin de s’occuper de leurs enfants jusqu’à ce que les écoles et les services de garde puissent rouvrir et accueillir à nouveau les enfants de tous âges en toute sécurité.
Au début du mois de mai 2020, plus de 7 millions de Canadiens avaient présenté une demande pour bénéficier de la PCU depuis son entrée en vigueur40.
REPORT DES PAIEMENTS HYPOTHÉCAIRES
Les propriétaires de partout au Canada qui sont confrontés à des difficultés financières en raison d’une perte de travail ou d’une baisse de revenus pendant la pandémie peuvent être admissibles à un report de paiements hypothécaires pouvant aller jusqu’à six mois.
Le report de paiement constitue une entente conclue entre les propriétaires et leur prêteur hypothécaire, qui comprend une suspension de tout paiement hypothécaire pendant une période déterminée41.
CRÉDIT SPÉCIAL POUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES
Le crédit pour la taxe sur les produits et services est un versement trimestriel non imposable qui aide les particuliers et les familles ayant un revenu faible ou modeste à compenser la totalité ou une partie de la taxe sur les produits et services (TPS) ou de la taxe de vente harmonisée (TVH) qu’ils paient42.
En avril 2020, le gouvernement fédéral a offert un paiement spécial unique à ceux qui bénéficient du crédit pour la taxe sur les produits et services. La prestation supplémentaire moyenne s’élevait à près de 400 $ pour les personnes seules et à près de 600 $ pour les couples43.
COMPLÉMENT SALARIAL TEMPORAIRE POUR LES TRAVAILLEURS ESSENTIELS À FAIBLE REVENU
Le gouvernement fédéral dispense un soutien de 3 milliards de dollars afin d’augmenter le salaire des travailleurs essentiels à faible revenu. Ces travailleurs essentiels (qui peuvent varier selon la province ou le territoire) peuvent inclure des professionnels de la santé, des employés d’établissements de soins de longue durée et des employés d’épicerie.
Chaque province ou territoire est responsable de déterminer quels travailleurs sont admissibles à ce soutien et le montant qu’ils percevront44.
EMERGENCY RELIEF SUPPORT FUND FOR PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS (FONDS D’AIDE D’URGENCE POUR LES PARENTS D’ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS) (Province de la Colombie‑Britannique)
Afin de soutenir les parents d’enfants ayant des besoins particuliers pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement de la Colombie-Britannique a créé un nouveau fonds d’aide d’urgence. Le fonds fournira un paiement direct de 225 $ par mois aux familles admissibles entre les mois d’avril et de juin 2020 (pendant trois mois).
Le paiement peut être utilisé pour se procurer de l’aide afin d’atténuer le stress, notamment de l’aide pour la préparation des repas et l’achat de produits alimentaires; des services d’aide familiale; ou des services d’aide et/ou de counseling pour les aidants, que ce soit en ligne ou par téléphone45.
FONDS DE SOUTIEN DU REVENU POUR RÉPONDRE À LA COVID-19 (Province de l’Île-du-Prince-Édouard)
En avril 2020, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé un soutien financier destiné aux personnes dont le revenu a été affecté directement par l’état d’urgence de santé publique, ainsi que par les mesures supplémentaires visant à assurer la sécurité des résidents.
Le Fonds de soutien du revenu pour répondre à la COVID-19 aidera les personnes à combler l’écart entre leur perte de revenu et les prestations d’assurance-emploi (AE) ou la prestation d’urgence du Canada (PCU) en fournissant un montant forfaitaire unique imposable de 750 $46.
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FAMILLES (Province de l’Ontario)
En avril 2020, le gouvernement de l’Ontario a annoncé une aide financière directe pour les parents alors que les écoles et les centres de services de garde de l’Ontario étaient fermés en raison de la pandémie de COVID-19.
Le nouveau programme de soutien aux familles offre un versement unique de 200 $ par enfant de 0 à 12 ans et de 250 $ pour les enfants de 0 à 21 ans ayant des besoins particuliers47.
PRESTATION D’URGENCE POUR LES CLIENTS INSCRITS À L’AIDE AU REVENU (Territoires du Nord-Ouest)
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a fourni une prestation d’urgence unique aux clients inscrits à l’aide au revenu en mars 2020, afin de les aider à s’approvisionner en nourriture et en produits de nettoyage pour 14 jours, selon les stocks des magasins.
Le programme d’aide au revenu est conçu pour les résidents de 19 ans et plus dont les besoins sont plus importants que leur revenu. La prestation d’urgence reçue par les particuliers s’élevait à 500 $ et celle des familles, à 1 000 $48.
La parentalité au Canada : les priorités, les politiques, les programmes et les ressources du gouvernement
Le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones appuient les parents canadiens de nombreuses façons. En plus des mesures de soutien instaurées pour aider les familles pendant la pandémie de COVID-19 décrites dans la section précédente, voici une sélection de priorités, de politiques, de ressources et de programmes actuels qui existaient avant la pandémie :
APPRENTISSAGE ET GARDE DES JEUNES ENFANTS
Les besoins en matière d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada sont vastes et diversifiés. Le gouvernement du Canada investit dans l’apprentissage et la garde des jeunes enfants afin de veiller à ce que les enfants connaissent le meilleur départ possible dans la vie. Dans un premier temps, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants ont convenu d’un Cadre multilatéral d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ce nouveau cadre jette les bases qui amèneront les gouvernements à travailler à la concrétisation d’une vision commune à long terme selon laquelle tous les enfants du Canada peuvent profiter de l’environnement enrichissant d’un système d’apprentissage et de garde de qualité. Les principes directeurs du Cadre visent à accroître la qualité, l’accessibilité, l’abordabilité, la flexibilité et l’inclusivité. Un cadre distinct pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones a été élaboré en collaboration avec des partenaires autochtones, reflétant les cultures et les besoins uniques des enfants des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada49, 50.
SERVICES DE GARDE AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE
Le gouvernement fédéral du Canada priorise actuellement la collaboration avec les provinces et les territoires afin d’investir pour créer jusqu’à 250 000 places supplémentaires en services de garde avant et après l’école pour les enfants de moins de 10 ans, dont au moins 10 % permettraient un service de garde pour une durée prolongée. Parmi les autres priorités, notons également une réduction de 10 % des frais de garde d’enfants dans le cas des programmes avant et après l’école51.
SPÉCIALEMENT POUR VOUS – PARENTS
« Spécialement pour vous – Parents » est une liste de ressources en ligne créée par le gouvernement fédéral à l’intention des parents sur des sujets comme l’alcool, le tabagisme et les drogues; la violence et l’enfant; les maladies de l’enfance et les maladies de longue durée; les ressources d’éducation; les questions familiales; la vie saine; la santé mentale; les conseils aux parents (développement de l’enfant); la santé en milieu scolaire; et l’équilibre entre le travail et la vie personnelle. Chaque sujet comporte un éventail de sous-thèmes qui orientent les parents grâce à des liens vers les renseignements les plus récents disponibles au Canada sur des questions d’importance pour eux et leurs enfants52.
PROGRAMME DE CONGÉ FAMILIAL PAYÉ GARANTI
En 2019, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social a été mandaté pour travailler avec la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des handicapés afin d’améliorer et d’intégrer l’actuel système de prestations de maternité et parentales basées sur l’assurance-emploi, et de collaborer avec la province de Québec pour permettre une intégration efficace avec son propre système de prestations parentales53.
- Prestations de maternité et parentales Administrées par le programme d’assurance-emploi (AE) au Canada (à l’exception du Québec), les prestations de maternité et parentales comportent une aide financière (c.-à-d. un remplacement du revenu pour les travailleurs admissibles) destinée aux nouvelles mères et aux nouveaux parents suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant. Le nombre de semaines et le montant versé à chaque parent varient selon le type de prestations choisi, le nombre de semaines et le montant maximal payable (tel que déterminé par le gouvernement)54. Au Québec, le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) assure l’administration des prestations de maternité, de paternité, parentales et d’adoption. Le montant versé aux parents dépend également du type de prestations choisi, du nombre de semaines et du montant maximal payable (tel que déterminé par le gouvernement provincial). En 2019, le taux hebdomadaire moyen des prestations parentales standard au Canada atteignait 464,00 $ par mois55, 56.
MODERNISATION DES LOIS FÉDÉRALES CANADIENNES EN MATIÈRE FAMILIALE
Le 21 juin 2019, la sanction royale a été accordée en vue de modifier les lois fédérales canadiennes en matière familiale concernant le divorce, le rôle parental et l’exécution des obligations familiales. Cette initiative, qui constitue la première mise à jour des lois en matière familiale depuis plus de 20 ans, rendra les lois fédérales en matière familiale mieux adaptées aux besoins des familles grâce aux modifications apportées à la Loi sur le divorce, à la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions. La plupart des modifications apportées à la Loi sur le divorce entreront en vigueur le 1er juillet 2020, alors que celles apportées aux autres lois entreront en vigueur au cours des deux prochaines années. La loi vise quatre objectifs principaux : promouvoir l’intérêt de l’enfant; lutter contre la violence familiale; aider à réduire la pauvreté chez les enfants; et accroître l’accessibilité et l’efficacité du système de justice familiale canadien57.
LOIS ET POLITIQUES PROVINCIALES ET TERRITORIALES SUR LA PROTECTION DES ENFANTS
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada reconnaissent l’importance de la surveillance en vue de l’apport de preuves à l’égard des contextes, des facteurs de risques et des formes de maltraitance des enfants afin d’alimenter les politiques, les programmes, les services et les interventions de sensibilisation. Par l’entremise de leur ministère respectif axé sur la protection de l’enfance, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont la responsabilité d’aider les enfants ayant besoin de protection. Ces organismes constituent également les principales sources de données et de renseignements administratifs sur les cas signalés de maltraitance d’enfants. Prévenir et contrer la maltraitance des enfants est une entreprise complexe qui nécessite l’engagement de tous les ordres de gouvernements et de différents secteurs, notamment les services sociaux, les services policiers, la justice et la santé. À l’échelle fédérale, l’Initiative de lutte contre la violence familiale réunit plusieurs ministères en vue de prévenir et de contrer la violence familiale, y compris la maltraitance des enfants. Le ministère de la Justice est responsable du Code criminel, qui fait état de plusieurs formes de violence envers les enfants. En l’état actuel du Code criminel – qui a fait l’objet de débats à la fois par les défenseurs et les parents –, l’article 43 autorise légalement l’utilisation d’un châtiment corporel infligé aux enfants par des personnes déterminées, pourvu qu’elles n’exercent pas une force déraisonnable selon le contexte58, 59.
Y’A PERSONNE DE PARFAIT
Instauré à l’échelle nationale en 1987 et actuellement géré par l’Agence de la santé publique du Canada, Y’a personne de parfait est un programme d’enrichissement de l’expérience parentale destiné aux parents d’enfants de 0 à 5 ans. Le programme a été conçu pour répondre aux besoins des parents qui sont jeunes, seuls, isolés sur le plan social ou géographique, ou qui ont un faible revenu ou une éducation formelle limitée. Il est offert en milieu communautaire par des animateurs dans le but d’aider les parents et les jeunes enfants. Le programme procure aux parents de jeunes enfants un endroit sécuritaire où ils peuvent renforcer leurs compétences parentales, en acquérir de nouvelles et apprendre de nouvelles notions. Il leur permet aussi d’interagir avec d’autres parents ayant des enfants du même âge que les leurs60.
PROGRAMME D’AIDE PRÉSCOLAIRE AUX AUTOCHTONES DANS LES COLLECTIVITÉS URBAINES ET NORDIQUES
Le Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques (PAPACUN) est un programme communautaire national d’intervention précoce qui est financé par l’Agence de la santé publique du Canada. Le PAPACUN met l’accent sur le développement des jeunes enfants autochtones (membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis) et de leur famille à l’extérieur des réserves. Depuis 1995, il fournit du financement aux organismes communautaires autochtones pour contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes favorisant le développement sain des enfants autochtones d’âge préscolaire. Le Programme favorise le développement spirituel, émotionnel, intellectuel et physique des enfants autochtones, tout en aidant leurs parents et leurs tuteurs à titre de premiers éducateurs61.
La parentalité au Canada : du début de la parentalité jusqu’à l’adolescence62
Pour les futurs parents (ou ceux qui envisagent de le devenir), les mois qui précèdent la naissance ou l’adoption d’un enfant peuvent s’avérer à la fois exaltants et déroutants. Avant l’arrivée de ce petit être, il y a plusieurs choses à planifier – y compris l’imprévisible. Au Canada, l’accompagnement comprend en général des consultations régulières et gratuites auprès d’un obstétricien-gynécologue, d’une sage-femme ou d’autres professionnels agréés de la santé afin d’assurer la croissance et le développement sains du bébé. Des programmes et des services sont d’ailleurs offerts dans les collectivités de partout au Canada afin de préparer et de planifier la parentalité.
- 2SITLGBQ+ Family Planning Weekend Intensive (Fin de semaine de planification familiale intensive pour les 2SITLGBQ+) La structure de ce programme de deux jours vise à découvrir les différentes voies qui mènent à la parentalité ainsi que les stratégies permettant de réaliser sa propre vision de la parentalité et de la famille. Les participants sont encouragés à poser des questions, à recueillir des renseignements et à créer une communauté, tout en abordant des sujets comme la coparentalité, les familles pluriparentales et monoparentales, la grossesse, les difficultés liées à la parentalité et l’autonomie sociale. (LGBTQ+ Parenting Network)
- Se préparer à la parentalité Destiné aux futurs parents, ce programme présente des renseignements sur la manière de maintenir une bonne santé pendant la grossesse et sur ce à quoi on peut s’attendre lors des premiers jours et des premières semaines de la vie de parents. (Centres pour l’enfant et la famille ON y va)
- Mommies & Mamas 2B/Daddies & Papas 2B (Futures mamans/futurs papas) Ce cours de 12 semaines s’adresse aux hommes et aux femmes gais/lesbiennes, bisexuels et allosexuels qui envisagent de devenir parents. Le cours comporte des ressources et des discussions visant à approfondir diverses questions pratiques, émotionnelles, sociales, éthiques, financières, médicales, juridiques, politiques et intersectionnelles liées au fait de devenir parent. Parmi les sujets abordés, citons la coparentalité, la maternité de substitution, les modalités parentales, la parentalité non biologique et adoptive, la sensibilisation à la fécondité, les options de soins prénatals et les questions juridiques. (LGBTQ+ Parenting Network)
NOUVEAU-NÉS ET NOURRISSONS
S’occuper d’un nouveau-né ou d’un nourrisson comporte une série de triomphes et de défis. Plusieurs programmes et services sont offerts – souvent gratuitement – aux parents dans l’ensemble du pays, notamment des consultations auprès de pédiatres et de professionnels agréés de la santé. Les services de soins postnatals varient en fonction des régions et des collectivités, et peuvent inclure des mesures de soutien informatives, des visites à domicile d’une infirmière de santé publique ou d’un intervenant non spécialisé, ou du soutien téléphonique (ex. : télésanté) d’une infirmière de santé publique ou d’une sage-femme63. Des organismes de partout au pays proposent également des programmes sous forme de halte-accueil pour les parents, les grands-parents et les responsables d’enfants afin de favoriser un développement et un attachement sains de l’enfant.
- Racines de l’empathie Le programme est axé sur un nourrisson et un parent qui visitent une classe d’une école locale toutes les trois semaines au cours de l’année scolaire. En compagnie d’un instructeur qualifié de l’organisme Racines de l’empathie, les élèves observent le développement et les émotions du bébé. Ce programme permet au parent et au nourrisson de participer à l’enseignement de la maîtrise des émotions et de l’empathie aux enfants de 5 à 12 ans, tout en renforçant les liens qui les unissent. (Racines de l’empathie)
- Être parent de mon bébé Le programme est élaboré pour les nouveaux parents afin de leur offrir des occasions d’apprendre, de participer à des discussions sur divers sujets reliés à la petite enfance, le développement de l’enfant et le rôle parental, ainsi que de leur offrir la possibilité de rencontrer d’autres nouveaux parents. (Centres pour l’enfant et la famille ON y va)
- Bellies & Babies (Bedaines et bébés) Ce groupe d’accueil s’adresse aux femmes enceintes et aux nouveaux parents dont le bébé a moins d’un an. Le groupe offre aux femmes enceintes et aux mères en période postnatale un soutien individuel et par les pairs ainsi que des ressources et des mesures de soutien aux nouveaux parents. Les ressources abordent des sujets comme l’importance des relations sécurisantes en bas âge, la nutrition, l’allaitement, la santé mentale, le développement du nourrisson et le rôle parental. (Sunshine Coast Community Services Society)
- Les jeunes parents se connectent Ce groupe de soutien informel est destiné aux parents et aux futurs parents de moins de 26 ans. Il offre l’occasion de rencontrer d’autres jeunes parents, de poser des questions et de partager leurs préoccupations. Chaque séance comporte également une activité amusante et interactive pour les enfants et les parents. (Centres pour l’enfant et la famille ON y va)
TOUT-PETITS ET ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE
Les programmes destinés aux tout-petits et aux enfants d’âge préscolaire comprennent une variété d’activités qui impliquent à la fois les enfants et leurs parents dans le but de soutenir le sain développement de l’enfant et de stimuler l’attachement entre le parent et l’enfant. Certains programmes offrent des activités libres, comme celles proposées par les Repaires jeunesse du Canada ou par des centres de loisirs municipaux. Les programmes libres – qui incluent des ateliers de danse, des heures du conte, des activités artistiques et artisanales et beaucoup plus – sont des occasions pour les parents, les éducateurs et les grands-parents de participer à des activités d’apprentissage visant à créer, à explorer et à jouer. Les haltes-accueils s’adressent également aux mamans, aux papas, aux grands-parents et aux personnes responsables d’enfants, en leur offrant des occasions de rencontrer d’autres membres de la collectivité et d’entrer en contact avec eux.
- Parenting Skills 0–5 (Compétences parentales – enfants de 0 à 5 ans) Ce cours en ligne sur l’art parental est conçu pour les familles qui rencontrent des difficultés. Il permet aux parents d’acquérir une compréhension de base de l’éducation des enfants durant les cinq premières années de leur vie. Les sujets de ce cours incluent le développement de l’enfant et la personnalité, la discipline, le sommeil et la nutrition. Des cours sur les compétences parentales sont aussi offerts aux parents d’enfants de 5 à 13 ans et de 13 à 18 ans. (BC Council for Families)
- Fathering (La paternité) S’adressant aux pères, notamment aux nouveaux pères, à ceux qui vivent une séparation ou un divorce, aux pères d’adolescents et aux pères autochtones, ces ressources offrent des renseignements sur la façon de franchir les différentes étapes de l’enfance tout en offrant des conseils pratiques pour soutenir à la fois les pères et leurs enfants. (BC Council for Families)
- Papa HÉROS (Aider tous et chacun à saisir les occasions qui se présentent) Ce cours de 8 semaines sur le rôle parental (offert dans certains établissements correctionnels du Canada), permet de former un groupe de pères à l’intérieur de l’établissement pour les pères incarcérés et dans la collectivité pour ceux qui ont été incarcérés dans le passé. Ce projet a été conçu pour éduquer les pères sur leur rôle parental, le développement et la croissance de leurs enfants, et leur rôle dans la vie de leurs enfants. Papa HÉROS offre une éducation parentale et un soutien qui contribuent à créer un lien entre les pères et leurs enfants et à améliorer leur santé mentale et leur bien-être. (Regroupement canadien d’aide aux familles de détenu(e)s)
ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE
Une fois que les enfants ont intégré le système d’éducation formel au Canada et qu’ils y progressent, ils font la connaissance de diverses personnes (c.-à-d. des pairs, des pédagogues) et découvrent une variété d’influences (c.-à-d. les médias sociaux). Les programmes et les services destinés aux parents d’enfants d’âge scolaire fournissent des conseils pratiques, des ressources informatives et des occasions de rencontrer d’autres nouveaux parents et de s’engager avec eux au sein de leur collectivité.
- Parenting School-Age and Adult Children (Le rôle parental avec des enfants d’âge scolaire et adultes) Cette ressource a été créée pour compléter les programmes de parentalité s’adressant aux nouveaux arrivants. On y aborde certaines difficultés auxquelles sont souvent confrontés les parents et les aidants nouvellement arrivés au pays en matière de parentalité dans la société canadienne. L’objectif du programme est d’aider à acquérir des aptitudes de communications efficaces et à mieux comprendre le système scolaire canadien. Il vise aussi à créer un espace sûr où les parents et les aidants pourront trouver les réponses à leurs questions et à leurs préoccupations concernant l’intégration de leurs enfants au sein de la société et de la culture canadiennes. (CMAS)
- Positive Discipline in Everyday Parenting (Discipline positive dans la parentalité de tous les jours) Cette série d’ateliers met de l’avant la discipline non violente et le respect de l’enfant en tant qu’apprenant. Il s’agit d’une approche de l’enseignement qui aide les enfants à réussir, leur procure des renseignements et soutient leur croissance de la petite enfance à l’âge adulte. (Centres pour l’enfant et la famille ON y va)
- Newcomer Parent Resource Series (Série de ressources pour les parents nouvellement arrivés au pays) Offerte dans 16 langues (notamment l’urdu, l’arabe et le russe), ces ressources abordent différents sujets d’intérêt adaptés aux besoins spécifiques des parents immigrants et réfugiés ayant de jeunes enfants. Parmi les sujets abordés, citons : conserver sa langue maternelle, guider le comportement de son enfant, aider son enfant à faire face au stress, apprendre par le jeu pour les enfants et écouter son enfant et discuter avec lui. (CMAS)
- Parenting after Separation: Meeting the Challenges (Le défi du rôle parental après la séparation) Ce programme de 6 semaines s’adresse aux parents récemment séparés. Les parents se rencontrent une fois par semaine pour discuter des difficultés associées à la séparation et au divorce et pour acquérir des stratégies pratiques afin de mieux soutenir leurs enfants. (Family Service Toronto)
- Foster Parent Support (Soutien aux parents d’accueil) Ce programme offre un soutien direct et de proximité aux parents d’accueil ou aux responsables d’enfants ainsi qu’aux enfants et aux adolescents dont ils ont la charge. Les travailleurs de soutien collaborent directement avec la famille au sein même de son foyer, dans la collectivité ou par téléphone. Ce programme se veut flexible afin de répondre aux besoins uniques de chaque famille d’accueil et peut offrir des mesures de soutien variées, comme l’enseignement d’aptitudes pour la résolution des conflits, de techniques pour désamorcer une situation, de méthodes de résolution collaborative des problèmes et d’approches fondées sur les forces et les traumatismes. (Repaires jeunesse du Canada)
ADOLESCENTS
Être parent d’un adolescent comporte des défis, plus particulièrement en cette époque où la technologie évolue rapidement. L’adolescence peut également être une période difficile à vivre pour les adolescents qui s’interrogent sur leur identité, leur but dans la vie et les objectifs qu’ils visent pour l’avenir. Les programmes destinés aux parents d’adolescents soulignent l’importance de soutenir leurs enfants tout au long de l’adolescence alors qu’ils progressent vers l’âge adulte.
- Ensemble les parents Il s’agit d’un programme permanent de soutien de groupe et d’information offert par des professionnels et destiné aux parents qui connaissent des moments difficiles avec leur ado. Ce programme aide les parents à aborder leurs émotions (ex. : la culpabilité, l’isolement) et leur offre la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances pouvant les aider à réduire les conflits parents-ados à la maison. (Repaires jeunesse du Canada)
- Transceptance (Acceptation transgenre) Il s’agit d’un groupe permanent de soutien mensuel par les pairs qui s’adresse aux parents et aux personnes responsables d’adolescents et de jeunes adultes transgenres. Ce programme de soutien apporte appui et information, réduit l’isolement et le stress, et fournit des renseignements, notamment des stratégies pour accepter l’annonce du jeune et la surmonter. (Central Toronto Youth Services)
- Parents au courant Ce programme d’appui et d’information de 10 semaines vise à mieux comprendre le développement des adolescents, leur santé mentale ainsi que d’autres difficultés courantes auxquelles les parents sont confrontés. Des conférenciers locaux, des ressources communautaires, des idées pratiques et la création de liens avec d’autres parents qui vivent des problèmes semblables contribuent à aider les parents à se sentir mieux outillés pour soutenir leur ado. (Repaires jeunesse du Canada)
- Families in TRANSition (FIT) (Familles en TRANSition) Ce programme de 10 semaines s’adresse aux parents et aux personnes responsables de jeunes trans ou qui s’interrogent sur leur genre (de 13 à 21 ans) qui ont récemment appris l’identité sexuelle de leur enfant. Le programme offre du soutien aux parents et aux responsables afin qu’ils acquièrent les outils et les connaissances qui les aideront : à améliorer leur communication et à renforcer leur relation avec leur adolescent; à se renseigner sur les options de transition sociale, juridique et physique; à approfondir leurs aptitudes en gestion des émotions fortes; à explorer les croyances sociétales, culturelles et religieuses qui affectent la vie des jeunes trans et leur famille; à acquérir les connaissances nécessaires pour soutenir leur jeune et la famille lorsqu’ils sont confrontés à la discrimination, à la transphobie et/ou à la transmisogynie; et à favoriser la santé mentale et la résilience du jeune. (Central Toronto Youth Services)
Ce qui nous attend
Par sa résilience, sa diversité et sa force, la famille constitue l’institution qui parvient le mieux à s’adapter dans le monde.
Alors que les pays du monde entier portent leur attention vers l’avenir postpandémie, les familles et les réalités familiales continuent d’évoluer et de s’adapter. Lorsque les enfants retourneront à l’école et à la garderie, les parents pourront réintégrer le travail en dehors de la maison, tandis que de nombreux autres poursuivront le travail à distance. Certaines activités parascolaires seront renouvelées, mais d’autres, comme les cours d’arts martiaux, seront peut-être toujours offertes en ligne.
Prédire l’avenir n’a jamais été facile, et on ne connaît pas encore les répercussions qu’aura la pandémie mondiale sur les familles. Il est donc possible que les programmes et les services nécessitent des ajustements afin de soutenir le bien-être physique, mental, émotionnel et social des parents et de leurs enfants dans une perspective tenant compte des traumatismes. Si plusieurs familles sont demeurées en sécurité à la maison, d’autres ont connu une augmentation de la violence, du stress, de l’isolement et de l’anxiété.
L’élaboration de politiques et de programmes ainsi que l’offre de prestations, de ressources, de mesures de soutien et de services nécessiteront une compréhension approfondie des familles au Canada, de leur réalité et de leurs aspirations, de leurs réflexions et de leurs craintes, ainsi que des espoirs et des rêves qu’elles chérissent en cette période évolutive et qui nous laisse entrevoir ce qui nous attend. La recherche et l’innovation qui sous-tendent les nombreuses initiatives, y compris celles mentionnées dans ce document, offriront une orientation pour soutenir la prise de décisions fondée sur des données probantes; l’élaboration, la conception et la mise en œuvre de politiques, de pratiques et de programmes fondés sur des données probantes; ainsi que l’innovation inspirée de données factuelles, et ce, pour tous les ordres de gouvernement, organismes communautaires, milieux de travail et groupes confessionnels, afin que les familles au Canada puissent s’épanouir non seulement aujourd’hui, mais aussi dans l’avenir.
Nora Spinks est directrice générale de l’Institut Vanier de la famille.
Sara MacNaull est directrice des programmes de l’Institut Vanier de la famille.
Jennifer Kaddatz est conseillère principale à l’Institut Vanier de la famille.
Publié le 23 juin 2020
Ce rapport a été publié initialement le 23 juin 2020 sur le site Web du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAESNU) dans le cadre de la réunion d’un groupe d’experts intitulée Families in Development: Focus on Modalities for IYF+30, Parenting Education and the Impact of COVID-19 (Le développement des familles : Regard sur les modalités du 30e anniversaire de l’AIF, l’éducation parentale et les conséquences de la COVID-19). Cette rencontre a été organisée par la Division pour le développement social inclusif (DDSI) du DAESNU. L’objectif était de réunir virtuellement divers experts du monde entier afin de discuter des conséquences de la COVID-19 sur les familles, d’évaluer les progrès réalisés et les questions émergentes en lien avec la parentalité et l’éducation, et de planifier les célébrations imminentes du 30e anniversaire de l’Année internationale de la famille (AIF).
Annexe A : Aperçu des organismes et des programmes
Fondé en 1977, le BC Council for Families (BCCF) élabore et propose des ressources pour le soutien familial ainsi que des programmes de formation aux professionnels de toute la province de la Colombie-Britannique comme moyen de diffuser les connaissances et de créer des liens avec la communauté. Le BCCF offre des cours en ligne, des ressources et des programmes qui visent à soutenir les parents et les enfants de la petite enfance à l’âge adulte.
__________
Les Repaires jeunesse du Canada offrent aux enfants et aux adolescents des collectivités de partout au Canada des programmes et des services éducatifs, récréatifs et axés sur le développement de compétences. Les Repaires s’assurent d’offrir des milieux sûrs et aidants où les enfants et les adolescents peuvent explorer de nouvelles possibilités, surmonter les obstacles, tisser des liens positifs et acquérir de l’assurance et des compétences qui leur seront utiles toute leur vie. Plusieurs Repaires proposent également aux parents des programmes et des services de soutien pour le développement de l’enfant et de l’attachement.
__________
Fondé en 1992, le Regroupement canadien d’aide aux familles des détenu(e)s (RCAFD) vise à bâtir des milieux de vie plus stables et plus sûrs en offrant un soutien aux familles qui doivent composer avec des comportements criminels, l’incarcération et la réinsertion sociale. Le Regroupement s’affaire à développer des ressources pour les enfants, les parents et les familles afin de les aider à mieux comprendre le système et le processus correctionnels au Canada et de soutenir les familles dont l’un des proches est incarcéré.
__________
L’organisme Central Toronto Youth Services (CTYS) est un centre communautaire agréé de santé mentale pour enfants qui dessert une grande portion des jeunes les plus vulnérables de Toronto. Ses programmes et ses services répondent à une diversité de besoins et aident les jeunes à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés, comme de graves problèmes de santé mentale, des infractions à la loi, des problèmes de gestion de la colère, la dépression, l’anxiété, la marginalisation ou le rejet, ainsi que des problèmes liés à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.
__________
Fondé en 2000, le CMAS a pour mission de prendre soin des enfants immigrants et réfugiés en mettant son expertise à la disposition des organismes qui viennent en aide aux immigrants et d’autres organismes qui œuvrent dans le domaine de la garde d’enfants. Le CMAS s’affaire actuellement à relever les lacunes dans les services et s’efforce de créer des solutions, d’établir et de mesurer les normes de soins, ainsi que de soutenir les services destinés aux familles de nouveaux arrivants en leur fournissant des ressources, de la formation et des consultations.
__________
Les centres pour l’enfant et la famille ON y va offrent aux enfants – de la naissance jusqu’à l’âge de 6 ans – la possibilité de participer à des programmes basés sur le jeu et le questionnement, et procurent aux parents et aux responsables d’enfants du soutien pour mener à bien leur rôle. L’objectif de ON y va est d’améliorer la qualité et la cohérence des programmes destinés aux enfants et aux familles en Ontario.
__________
Depuis plus de 100 ans, Family Service Toronto soutient les individus et les familles par le biais de programmes de counseling, de développement communautaire, de défense des droits et d’éducation publique. Cela comprend des services directs en matière d’intervention et de prévention, comme du counseling, du soutien par les pairs et de l’éducation; des activités de création et d’échange de connaissances; ainsi qu’une action sur les systèmes, notamment l’action sociale, la défense des droits, le renforcement communautaire et la collaboration avec des partenaires dans le but de consolider le secteur.
__________
Fondé en 2001 et situé au Sherbourne Health Centre (à Toronto, en Ontario), le LGBTQ+ Parenting Network soutient les parents gais et lesbiennes, bisexuels, trans et allosexuels par le développement de ressources, la formation et l’organisation communautaire. Le réseau assure la coordination d’un éventail de programmes et d’activités avec et pour les parents LGBTQ, les parents potentiels et leur famille. Il propose notamment des infolettres, des ressources imprimées, des groupes de soutien, des activités sociales, des projets de recherche, des initiatives de sensibilisation et de la formation.
__________
Depuis plus de 30 ans, Racines de l’empathie s’efforce d’établir des sociétés bienveillantes, pacifiques et empreintes de civilité en stimulant le développement de l’empathie chez les enfants et les adultes. Les objectifs de Racines de l’empathie sont de favoriser le développement de l’empathie, d’inculquer la maîtrise des émotions, de réduire les niveaux d’intimidation, d’agression et de violence, de promouvoir les comportements prosociaux chez les enfants, d’améliorer la compréhension du développement humain, de l’apprentissage et de la sécurité du nourrisson, et de préparer les participants à devenir des citoyens responsables et des parents sensibles.
__________
Depuis 1974, la Sunshine Coast Community Services Society (SCCSS) offre divers services aux individus et aux familles de la région de Sunshine Coast (en Colombie-Britannique). Les programmes sont axés sur le counseling pour les enfants et les familles; les services relatifs au développement de l’enfant et de l’adolescent; les initiatives et l’engagement communautaires; la violence familiale; et le logement.
Notes
- L’ACS+ est un processus analytique qui sert à évaluer les répercussions potentielles des politiques, des programmes et des initiatives sur divers ensembles de personnes : femmes, hommes et individus non binaires. Le « plus » dans ACS+ reconnaît que l’ACS ne se limite pas aux différences biologiques (le sexe) et socioculturelles (le genre). L’identité sexuelle est déterminée par une multitude de facteurs qui se recoupent et font de nous ce que nous sommes; l’ACS+ tient également compte de nombreux autres facteurs identitaires, comme la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge et le fait de vivre avec une incapacité mentale ou physique. Lien : https://bit.ly/30uatJo
- Gouvernement du Canada, « Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l’éclosion » (16 juillet 2020). Lien : https://bit.ly/3fN48iE
- Marc Montgomery, « COVID-19 Deaths: Calls for Government to Take Control of Long Term Care Homes » dans Radio-Canada International (25 mai 2020). Lien : https://bit.ly/2ZMnteo
- Un sondage de la firme Léger, de l’Association d’études canadiennes et de l’Institut Vanier de la famille mené sur une base hebdomadaire à partir du mois de mars (commençant du 10 au 12 mars), et tout au long des mois d’avril et de mai 2020, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Certains sondages hebdomadaires comprenaient également un échantillon de rappel composé de groupes spécifiques de la population. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Statistique Canada, « Série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes 1 : Répercussions de la COVID-19 » dans Le Quotidien (8 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2ODMEJE
- Ibidem
- Bien que les données varient, des rapports affirment que les consultations menées par le gouvernement fédéral ont révélé une augmentation de 20 % à 30 % des taux de violence dans certaines régions, soit des observations soutenues par des organismes comme Battered Women Support Services de Vancouver, qui ont signalé une augmentation de 300 % du nombre d’appels liés à la violence familiale pendant la pandémie. Liens : https://bit.ly/2OKYsK0 / https://bit.ly/2ZOiF8f
- Sondage mené par la firme Léger, l’Association d’études canadiennes et l’Institut Vanier de la famille.
- Statistique Canada, « La santé mentale des Canadiens durant la pandémie de COVID-19 » (27 mai 2020). Lien : https://bit.ly/2OGKE3f
- Ibidem
- Sondage mené par la firme Léger, l’Association d’études canadiennes et l’Institut Vanier de la famille.
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Le système de soins de santé du Canada est financé par les fonds publics, ce qui signifie que tous les résidents canadiens ont un accès satisfaisant aux services hospitaliers et médicaux qui sont médicalement nécessaires sans devoir payer directement de leur poche. Lien : https://bit.ly/2WEoEu5
- Sondage mené par la firme Léger, l’Association d’études canadiennes et l’Institut Vanier de la famille.
- Angus Reid Institute, « Worry, Gratitude & Boredom: As COVID‑19 Affects Mental, Financial Health, Who Fares Better; Who Is Worse? » (27 avril 2020). Lien : http://angusreid.org/covid19-mental-health/
- Sondage mené par la firme Léger, l’Association d’études canadiennes et l’Institut Vanier de la famille.
- Ibidem
- Statistique Canada, « Série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes 1 : Répercussions de la COVID-19 ».
- Beatrice Britneff, « Food Banks’ Demand Surges Amid COVID-19. Now They Worry About Long-Term Pressures » dans Global News (15 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3boEHRe
- Le 17 octobre 2018, la consommation de cannabis à des fins récréatives et médicales chez les adultes est devenue légale au Canada. Lien : https://bit.ly/2CMWRRf
- Michelle Rotermann, « Les Canadiens qui s’estiment en moins bonne santé mentale pendant la pandémie de COVID-19 sont plus susceptibles de déclarer une consommation accrue de cannabis, d’alcool et de produits du tabac » dans StatCan et la COVID‑19 : Des données aux connaissances, pour bâtir un Canada meilleur (15 juillet 2020). Lien : https://bit.ly/2CmAwu7
- Le Réseau COVID‑19 sur les impacts sociaux de l’Association d’études canadiennes, en partenariat avec Expériences Canada et l’Institut Vanier de la famille, a mené un sondage Web national sur la COVID-19 auprès de la population des 12 à 17 ans au Canada du 29 avril au 5 mai 2020. Au total, 1 191 réponses ont été reçues, et la marge d’erreur probabiliste était de ±3 %. Lien : https://bit.ly/32JVSMq
- Ibidem
- Ibidem
- Angus Reid Institute, « Kids & COVID-19: Canadian Children Are Done with School from Home, Fear Falling Behind, and Miss Their Friends » (11 mai 2020). Lien : https://bit.ly/30ymZHR
- Ibidem
- Le Réseau COVID‑19 sur les impacts sociaux de l’Association d’études canadiennes.
- Ibidem
- Ibidem
- Agence du revenu du Canada, « Allocation canadienne pour enfants » (24 juin 2020). Lien : https://bit.ly/30v6vA3
- Gouvernement du Canada, « Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 » (17 juillet 2020). Lien : https://bit.ly/3jq7hXZ
- Gouvernement du Canada, « Allocation canadienne pour enfants : Combien vous pourriez recevoir » (27 janvier 2020). Lien : https://bit.ly/39fuc3B
- Gouvernement du Canada, « Élargir l’admissibilité à la Prestation canadienne d’urgence et proposer un nouveau complément salarial pour les travailleurs essentiels » (17 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2CVmAa1
- Catherine Cullen et Kristen Everson, « Canadians Who Don’t Qualify for CERB Are Getting It Anyway – And Could Face Consequences » dans CBC News (1er mai 2020). Lien : https://bit.ly/39iQiC3
- Gouvernement du Canada, « Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 ».
- Gouvernement du Canada, « Crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) – Aperçu » (2 juillet 2020). Lien : https://bit.ly/2OK1i26
- Gouvernement du Canada, « Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 ».
- Ibidem
- Province de la Colombie-Britannique, « Province Provides Emergency Fund for Children With Special Needs » (8 avril 2020). Lien : https://bit.ly/30tkczv
- Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, « Nouvelles mesures : un contrôle plus rigoureux des voyageurs et une plus grande aide au revenu » (1er avril 2020). Lien : https://bit.ly/32BREGJ
- Gouvernement de l’Ontario, « Le gouvernement de l’Ontario soutient les familles en réaction à la COVID-19 » (6 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2OHNQvw
- Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, « Backgrounder and FAQs | Income Security Programs » (s.d.). Lien : https://bit.ly/2WEN6vI
- Emploi et Développement social Canada, « Apprentissage et la garde des jeunes enfants » (16 août 2019). Lien : https://bit.ly/2ZLwW5l
- Gouvernement du Canada, « Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones » (17 septembre 2018). Lien : https://bit.ly/3jq85vT
- Gouvernement du Canada, « Lettre de mandat du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social » (13 décembre 2019). Lien : https://bit.ly/2WGulbf
- Gouvernement du Canada, « Spécialement pour vous – Parents » (20 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3hmBeX4
- Parti libéral du Canada, « Choisir d’avancer : Plus de temps et d’argent afin d’aider les familles à élever leurs enfants. » Lien : https://bit.ly/2ZNiIkp
- Agence de la consommation en matière financière du Canada, « Prestations de maternité et prestations parentales » (17 août 2017). Lien : https://bit.ly/3fQVHCT
- Gouvernement du Québec, « Régime québécois d’assurance parentale : De quel type de prestation puis-je bénéficier? » (30 mai 2017).
- Gouvernement du Canada, Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2017 et se terminant le 31 mars 2018 (1er juin 2019). Lien : https://bit.ly/2WJ4fEe
- Ministère de la Justice, « Améliorer et moderniser le système de justice familiale du Canada » (5 juin 2020). Lien : https://bit.ly/30sDKnI
- Gouvernement du Canada, Lois et politiques provinciales et territoriales sur la protection des enfants – 2018 (13 mai 2019). Lien : https://bit.ly/3ePqmPy
- Kathy Lynn, « Le débat canadien sur la “fessée” et la violence envers les enfants », L’Institut Vanier de la famille (15 novembre 2016).
- Y’a personne de parfait, Renseignements sur l’art d’être parent (s.d.). Lien : https://bit.ly/3fNo58R
- Agence de la santé publique du Canada, « Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques (PAPACUN) » (10 avril 2018). Lien : https://bit.ly/2ZNPKB4
- Pour plus de renseignements sur les organismes offrant les programmes ou les services aux parents qui sont mentionnés dans la présente
section, veuillez vous référer à l’Annexe A. - L’Institut Vanier de la famille, « En contexte : comprendre les soins de maternité au Canada » (11 mai 2017).
L’IMPACT DE LA COVID-19 : Le bien-être des jeunes au Canada
Edward Ng, Ph. D., et Nadine Badets
27 août 2020
Le printemps et l’été 2020 ont été une période unique pour les enfants et les adolescents au Canada. Les familles partout au pays ont adapté leurs habitudes, leurs plans et leurs activités pour respecter la distanciation physique et autres mesures de santé publique mises en place pour prévenir la propagation de la COVID-19. Après la fermeture des écoles au printemps, près de cinq millions d’élèves se sont retrouvés en ligne plutôt qu’en classe, sans pouvoir côtoyer leurs camarades et leurs amis; en famille, ils ont apprivoisé la situation évolutive1.
Si les études montrent que la plupart des jeunes respectent les mesures de santé publique et font preuve de résilience, ils sont nombreux à trouver ces bouleversements ardus. Un sondage mené par UNICEF Canada auprès des jeunes révèle les éléments les plus difficiles pour eux : l’impossibilité de sortir de la maison, d’aller à l’école et de passer du temps avec leurs amis2. Ces activités sont importantes pour le bien-être des enfants et des adolescents. Les recherches soulignent en effet le caractère essentiel des interactions sociales pour le développement des jeunes, l’influence positive des pairs étant déterminante dans la réussite scolaire et le succès à l’âge adulte3.
Les jeunes s’inquiètent davantage que les membres de leur famille contractent la COVID-19 que de la contracter eux-mêmes
Les jeunes se sont pour la plupart isolés à la maison, mais certains membres de leur famille immédiate ont continué à se rendre au travail, risquant ainsi de contracter la maladie et de la transmettre.
Dans le sondage sur les impacts sociaux de la COVID-19 mené auprès des jeunes à la mi-mai par l’Association d’études canadiennes, en partenariat avec Expériences Canada et l’Institut Vanier de la famille, près de 4 adolescents de 12 à 17 ans interrogés sur 10 (39 %) ont dit être inquiets de contracter la maladie4, comparativement à plus de la moitié (56 %) des répondants adultes questionnés au début du mois de mai5. Cet écart peut s’expliquer en partie par la perception actuelle d’un plus faible risque de complications de la COVID-19 chez les groupes plus jeunes. En outre, les mêmes ensembles de données du sondage révèlent une plus grande peur des jeunes et des adultes (71 % et 67 %, respectivement) qu’un membre de leur famille immédiate contracte le virus.
De l’ennui, mais du bonheur aussi pour la plupart des jeunes dans le contexte des mesures de santé publique et de la distanciation physique
Dans le même sondage, plus de 80 % des répondants ont signalé qu’ils s’ennuyaient, mais, fait intéressant, une proportion semblable a aussi exprimé être heureuse (89 % des 12 à 14 ans et 84 % des 15 à 17 ans)6. Ces émotions peuvent être en partie causées par les changements d’emploi du temps occasionnés par la fermeture des écoles. Près de 7 jeunes sur 10 ont répondu qu’ils se détendaient plus qu’avant la pandémie : parmi les activités habituelles, ceux-ci disaient visionner des vidéos, des films et des émissions télévisées, ou écouter des balados (78 %), passer du temps sur les médias sociaux (63 %), écouter de la musique (59 %) et jouer à des jeux électroniques (51 %). Les jeunes qui ont déclaré s’ennuyer ou être heureux pendant la pandémie étaient plus susceptibles de répondre qu’ils avaient passé plus de temps à regarder des vidéos, des films ou des émissions télévisées pendant la pandémie qu’avant celle-ci (79 % et 81 %, respectivement).
Bien que la technologie puisse avoir pris plus de place dans la vie de quantité de personnes, elle ne constitue pas la seule façon de s’occuper des jeunes. Près de la moitié (45 %) des participants au sondage ont mentionné qu’ils contribuaient davantage qu’avant aux tâches ménagères, et plus du tiers s’adonne plus à l’art ou au bricolage (36 %), ou font plus de casse-têtes (35 %) qu’avant la pandémie7.
Par ailleurs, même avant la crise sanitaire, les parents exprimaient déjà leurs inquiétudes en lien avec l’obsession des jeunes envers la technologie8, 9. Pendant le confinement, quelque 64 % des parents ayant répondu à une enquête de production participative (crowdsourcing) menée par Statistique Canada étaient inquiets de la quantité de temps passé devant les écrans par leurs enfants10. Toutefois, selon l’UNICEF, les études les plus fiables soutiennent que l’utilisation modérée de la technologie numérique tend à être positive pour le bien-être mental des enfants et des adolescents; à l’inverse, l’utilisation excessive ou l’absence d’utilisation peut avoir un léger effet négatif11. Quant à Internet et à la technologie numérique, bien qu’ils procurent aide et sens d’inclusion, ils présentent aussi un risque de cyberintimidation, peuvent influer sur la santé mentale et aggraver des troubles du sommeil12.
Plus du tiers des jeunes sondés estiment leur santé mentale affectée
Avant la COVID-19, les faits étaient connus : les taux de maladies mentales et de mauvaise santé mentale étaient plus élevés chez les jeunes que chez les groupes plus âgés au Canada. Par exemple, le taux de dépression des 15 à 24 ans surpassait celui de tout autre groupe d’âge13. Une étude récente des données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes montre une baisse de 6 % des jeunes de 12 à 17 ans signalant une excellente ou une très bonne santé mentale de 2015 à 2019 (78 % et 73 %, respectivement)14. Qui plus est, en 2018, le suicide était la cause première de décès chez les garçons de 15 à 19 ans, et la deuxième chez les jeunes filles du même groupe d’âge au Canada15.
À la mi-mai, plus du tiers (37 %) des répondants au sondage sur les jeunes ont indiqué avoir ressenti des effets négatifs sur leur santé mentale16. Comparativement à des participants de 18 ans et plus interrogés au début du mois de mai17, les 12 à 17 ans ont exprimé davantage de tristesse (57 % contre 45 %, respectivement) et d’irritabilité (65 % et 39 %) que les adultes. Ils ont aussi signalé plus de troubles de sommeil (50 % contre 35 %).
Un autre sondage mené du 10 au 14 avril 2020 auprès d’adolescents et de jeunes adultes de 14 à 27 ans pour le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) a aussi noté un déclin sur le plan de la santé mentale au début de la pandémie, autant chez les jeunes souffrant de problèmes de santé mentale préexistants que chez ceux qui n’en vivaient pas18.
Un effet immédiat des répercussions de la pandémie sur la santé mentale est la hausse de la demande de services de soutien pour les jeunes dans ce domaine. Jeunesse, J’écoute, un service téléphonique national 24 h/24, 7 j/7 de soutien et d’aide en situation de crise pour les enfants et les adolescents, a reçu près de 2 000 appels et textos par jour19 à la mi-mars 2020, soit deux fois plus que l’année précédente. Le nombre d’appels liés à des crises a aussi augmenté, ce qui s’est traduit par davantage d’interventions des services d’urgence qu’à l’habitude, l’organisme effectuant chaque jour 8 à 10 appels à ces services depuis le début de la pandémie.
Passer plus de temps de qualité en famille, mais s’ennuyer de ses amis
Le transfert du travail et de l’école à la maison, de même que les changements d’habitudes et d’horaires, a offert aux familles plus d’occasions de tisser des liens. Les données du sondage de la mi-mai mené auprès des jeunes le confirment : les deux tiers (67 %) des répondants affirment avoir tenu des conversations plus significatives en famille pendant la pandémie qu’avant20. En comparaison, seulement 50 % des adultes sondés au début du même mois ont indiqué avoir entretenu des échanges plus enrichissants avec leur conjoint ou partenaire.
Sur le plan familial, près du quart (24 %) des parents ont répondu qu’ils avaient passé plus de temps avec leurs enfants pendant le confinement21. La grande majorité des répondants, jeunes comme adultes (74 % et 81 %, respectivement), ont indiqué que les membres de leur famille s’aidaient les uns les autres. Par contre, quelque 43 % des jeunes ont signalé qu’ils se querellaient davantage avec eux, et seulement 19 % des adultes ont affirmé qu’ils se disputaient davantage avec leur conjoint ou partenaire.
En revanche, les jeunes ressentent une grande perte de liens avec leurs amis. Environ 70 % d’entre eux ont affirmé s’être confinés durant la pandémie, sauf pour combler des besoins essentiels. Seuls 24 % ont mentionné avoir visité des amis ou des membres de leur famille pendant la semaine précédant le sondage22.
Selon l’Angus Reid Institute, les jeunes ont affirmé que le pire du confinement à la maison était de s’ennuyer de leurs amis (54 %)23. Plus de la moitié (53 %) d’entre eux ont mentionné que l’isolement dû à la COVID-19 avait eu des effets négatifs sur leurs relations avec leurs amis24. L’enquête de production participative menée par Statistique Canada fournit aussi le point de vue des parents. Près des trois quarts (71 %) des participants étaient inquiets du manque de contacts de leurs enfants avec leurs amis, et 54 % d’entre eux se faisaient du souci au sujet de l’isolement social de leurs enfants25.
L’apprentissage à distance pendant la pandémie de COVID-19 : une leçon difficile?
La gestion de l’école virtuelle à la maison s’est avérée un défi pour de nombreuses familles et quantité d’enseignants partout au Canada. On a décrit cet apprentissage en ligne imposé par la pandémie comme la plus importante expérience d’apprentissage à distance de l’histoire26. À la suite de la fermeture soudaine des écoles, les enseignants ont dû adapter leur façon d’enseigner avec peu de formation et de ressources.
Plus de la moitié (51 %) des jeunes ont affirmé que la pandémie a eu un effet très négatif sur leur année ou leur réussite scolaire27. Seulement 27 % ont répondu qu’ils sont entièrement d’accord et 43 %, partiellement d’accord, avec l’énoncé indiquant qu’ils accomplissent bien leurs travaux scolaires à la maison.
Environ 41 % des 12 à 17 ans ont confié que l’école leur manquait « beaucoup » et 31 %, « un peu ». Parmi les nombreux défis de l’apprentissage à distance, citons la perte de contacts avec les amis, l’école et les ressources scolaires, le manque de motivation, la gestion du temps et l’organisation en ligne28. Bien que 75 % des jeunes soutiennent qu’ils ont gardé le cap sur leurs études pendant le confinement, quantité d’autres se sentaient démotivés (60 %) et n’aimaient pas la façon de faire (57 %) (p. ex., l’apprentissage en ligne et les classes virtuelles)29.
L’apprentissage à distance nécessite un accès à Internet, et si l’Enquête canadienne sur l’utilisation de l’Internet de 2018 a révélé que 94 % des Canadiens disposaient d’un tel accès à domicile, il existe néanmoins des inégalités dans la capacité des élèves à participer activement à l’éducation en ligne. Quelques raisons invoquées par ceux qui n’avaient pas accès à Internet : le caractère abordable du service (28 %), l’équipement (19 %) et la non-disponibilité du service (8 %)30.
Bien qu’environ 8 jeunes sur 10 ont déclaré avoir toujours assez d’argent pour subvenir à leurs besoins essentiels, comme l’alimentation, les vêtements, les soins de santé et le logement31, répondre aux besoins fondamentaux et accéder à un endroit confortable pour étudier pendant la pandémie peut être encore plus difficile pour les jeunes et les familles à faible revenu ou qui viennent de perdre leur emploi et leur revenu. En outre, les fermetures d’écoles peuvent avoir des répercussions sur la sécurité alimentaire, car certains programmes de repas scolaires ont été conçus pour atténuer l’insécurité alimentaire des élèves issus de familles à faible revenu32.
Le suivi à long terme des effets de la COVID-19 est important pour le bien-être des jeunes
Sans école, sans activités parascolaires, sans autres occasions de voir leurs pairs, les jeunes perdent un temps précieux pour socialiser avec leurs amis, leurs camarades de classe, leurs enseignants, leurs entraîneurs et d’autres professionnels, alors que toutes ces relations pourraient être fondamentales pour leur parcours scolaire et le développement de leur personnalité. Bien que les médias sociaux, les textos, les appels téléphoniques et autres technologies de communication ont certainement permis d’atténuer quelque peu ce manque de contacts, la santé mentale des jeunes au Canada a été grandement affectée pendant la pandémie.
Des études antérieures sur les répercussions des interruptions scolaires, comme les grèves d’enseignants et les fermetures d’écoles pendant la pandémie de polio de 1916, ont cerné les effets négatifs à court et à long termes sur le développement scolaire et l’acquisition de connaissances33, 34, 35. Une étude récente concernant les répercussions potentielles de la pandémie sur l’éducation des jeunes au Canada a souligné que les effets négatifs pourraient accroître l’écart en termes de compétences socioéconomiques de 30 %, rien de moins36. Pendant que les autorités provinciales et les conseils scolaires étudient la manière de procéder pour rouvrir les écoles de manière sûre afin de limiter la propagation de la COVID-1937, il sera important de faire preuve d’innovation pour adapter notre système d’éducation et ainsi éviter ou atténuer les écarts en matière de rendement scolaire, dès aujourd’hui et dans les années à venir.
Edward Ng, Ph. D., Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Nadine Badets, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Notes
- Erin Duffin, « Enrollment in Public Elementary and Secondary Schools in Canada in 2017/18, by Province » dans Statista (29 octobre 2019). Lien : https://bit.ly/311SjPn
- UNICEF Canada, U-Report Canada: Impacts of the COVID-19 Pandemic on Young People in Canada – Poll 2: Examining the Issues (mai 2020). Lien : https://bit.ly/2YuMCcr (PDF)
- Shqiponja Telhaj, « Do Social Interactions in the Classroom Improve Academic Attainment? » dans IZA World of Labor (juin 2018). Lien : https://bit.ly/3hPqGzR
- Association d’études canadiennes, Les impacts de la COVID-19 sur la jeunesse canadienne (21 mai 2020). Lien : https://bit.ly/31oB8sA (PDF). Le Réseau COVID-19 sur les impacts sociaux de l’Association d’études canadiennes, en partenariat avec Expériences Canada et l’Institut Vanier de la famille, a mené un sondage Web national sur la COVID-19 auprès de la population des 12 à 17 ans au Canada du 29 avril au 5 mai 2020. Au total, 1 191 réponses ont été reçues, et la marge d’erreur probabiliste était de ±3 %.
- Un sondage de l’Institut Vanier de la famille, de l’Association d’études canadiennes et de la firme Léger, mené du 1er au 3 mai 2020, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 526 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
- Association d’études canadiennes, Les impacts de la COVID-19 sur la jeunesse canadienne.
- Ibidem
- Monica Anderson et Jingjing Jiang, « Teens, Social Media & Technology 2018 » dans Pew Research Center (31 mai 2018). Lien : https://pewrsr.ch/30aWglE (PDF)
- Wesley Sanders, et autres. « Parental Perceptions of Technology and Technology-Focused Parenting: Associations with Youth Screen Time » dans Journal of Applied Developmental Psychology (mai-juin 2016). Lien : https://bit.ly/30gsCeV
- Statistique Canada, « Les répercussions de la COVID-19 sur les familles et les enfants canadiens » dans Le Quotidien (9 juillet 2020). Lien : https://bit.ly/3liSn6u
- Daniel Kardefelt-Winther, How Does the Time Children Spend Using Digital Technology Impact Their Mental Well-Being, Social Relationships and Physical Activity? An Evidence-Focused Literature Review, UNICEF (décembre 2017). Lien : https://bit.ly/33b3TKQ (PDF)
- OCDE, « Children & Young People’s Mental Health in the Digital Age » (2018). Lien : https://bit.ly/3jXBFcg (PDF)
- Leanne Findley, « Dépression et idéation suicidaire chez les Canadiens de 15 à 24 ans » dans Rapports sur la santé, no 82-003-X au catalogue de Statistique Canada, vol. 28, no 1, 3-11 (18 janvier 2017). Lien : https://bit.ly/3hre1mN
- Statistique Canada, « Comprendre l’état de santé mentale perçu des Canadiens avant la pandémie de COVID-19 » dans Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2019 (6 août 2020). Lien : https://bit.ly/3hmrWdX
- Statistique Canada, « Les principales causes de décès, population totale, selon le groupe d’âge », tableau 13-10-0394-01 (consulté le 13 août 2020). Lien : https://bit.ly/2QphM0l
- Association d’études canadiennes, Les impacts de la COVID-19 sur la jeunesse canadienne.
- Un sondage de l’Institut Vanier de la famille, de l’Association d’études canadiennes et de la firme Léger, mené du 1er au 3 mai 2020, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 526 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
- Robert Cribb, « Youth Mental Health Deteriorating Under Pandemic Stresses, New CAMH Study Reveals » dans The Star (28 mai 2020). Lien : https://bit.ly/3ikLMaf
- Jeff Semple, « Kids Help Phone Calls for Back Up Amid Record Demand – and Canadians Respond » dans Global News (28 juin 2020). Lien : https://bit.ly/3gbeDMr
- Association d’études canadiennes, Les impacts de la COVID-19 sur la jeunesse canadienne.
- Ibidem
- Ibidem
- Angus Reid Institute, Kids & COVID-19: Canadian Children Are Done with School from Home, Fear Falling Behind, and Miss Their Friends (11 mai 2020). Lien : https://bit.ly/3kVRReK
- Association d’études canadiennes, Les impacts de la COVID-19 sur la jeunesse canadienne.
- Statistique Canada, « Les répercussions de la COVID-19 sur les familles et les enfants canadiens » dans Le Quotidien (9 juillet 2020). Lien : https://bit.ly/3liSn6u
- Paul W. Bennett, « This Grand Distance-Learning Experiment’s Lessons Go Well Beyond What the Students Are Learning » dans CBC News (11 mai 2020). Lien : https://bit.ly/33bNEgo
- Association d’études canadiennes, Les impacts de la COVID-19 sur la jeunesse canadienne.
- UNICEF Canada, U-Report Canada: Impacts of the COVID-19 Pandemic on Young People in Canada – Poll 2: Examining the Issues (mai 2020). Lien : https://bit.ly/2YuMCcr (PDF)
- Association d’études canadiennes, Les impacts de la COVID-19 sur la jeunesse canadienne.
- Statistique Canada, « Enquête canadienne sur l’utilisation de l’Internet » dans Le Quotidien (29 octobre 2019). Lien : https://bit.ly/2EtokZ4
- Association d’études canadiennes, Les impacts de la COVID-19 sur la jeunesse canadienne.
- Canadian Medical Association Journal, « Indirect Adverse Effects of COVID-19 on Children and Youth’s Mental, Physical Health » dans EurekAlert (25 juin 2020). Lien : https://bit.ly/2BWMvOr
- Michael Baker, « Industrial Actions in Schools: Strikes and Student Achievement » dans Canadian Journal of Economics (mars 2011). Lien : https://bit.ly/3gaona6
- Michèle Belot et Dinand Webbink, « Do Teacher Strikes Harm Educational Attainment of Students? » dans Labour Economics, vol. 24, no 4, p. 391-406 (2010). Lien : https://bit.ly/3aYuJI3
- Keith Meyers et Melissa A. Thomasson, « Paralyzed by Panic: Measuring the Effect of School Closures During the 1916 Polio Pandemic on Educational Attainment » dans NBER Working Paper Series 23890 (septembre 2017). Lien : https://bit.ly/3hSzswU (PDF)
- Catherine Haeck et Pierre Lefebvre, « Pandemic School Closures May Increase Inequality in Test Scores » dans Série de cahiers de recherche du Groupe de recherche sur le capital humain (juin 2020). Lien : https://bit.ly/30elgbN (PDF)
- Carly Weeks, « Rising Rates of COVID-19 in Children, Adolescents Spark Concerns About Back to School Plans » dans The Globe and Mail (23 juin 2020). Lien : https://tgam.ca/3hTmFuk
Entretien avec Katherine Arnup au sujet de la mort, de la fin de vie et de la dignité en période de COVID-19
Gaby Novoa
4 août 2020
En mai 2018, l’Institut Vanier publiait le document de Katherine Arnup, Ph. D., intitulé Perspectives familiales : La mort et le processus de fin de vie au Canada1, qui examinait l’évolution de la mort et de la fin de vie au fil des générations, les souhaits et les réalités des familles entourant la mort et la fin de vie, le rôle des familles dans les soins de fin de vie et l’impact de ce rôle sur le bien-être de la famille.
Dans le cadre des discussions actuelles entourant la COVID-19 et le contexte postpandémie, nous nous sommes entretenus avec Mme Arnup afin de nous enquérir de ses perspectives à l’égard de certains thèmes abordés dans son rapport de 2018, et de l’impact de la pandémie sur les discussions entourant la mort et le processus de fin de vie au Canada.
Selon vous, quel a été l’impact de la COVID-19 sur les discussions et les attitudes relatives à la mort et à la fin de vie au sein des familles et chez les décideurs politiques au Canada.
À plusieurs égards, la mort occupe présentement une plus grande place sur la scène publique que ce n’était le cas avant la COVID-19, et ce, depuis le moment où l’on a révélé que le virus s’était répandu dans le monde entier, car plusieurs pays ont enregistré de nombreux décès avant que le virus ne frappe réellement ici. Les gens avaient conscience qu’il se passait un événement important en lien avec la mort.
Au Canada, on nous annonçait le nombre quotidien de décès, d’hospitalisations et de cas, comme si nous étions en temps de guerre. Ces données, accompagnées de diverses images de guerre, étaient presque impossibles à éviter, vraiment : je n’ai jamais rien vu de tel dans toute ma vie! Par exemple, si vous visitez le site Web de CBC, la première chose que vous voyez est le décompte actuel, ce qui vous tient au fait du nombre de personnes qui sont décédées. On ne peut pas y échapper, on nous le rappelle constamment. On se croirait « en guerre » contre un virus. Surtout au début, on avait l’impression qu’il pouvait se trouver n’importe où, que les gens près de nous pouvaient être porteurs, que nous pouvions l’attraper et qu’il pouvait nous tuer. On ressentait beaucoup de peur – la peur du virus et la peur de mourir.
Selon l’un des thèmes abordés dans le document Perspectives familiales : La mort et le processus de fin de vie au Canada, les gens éprouvent de la peur à l’égard de la mort et de la fin de vie, et cette peur dissuade les familles d’avoir des discussions sérieuses à ce sujet. Croyez-vous que la pandémie ait amené les gens à réfléchir à la mort de façon plus approfondie, ou est-ce que l’anxiété et la peur ambiantes ont plutôt fait en sorte que l’on évite davantage de parler de la mort et de la fin de vie?
Je pencherais pour cette dernière réponse. Dans mon rapport, je parlais d’une sorte d’acceptation de la mort et de la planification de la mort. Mais il y a tellement d’incertitudes entourant la COVID, et elle a frappé tant de gens partout dans le monde, ce qui fait que le contexte est différent de tout ce que l’on a connu auparavant.
Je crois que l’un des groupes qui ont été les plus exposés à la COVID-19 et à la mort tout au long de la pandémie est celui des aînés et de leur famille. Il est vrai que le virus représente pour eux un risque plus important que pour tout autre groupe, bien qu’il y ait d’autres facteurs de vulnérabilité à considérer. Cependant, les personnes âgées, et plus particulièrement les octogénaires et les nonagénaires ainsi que les personnes souffrant de comorbidités, sont susceptibles de subir des effets déplorables et peut-être même de mourir après avoir contracté le coronavirus.
Cela a particulièrement été le cas dans les établissements de soins de longue durée. En Ontario, l’un des premiers établissements de soins de longue durée ayant ouvert les yeux du public sur la situation est celui de Bobcaygeon, une résidence où plusieurs décès ont été enregistrés sur une courte période. Globalement, les données les plus récentes à cet égard montrent que 81 % des décès au pays ont eu lieu dans le secteur des soins de longue durée, comparativement à la moyenne de 42 % dans les pays développés de l’OCDE2. Les chiffres sont beaucoup plus élevés au Canada, si bien que l’on a appelé « l’armée en renfort » en Ontario et au Québec, pour utiliser les métaphores militaires et de guerre. Dans ces résidences de soins de longue durée, l’armée a fait état de conditions particulièrement effroyables3.
Aujourd’hui, ma perception des résidences de soins de longue durée est vraiment différente de celle que j’en avais auparavant. Je crois que j’étais simplement comme la plupart des Canadiens, à savoir que je ne pensais pas à ces résidences si ce n’est qu’en me disant « J’espère que je ne me retrouverai jamais là! », et à mon sens, c’est très typique des Canadiens. C’est peut-être aussi le cas des gens dans d’autres pays, mais je ne peux parler qu’au nom des Canadiens, et cela correspond d’ailleurs à certaines choses que j’ai écrites, notamment dans le rapport de 2018 : nous voulons vivre éternellement, mais nous voulons demeurer forts, en bonne santé et autonomes – des valeurs essentielles pour nous.
Pour la plupart, nous n’avons pas envie de penser à ce que vivent les gens en soins de longue durée, c’est pourquoi nous ne nous étions pas intéressés aux conditions de vie qui règnent dans ces établissements – alors que certaines d’entre elles étaient déjà problématiques avant la pandémie. Par exemple, on retrouve souvent quatre personnes par chambre, le personnel travaille dans plusieurs résidences, en sous-effectif, et est très occupé à courir d’un patient à un autre, avant de se rendre dans une autre résidence. Ces conditions régnaient déjà dans plusieurs établissements, ce qui a créé un contexte favorable pour que la pandémie envahisse le secteur des soins de longue durée et en décime la population.
Je crois que la situation a permis d’ouvrir les yeux de ceux qui ont de la parenté dans les résidences de soins de longue durée. Ils avaient peut-être une petite idée des conditions que l’on y trouve, et certains étaient des aidants actifs dans ces résidences – c’est-à-dire qu’ils s’y rendaient pour prendre soin de leurs proches – alors que d’autres ne les visitaient presque jamais. Ma tante se trouvait dans une résidence de soins de longue durée située dans une petite ville à proximité de Bobcaygeon. Je lui ai rendu visite lorsqu’elle était en fin de vie, et je dois dire que j’ai été très impressionnée par cette résidence. Ma tante avait sa propre chambre et l’on voyait que le personnel s’occupait bien des patients, des résidents. Je ne crois pas que toutes les images négatives qui ont été véhiculées à cet égard s’appliquent à tous les soins de longue durée. Mais on a tendance à l’oublier.
Pat Armstrong, grande spécialiste des soins de la santé au Canada, a participé à une étude menée sur dix ans à propos des résidences de soins de longue durée4. Elle et son équipe rappellent aux gens que même si nous ne voulons pas y penser, plusieurs d’entre nous sont susceptibles de se retrouver en soins de longue durée, et ce, possiblement du jour au lendemain : un accident grave ou un AVC, une chute qui entraîne une perte d’autonomie, un diagnostic de démence… Tout cela pourrait faire en sorte que je me retrouve dans une résidence de soins de longue durée. Comme la plupart des gens, je n’en ai pas envie, mais nous avons tous tendance à croire que ce genre de situation n’arrive qu’aux autres et pas à nous. Je crois que la crise nous a fait prendre conscience que cela peut toucher n’importe qui – notre mère, notre père, nos frères et sœurs, nous-mêmes. Il suffit d’un seul changement dans notre vie – et un seul est nécessaire – pour que nous nous retrouvions également en soins de longue durée. Il s’agit d’un rappel que nous devons nous battre afin de réformer ces institutions et de modifier la façon dont les gens meurent.
Alors que je relisais la liste des souhaits et des présomptions abordés dans le rapport, je me suis rendu compte que deux d’entre eux étaient mis en évidence dans le rapport militaire : nous voulons mourir à la maison et nous voulons mourir dans la dignité. Or, la dignité des gens en fin de vie dans les résidences de soins de longue durée a de toute évidence été compromise. En fait, il n’y avait même aucune dignité dans la manière dont on prenait soin d’eux, en raison des conditions qui y régnaient. Il est également évident que les gens se retrouvent dans ces établissements parce que leur famille ne peut pas prendre soin d’eux. Ce n’est pas parce que la famille ne se soucie pas d’eux. C’est parce que les exigences de leur propre vie ainsi que l’absence de soins à domicile les rendent incapables de s’occuper à long terme d’un membre de la famille atteint de démence et qui présente de plus en plus de comportements difficiles, ou d’un membre de la famille qui nécessite des soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
De nombreux Canadiens supposent également qu’ils sont en mesure d’obtenir, pour eux-mêmes et leur famille, tous les soins à domicile dont ils ont besoin. Or, en raison de la pandémie, plusieurs personnes ont annulé les soins à domicile qui devaient leur être dispensés, surtout au début, parce qu’ils avaient peur de contracter la COVID‑19 auprès de leur prestataire de soins. Ces derniers, par la nature de leur travail, se rendent généralement dans plusieurs domiciles, ce qui fait d’eux de potentiels porteurs du virus dans de nombreux foyers. Cela signifie que non seulement il n’y a pas suffisamment de soins à domicile en général, mais dans le contexte de la COVID, les gens étaient même réticents à laisser ces prestataires de soins entrer chez eux.
En plus de constater les défis préexistants dans plusieurs résidences de soins de longue durée, certaines vulnérabilités et inégalités ont été amplifiées par la pandémie. Avez-vous un quelconque espoir que les conditions des soins de longue durée soient maintenant mieux connues du public?
Je ressens le besoin de parler des résidences de soins de longue durée, et de faire pression sur les gouvernements afin qu’ils apportent des changements qui auront un impact énorme, comme des normes fédérales, ou l’inclusion des soins aux aînés dans la Loi canadienne sur la santé, de sorte que ce domaine devienne une responsabilité partagée entre les divers paliers de gouvernements.
Je pense que la crise a vraiment mobilisé les familles, qui ont constaté les lacunes ainsi que certaines raisons pour lesquelles les conditions sont aussi défavorables. La situation s’explique en partie par les résidences à but lucratif, qui enregistrent un nombre de décès plus élevé, mais aussi par le manque d’inspections et d’application des dispositions de la loi. Maintenant que la situation a été tragiquement portée à l’attention du public, je crois que nous pouvons espérer voir une amélioration, et j’espère que plusieurs ont pris conscience que cette situation pourrait les toucher, qu’il pourrait s’agir de leur famille.
Les personnes dont les enfants gravement handicapés vivent dans des logements de soins collectifs sont aussi confrontées aux mêmes problèmes, à savoir que leurs enfants ne peuvent pas être entourés de leur famille, car celle-ci n’est toujours pas autorisée dans ces résidences. Je vois de plus en plus de discussions sur les familles qui agissent comme proches aidants, afin qu’elles soient reconnues à titre d’aidants et non seulement comme visiteurs, comme c’est le cas présentement. L’Institut Vanier a d’ailleurs soulevé cette question. J’ai travaillé avec la Change Foundation à ce sujet, et il y a d’autres organismes qui ont fait des progrès dans ce domaine. Je suis donc optimiste et j’ai espoir que soient reconnus le rôle et l’importance des aidants dans la santé et le bien-être de ceux qui bénéficient de soins.
Par ailleurs, il semble y avoir plus d’ouverture par rapport à la tenue de discussions sur les directives préalables en matière de soins. Même si les gens ne parlent pas encore de ces questions, je crois que si un membre de leur famille contractait la COVID, ils prendraient conscience que nous ne savons pas toujours ce que les membres de notre famille souhaitent. Même si le sujet de la mort n’a pas été abordé de la meilleure façon qui soit, je crois qu’il ouvre des perspectives à ceux d’entre nous qui font valoir l’importance des soins anticipés. Il ouvre une porte de discussion permettant de démontrer aux gens qu’il s’agit d’une préoccupation réelle. Nous ne savons jamais à quel moment quelque chose peut nous arriver, et quelque chose va se produire. Il est important de savoir ce que chacun de nos proches désire. Nos enfants doivent savoir ce que nous voulons – je crois que la pandémie ouvre la porte à cela.
Je suis en train d’écrire et de réaliser des vidéos dans lesquelles je compte encourager les gens à discuter avec les membres de leur famille (si ce n’est déjà fait) de ce qu’ils souhaitent et des directives préalables qu’ils envisagent en matière de soins, parce que c’est un sujet vraiment important. Les membres de la famille ne devraient pas être contraints de dire « Je n’ai aucune idée de ce que maman voudrait »; c’est une erreur que l’on peut éviter.
Je me sens optimiste à ce sujet, et l’optimisme est une denrée rare en contexte de pandémie. Je suis optimiste quant au fait que nous sommes tous dans le même bateau, depuis le début de la pandémie. Notre premier ministre a insisté sur cette idée tous les jours dans ses discours, et d’autres l’ont fait aussi. Je crois qu’il y a eu un important mouvement favorisant la création d’un sentiment de communauté et d’entraide. Je l’ai observé dans mon propre voisinage – des personnes qui ne se parlaient jamais auparavant prennent des nouvelles les unes des autres. Lorsque nous sortons marcher, les gens nous demandent si nous allons bien et l’on voit qu’ils sont sincères. Je crois que c’est un impact étrangement positif de la pandémie. J’espère qu’il durera, que les gens continueront de rendre service à leurs voisins âgés et qu’ils seront plus ouverts à ceux qui pourraient avoir besoin d’aide dans leur rue. Tout ce qui renforce le sentiment d’appartenance à la communauté est, à mon sens, une excellente chose.
Vous abordez ce point dans votre vidéo « Expanding Our ‘Bubbles’ »5, à savoir que nous nous sentons rassurés à plusieurs égards par l’impression de vivre cette situation tous ensemble, même si vous ajoutez aussi qu’il est de plus en plus apparent que nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Peut-être vivons-nous tous cette situation, mais notre façon de la vivre varie grandement, ne serait-ce que par le risque accru auquel sont exposées les personnes âgées et d’autres groupes6. Pourriez-vous préciser votre pensée?
Lorsque l’on examine la répartition des régions qui demeurent encore sensibles à la COVID, on constate qu’il s’agit d’endroits où l’on retrouve des gens qui vivent dans la pauvreté, des personnes de couleur, des personnes qui occupent des emplois à haut risque dans le secteur de la santé et des services, ainsi que des personnes qui vivent en cohabitation en grands groupes, peut-être parce qu’elles ne peuvent pas se permettre de vivre autrement. Les éclosions importantes parmi les travailleurs migrants employés en agriculture et les travailleurs des usines de transformation des aliments démontrent également l’impact des inégalités de notre société sur la vulnérabilité des gens face à la pandémie.
L’incapacité des familles à organiser des funérailles, des veillées funèbres, des services ou des célébrations de la vie pendant la pandémie est un autre exemple qui démontre que les gens ne sont pas tous dans le même bateau. Je crois que les personnes qui ne sont pas en mesure de souligner le décès d’un proche avec leurs amis et leur famille sont très affectées par cette situation. De nombreuses familles n’ont pas pu tenir de service, quel qu’il soit, n’ont pas pu s’étreindre, n’ont pas pu se rassembler autrement qu’en petits groupes. Je me demande seulement ce qu’il advient de tous ces deuils.
Plusieurs personnes sont décédées seules. Les personnes qui se trouvaient dans les établissements de soins de longue durée et dans les hôpitaux sont décédées seules. Personne ne souhaite que cela arrive. Personne ne veut que leurs proches vivent cela, et nous ne voulons pas que cela nous arrive à nous. Il s’agit d’un principe important des soins palliatifs : que personne ne meure seul. Le fait que cette situation soit arrivée à grande échelle aux familles qui ont été laissées derrière engendre un chagrin énorme et un profond sentiment de culpabilité, qui se traduit en mots par « Je n’ai pas pu être là pour maman » ou « Je n’ai pas pu être aux côtés de maman à la fin de sa vie ». C’est un sentiment déchirant. Je ne sais pas comment les gens surmonteront cela; ils vont devoir tenter de refouler ces sentiments afin de les oublier. Je repense à toutes ces notices nécrologiques indiquant « En raison des circonstances, les cérémonies auront lieu à une date ultérieure ». Il m’est difficile d’imaginer toutes ces cérémonies, les endroits où elles auront lieu et si elles offriront le soutien dont les gens ont besoin pour faire leur deuil. C’est assurément la première fois que je suis témoin d’une telle situation dans ma vie.
Qu’est-ce qui vous permet de croire en un avenir meilleur?
Je songe à ces questions : que souhaitons-nous pour l’heure de notre mort? Mais aussi que souhaitons-nous en vieillissant? De quoi avons-nous besoin pour nous soutenir dans ce cheminement? Comment composons-nous, en général, avec le vieillissement et la démence? Qu’espérons-nous? Comment pouvons-nous créer des lieux qui se distinguent vraiment des résidences de soins de longue durée? Comment pouvons-nous faire en sorte de concrétiser ce type de milieu?
Katherine Arnup, Ph. D., est rédactrice, conférencière et accompagnatrice en développement personnel, ainsi que professeure à la retraite de l’Université Carleton. Auteure de Perspectives familiales : La mort et le processus de fin de vie au Canada (ainsi que de nombreux ouvrages, dont « I Don’t Have Time for This! : A Compassionate Guide to Caring for Your Parents and Yourself and Education for Motherhood »), elle a été la première à s’intéresser aux réalités familiales et a offert sa perspective unique sur la vie de famille tout au long de sa carrière.
Gaby Novoa est responsable des communications à l’Institut Vanier de la famille.
Cet entretien a été révisé afin d’atteindre une longueur, une fluidité et une clarté optimales.
Notes
- Katherine Arnup, Ph. D., Perspectives familiales : La mort et le processus de fin de vie au Canada, L’Institut Vanier de la famille (mai 2018).
- Institut canadien d’information sur la santé, « La pandémie dans le secteur des soins de longue durée : Où se situe le Canada par rapport aux autres pays? » dans ICIS (25 juin 2020). Lien : https://bit.ly/2PmrsYO
- Forces armées canadiennes, « Op LASER – JTFC Observations in Long Term Care Facilities in Ontario » dans CAF (20 mai 2020). Lien : https://bit.ly/2CJPnit
- Pat Armstrong est une éminente professeure de recherche en sociologie à l’Université York ainsi que membre de la Société royale du Canada. Lien : https://bit.ly/3g3XSDn
- Katherine Arnup, « Expanding Our “Bubbles” » (YouTube). Lien : https://bit.ly/2X15sqE
- Dans le document intitulé Perspectives familiales : La mort et le processus de fin de vie au Canada, Katherine Arnup écrit que les expériences liées à la mort et à la fin de vie sont tributaires de divers facteurs comme le genre, la race, le rang social, l’ethnie, la géographie, la marginalité, les capacités, l’identité sexuelle et l’identité de genre, l’état matrimonial ainsi que le statut d’Autochtone, de Première Nation, d’Inuit ou de Métis.
Adaptation des familles au Canada : Ma famille et son parcours en temps de COVID
Bien que la COVID-19 ait touché les familles des quatre coins du Canada ainsi que le paysage socioéconomique, culturel et contextuel qui teinte leur bien-être, la vie de famille ne s’est pas pour autant arrêtée. Qu’il s’agisse de concilier les responsabilités professionnelles et familiales, de se réunir au moment de célébrer des étapes importantes ou de s’épauler dans les moments difficiles, les gens trouvent des moyens divers et créatifs afin de poursuivre leurs activités, leur vie de famille.
Alors que les familles canadiennes s’affairent à gérer ces transitions, l’Institut Vanier de la famille s’engage à colliger, à compiler et à dépeindre les « histoires derrière les statistiques », afin de mettre en relief les forces, la résilience et la réalité des familles dans toute leur diversité au pays.
Edward Ng, Ph. D.
(23 juillet 2020) Le 16 mars 2020 n’a pas été un lundi comme les autres. C’était la première journée officielle de la semaine de relâche pour les élèves des écoles publiques de l’Ontario, et la commission scolaire a soudain annoncé que cette « pause printanière » allait plutôt durer deux semaines, qui ont ensuite été prolongées jusqu’à nouvel ordre. Du coup, quelque 2 millions d’élèves des écoles publiques de l’Ontario – y compris ma fille benjamine, qui est en 9e année – amorçaient un long parcours d’apprentissage à distance depuis leur domicile en raison de la pandémie.
La maison familiale soudain transformée en école et en espace de travail partagé
La veille, on m’avait également demandé de ne pas me présenter à mon bureau, situé près du centre-ville d’Ottawa, en raison des mesures de santé publique visant à prévenir la propagation du coronavirus. Au même moment, mon aînée, étudiante à l’université, apprenait que ses cours allaient être dispensés en ligne, car le campus commençait à fermer.
Au sein de ma famille de quatre personnes, seule mon épouse devait continuer de se rendre à son travail à l’extérieur de la maison. Mais lorsqu’un cas a été signalé à son lieu de travail à la fin de mars, tout le personnel a alors été invité à travailler à domicile, une décision qui aurait été inconcevable avant le début de la pandémie. J’ai commencé à m’interroger à savoir si nous vivions le début de la fin d’une époque centrée sur le bureau, ce qui allait avoir une incidence énorme à la fois sur le monde du travail et sur la famille.
À la maison, nous disposons d’une connexion Internet, mais nous ne sommes pas équipés pour servir de bureau et d’école à domicile. Puisque mon épouse travaille dans un secteur qui traite avec des clients au téléphone, j’ai rapidement réaménagé une pièce afin de lui installer un bureau temporaire. Par ailleurs, après une semaine de relâche prolongée pour ma benjamine, celle-ci a rapidement commencé à recevoir de ses enseignants des directives et des leçons quotidiennes en ligne, ce qui signifiait que nous étions dorénavant quatre à utiliser une seule et même connexion Internet presque constamment. Nous avons dû contacter notre fournisseur Internet afin de mettre notre matériel à niveau, ce qui a permis de tempérer nos problèmes et nos frustrations – ainsi que l’espoir partagé que je devienne un spécialiste de l’Internet!
Réflexions sur la réalité et les émotions à travers la musique
Au mois de mai, deux mois après le début du confinement, l’enseignante de musique de ma plus jeune lui a demandé de choisir quelques chansons qui illustraient son état émotionnel alors qu’elle suivait l’école à la maison. Elle a choisi la pièce « Stayin’ Alive » des Bee Gees. J’étais étonné de son choix, car elle n’a pas connu l’époque des Bees Gees, qui étaient célèbres dans ma ville natale de Hong Kong lorsque j’étais enfant. L’un des auteurs-compositeurs de ce dynamique succès disco de la fin des années 1970 le disait porter un message plutôt sérieux – il parle de survivre1 lorsque la vie ne mène nulle part (« goin’ nowhere »).
Life goin’ nowhere, somebody help me (La vie ne mène nulle part, quelqu’un, aidez-moi)
Somebody help me, yeah (Quelqu’un, aidez-moi)
Life goin’ nowhere, somebody help me, yeah (La vie ne mène nulle part, quelqu’un, aidez-moi)
I’m stayin’ alive (Je reste en vie)
C’était comme un appel à la survie, une représentation de la réalité que vivait ma fille pendant la pandémie de COVID‑19, et il lui permettait d’exprimer à l’égard du virus ses préoccupations et ses sentiments, amplifiés par sa situation d’adolescente appartenant à une minorité visible2, 3. J’admirais sa persévérance, car tout au long du confinement, elle a évité de s’aventurer à l’extérieur inutilement, quand c’était possible. Mais elle ressentait également de la confiance en l’avenir : la deuxième chanson qu’elle a choisie a été « Let’s Go Fly a Kite » du film Mary Poppins, qui reflétait son espoir de pouvoir enfin recommencer à sortir sans crainte de la COVID-19.
Soins et préoccupations intergénérationnels
Comme la plupart des Canadiens, je crains davantage qu’un membre de ma famille ne contracte la COVID‑19 que moi-même, et les sondages démontrent constamment que les minorités visibles éprouvent ces deux préoccupations dans une proportion plus forte que les personnes n’appartenant pas à une minorité visible4, 5. Comme c’est le cas dans plusieurs familles, mes soins et mes préoccupations s’étendent à toutes les générations, aux plus âgées comme aux plus jeunes.
Ma fille qui est d’âge universitaire travaille comme caissière à temps partiel dans une pharmacie de quartier. À chaque quart de travail, elle se rendait à son emploi qualifié d’essentiel, et nous nous inquiétions à propos du risque de se retrouver infectés par la COVID-19 en raison de son exposition aux clients. À la mi-avril, elle est rentrée avec une fièvre et une toux sèche, qui sont quelques-uns des symptômes potentiels. Nous étions inquiets, et nous l’avons encouragée à s’isoler en prenant un congé afin de s’assurer qu’elle n’avait pas contracté le virus. Dès que ses symptômes se sont affaiblis, elle est retournée au travail, pour découvrir que son lieu de travail avait été transformé : des panneaux de plexiglass avaient été installés à la caisse afin de minimiser le risque d’infection. Elle nous a un jour raconté une anecdote affolante où un client, alors qu’il payait ses achats, n’arrêtait pas de tousser en direction du plexiglass, sans se préoccuper de ceux qui l’entouraient!
Depuis environ trois ans, ma belle-mère habite dans une résidence de soins de longue durée de Toronto, et nous la visitons chaque fois que nous nous rendons en ville. Maintenant que ces établissements en Ontario et au Québec sont devenus l’épicentre de la COVID-19, nous nous inquiétons beaucoup pour elle. D’ailleurs, nous avons appris qu’un résident de sa résidence avait reçu un résultat positif à la COVID-19 à la mi-mai, ce qui indiquait une éclosion, selon l’autorité locale de santé publique. Une enquête plus approfondie a été menée auprès du personnel et des résidents, et des résultats encourageants sont venus contredire les conclusions initiales. Nous avons alors été soulagés d’apprendre que l’autorité de santé publique retirait ses mesures de contrôle liées à une éclosion pour l’établissement.
Puisque l’Ontario avait décidé d’interdire toute visite dans ces résidences de soins au début de la pandémie, nous ne pouvions rester en contact que par le biais des technologies de communication en ligne, comme Skype, dans le cadre de visites virtuelles. Le personnel de cette résidence nous a indiqué que les résidents trouvaient le temps long pendant la pandémie et se réjouissaient de ces visites virtuelles. Maintenant que l’Ontario commence à autoriser les visites dans les établissements de soins, nous prévoyons faire une visite en personne à ma belle-mère, tout en respectant le protocole de distanciation sociale, évidemment.
Soins et préoccupations au-delà des frontières
J’éprouvais de l’inquiétude pour ma famille avant même que la pandémie de COVID-19 ne soit déclarée. Déjà en février, des membres de ma famille vivant en Asie de l’Est qui étaient en visite chez nous ont décidé de quitter Toronto pour rentrer chez eux à Hong Kong avant qu’Air Canada annule tous ses vols directs. À ce moment-là, la COVID-19 faisait des ravages dans cette partie de l’Asie, alors je leur ai suggéré de prolonger leur séjour à Toronto, offre qu’ils ont déclinée afin de rentrer chez eux. Pour apaiser mes propres inquiétudes, j’ai fait quelques recherches et réussi à leur dénicher quelques masques non chirurgicaux afin qu’ils puissent les utiliser à leur arrivée à Hong Kong. (Fait à noter : à cette période, entre la moitié et la fin de février, les masques faciaux étaient déjà une denrée rare, même en Ontario.)
Avec le recul, toutefois, mes proches estimaient qu’ils avaient pris la bonne décision de partir, car les cas de COVID-19 ont commencé à augmenter à Toronto, et les aéroports du Canada, à fermer. Il est intéressant de noter qu’ils sont maintenant de retour à Toronto pour leur visite d’été annuelle au Canada, au moment où une éclosion de COVID-19 se produit à Hong Kong.
Peut-être en raison de mes liens étroits avec l’Asie, la COVID-19 a été pour moi une source d’inquiétude avant même qu’elle ne devienne un terme courant au Canada. Je me rappelle clairement le SRAS (le syndrome respiratoire aigu sévère)6 en 2003, et la force avec laquelle il avait frappé mon pays ainsi que Toronto à l’époque. C’est pourquoi dès février cette année, au tout début de l’épidémie en Asie, je suivais de près l’évolution de ce nouveau virus, qui touchait les familles du monde entier.
Du temps pour les souvenirs et les discussions en famille
En repensant à la chanson « Let’s Go Fly a Kite », je me remémore des souvenirs qui remontent au temps où mes filles étaient petites, où nous allions régulièrement faire voler notre cerf-volant dans un parc près de chez nous7. Nous passions beaucoup de temps à discuter et à rire ensemble, et lorsque le cerf-volant prenait dans le vent, nous le suivions et prenions plaisir à le regarder s’envoler dans le ciel.
Maintenant que mes filles ont grandi et sont devenues plus indépendantes avec les années, et que de mon côté, je me concentre de plus en plus sur mon propre travail et sur d’autres engagements personnels, les occasions permettant de créer de tels moments se font très rares. Mais la pandémie m’a rappelé l’importance de passer du temps avec elles – et m’a même offert quelques occasions de le faire – avant qu’elles ne décrochent leur diplôme et qu’elles ne plongent dans la prochaine étape de leur vie. Heureusement, le confinement nous a accordé du temps, en famille, pour nourrir quelques discussions sérieuses sur des sujets importants de la vie. Et pour cette raison, je lui suis reconnaissant.
Edward Ng, Ph. D., est analyste à l’Institut Vanier de la famille.
Notes
- Fait intéressant, la pièce « Stayin’ Alive » a été utilisée pour former des professionnels de la santé à effectuer le bon nombre de compressions thoracique par minute lors de la RCR, puisque son rythme de près de 104 battements par minute correspond aux normes recommandées par la British Heart Foundation, qui est d’effectuer de 100 à 120 compressions thoraciques par minute lors de l’exécution de cette technique de sauvetage.
- Par « minorité visible », on entend la possibilité qu’une personne appartienne à un groupe de minorité visible tel que défini par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et, le cas échéant, le groupe d’une minorité visible auquel la personne appartient. La Loi sur l’équité en matière d’emploi définit les minorités visibles comme « les personnes, autres que les autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche. » La variable Minorités visibles comprend les catégories suivantes : Sud-Asiatiques, Chinois, Noirs, Philippins, Latino-Américains, Arabes, Asiatiques du Sud-Est, Asiatiques occidentaux, Coréens, Japonais, Minorités visibles (c.-à-d. « non incluses ailleurs »), Minorités visibles multiples et Pas une minorité visible. Selon le Recensement du Canada de 2016, près de 70 % des membres des minorités visibles sont nés à l’extérieur du Canada (69 %).
- D’après un sondage mené par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et Expériences Canada, du 29 avril au 5 mai 2020, plus de la moitié (52 %) des jeunes des minorités visibles ont dit avoir assez ou très peur de contracter la COVID-19, comparativement à 34 % des jeunes des groupes n’appartenant pas à une minorité visible. Lien : https://bit.ly/2ZQTW38
- Plus de 6 minorités visibles interrogées sur 10 (62 %) ont dit craindre de contracter la COVID-19, mais 73 % craignaient encore plus que les membres de leur famille attrapent le virus, comparativement à 54 % et 66 %, respectivement, chez les personnes n’appartenant pas à une minorité visible.
- Un sondage de l’Institut Vanier de la famille, de l’Association d’études canadiennes et de la firme Léger, mené du 1er au 3 mai 2020, comprenait environ 1 526 personnes de 18 ans et plus qui ont été recrutées au hasard sur le panel en ligne de LEO. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 526 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,51 %, et ce, 19 fois sur 20.
- Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) est une maladie respiratoire causée par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV ou SARS-CoV-1), qui a entraîné près de 300 décès à Hong Kong et plus de 40 décès au Canada lors de l’épidémie de SRAS de 2002-2004.
- La chanson « Let’s Go Fly a Kite », tirée du classique de Walt Disney Mary Poppins, est présentée à la fin du film, au moment où George Banks (interprété par David Tomlinson) se rend compte que sa famille est plus importante que son travail, et qu’il décide d’emmener sa famille au parc pour faire voler un cerf-volant.
L’IMPACT DE LA COVID-19 : Les familles et le logement au Canada
Nadine Badets, Gaby Novoa et Nathan Battams
21 juillet 2020
La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur les familles et la vie de famille partout au Canada, et les mesures de confinement économique et de distanciation physique ont eu une incidence sur le paysage socioéconomique, culturel et contextuel qui teinte le bien-être des familles. Le logement n’y fait pas exception : les acheteurs potentiels voient le secteur immobilier ralenti par l’incertitude, et les mesures de distanciation physique ne sont pas facilement applicables pour de nombreuses familles vivant dans des logements surpeuplés ou inadaptés.
Le confinement dû à la COVID-19 a considérablement ralenti le marché immobilier au Canada
Dans la plupart des grandes villes du Canada (16 sur 27), le prix des logements neufs n’a pratiquement pas changé en avril 2020. Cependant, les ventes de maisons neuves et la revente de maisons moins récentes partout au Canada ont diminué considérablement au plus fort de la pandémie. Les constructeurs interrogés par Statistique Canada en avril 2020 ont déclaré avoir observé une baisse de près des deux tiers (64 %) des ventes de maisons neuves par rapport au même mois en 2019. L’Association canadienne de l’immeuble a signalé une diminution de 58 % des reventes de maisons en avril entre 2020 et 20191.
Compte tenu de la fermeture des économies et des pertes d’emplois importantes, les provinces et les territoires ont imposé des interdictions d’expulsion et des suspensions de paiement pour soutenir les locataires. La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a également exhorté tous les propriétaires, y compris ceux qui bénéficient d’une assurance ou d’un financement de la SCHL, à s’abstenir d’expulser les locataires pendant la pandémie de COVID-192. Cependant, au fur et à mesure que les restrictions liées à la pandémie seront levées, de nombreuses personnes et familles au Canada pourraient être confrontées à une expulsion et/ou être tenues de rembourser des sommes importantes en raison d’un loyer impayé.
La demande dans les refuges pour sans-abri a augmenté considérablement pendant le confinement
Avant la pandémie de COVID-19, les problèmes d’accessibilité et d’abordabilité du logement étaient inégalement et excessivement répandus parmi certains groupes au Canada, notamment chez les nouveaux arrivants et les réfugiés, les groupes racialisés, les personnes LGBTQ2S, les personnes âgées, les Autochtones et les personnes handicapées ou souffrant de problèmes de santé mentale3.
L’itinérance4 est particulièrement préoccupante pendant la pandémie, car elle expose les gens à des conditions de vie dangereuses qui peuvent présenter des conséquences graves pour la santé physique et mentale, en plus de rendre difficile le respect des nouvelles ordonnances de santé publique telles que la distanciation physique.
Qu’elles déménagent de domicile en domicile (ce que l’on qualifie souvent de « sans-abri cachés »), passent du temps dans des refuges5, vivent selon des modalités provisoires ou dorment à divers endroits, ou encore qu’elles conjuguent une combinaison de ces options, les personnes en situation d’itinérance se trouvent souvent à proximité de plusieurs autres personnes et n’ont pratiquement pas accès aux ressources nécessaires pour appliquer les pratiques d’hygiène recommandées6.
En 2014, on estimait que le Canada comptait au moins 235 000 sans-abri au cours d’une année donnée, et environ 35 000 au cours d’une nuit donnée. En général, les individus passent en moyenne 10 jours dans des refuges, et les familles y passent le double de ce temps7. Tout au long de la pandémie de COVID-19, les refuges situés dans les villes canadiennes ont signalé leur utilisation accrue par la clientèle habituelle et de nouveaux bénéficiaires8. Cependant, en raison des restrictions relatives à la distanciation physique, les refuges ont dû réduire considérablement le nombre de lits et de places qu’ils offrent, ce qui a privé beaucoup de gens d’un endroit où loger9, 10.
L’augmentation du nombre de signalements de violence familiale11, de maltraitance12 et de problèmes de santé mentale13 a également laissé de nombreuses personnes et familles sans logement. Plusieurs refuges ont augmenté le soutien aux sans-abri en créant des places dans des centres communautaires, des hôtels et des logements permanents, mais ils n’ont pas la capacité financière de répondre à la demande accrue pour des services d’hébergement14, 15.
Les problèmes de logement dans les collectivités des Premières Nations et des Inuits sont associés à l’augmentation du risque lié à la COVID-19
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les dirigeants et les peuples autochtones ont attiré l’attention sur la dévastation continue causée par la tuberculose chez les Premières Nations, les Inuits et les différentes collectivités, rappelant au Canada que la COVID-19 n’est pas la seule pandémie à laquelle ils sont confrontés16, 17.
En 2017, le taux associé à la tuberculose chez les Inuits était de 205,8 cas pour 100 000 habitants, et il était de 21,7 cas pour 100 000 habitants au sein des Premières Nations (dans les réserves). La tuberculose était également répandue chez les immigrants, avec un taux de 14,7 pour 100 000 habitants chez les personnes nées à l’extérieur du Canada, alors que pour les personnes non autochtones nées au Canada, ce taux était de 0,5 pour 100 000 habitants18. Au 19 avril 2020, la seule région inuite à avoir signalé des cas de COVID-19 était le Nunavik, avec 14 cas (5 guéris et 9 actifs)19. Chez les Premières Nations, les données recueillies auprès des différentes collectivités montrent qu’au 10 mai 2020, on dénombrait 465 cas de COVID-19 et 7 décès20.
En 2016, les Inuits vivant dans l’Inuit Nunangat21 (la patrie des Inuits) étaient plus susceptibles de vivre dans des ménages surpeuplés22 (52 %) et dans des maisons nécessitant des réparations majeures23 (32 %)24. Le logement inadapté est également répandu chez certaines Premières Nations, où des problèmes tels que le surpeuplement des ménages (27 %)25, 26 et les maisons nécessitant des réparations majeures (24 %)27 sont beaucoup plus fréquents que chez les non-Autochtones au Canada (9 % et 6 %)28.
Le surpeuplement des ménages aggrave le risque de contracter des maladies respiratoires infectieuses comme la tuberculose et la COVID-19, cette dernière étant considérée comme encore plus contagieuse que la tuberculose29. Les conditions de logements insalubres ont été directement associées à la qualité de la santé et du bien-être, et des études montrent un risque accru de propagation des maladies infectieuses et respiratoires, de maladies chroniques, de blessures, de malnutrition, de violence et de troubles mentaux30. Le surpeuplement des ménages complique aussi – et exclut peut-être – la distanciation physique et l’isolement des personnes malades au sein d’un ménage. Les maisons nécessitant des réparations majeures peuvent poser divers risques pour la santé. En particulier, l’accès insuffisant aux infrastructures d’approvisionnement en eau chez certaines Premières Nations engendre des risques supplémentaires d’infection et de transmission.
Les ménages multigénérationnels se heurtent à davantage d’obstacles à la distanciation physique
Les ménages multigénérationnels constituent un atout important pour de nombreuses familles au Canada, car ils peuvent faciliter les soins et le soutien entre les générations, permettre à certains parents d’économiser sur les services de garde, en plus de faciliter l’apprentissage intergénérationnel31. Entre 2001 et 2016, les ménages multigénérationnels ont connu la croissance la plus rapide au Canada, soit une augmentation de 38 % pour atteindre près de 404 000 foyers32.
Ces types de ménages peuvent être confrontés à des obstacles particuliers à la distanciation sociale, étant donné que les personnes âgées vivant au sein du foyer sont considérées comme faisant partie des populations les plus vulnérables au virus33.
En 2016, 11 % des immigrants vivaient dans des ménages multigénérationnels34, tout comme 5 % des non-immigrants35. Les enfants autochtones de 0 à 14 ans étaient plus susceptibles de vivre au sein de ménages multigénérationnels36 que les enfants non autochtones (8 %), avec 13 % des enfants des Premières Nations, 13 % des enfants inuits et 7 % des enfants métis37.
Le développement durable est intimement lié au logement
La pandémie de COVID-19 a touché de nombreux aspects du logement au Canada et intensifié les inégalités préexistantes chez les communautés marginalisées du pays. Comme le Canada s’est engagé à mettre en œuvre les objectifs de développement durable des Nations Unies – lesquels portent sur des facteurs comme la pauvreté (ODD 1), la santé et le bien-être (ODD 3) et la réduction des inégalités (ODD 10) –, le logement sera un élément important des réponses et des discussions stratégiques sur ce sujet, ce qui revêt une importance particulière dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Nadine Badets, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Gaby Novoa est responsable des communications à l’Institut Vanier de la famille.
Nathan Battams est directeur des communications à l’Institut Vanier de la famille.
Notes
- Statistique Canada, « Indice des prix des logements neufs, avril 2020 » dans Le Quotidien (21 mai 2020). Lien : https://bit.ly/2Cw1Tlo
- Société canadienne d’hypothèques et de logement, « COVID-19 : Expulsions – Interdictions et interruptions pour soutenir les locataires » (25 mars 2020). Lien : https://bit.ly/3jetOH6
- Homeless Hub, « Communautés racialisées » (s.d.). Lien : https://bit.ly/3fLQjkB
- On peut décrire l’itinérance comme étant de très courte durée (être sans logement pendant une nuit ou plus), épisodique (entrer et sortir de l’itinérance) ou chronique (de longue durée). Pour plus d’information, consultez le site Web de Homeless Hub. Lien : https://bit.ly/2OK81Jo
- Les refuges comprennent les refuges d’urgence pour sans-abri, les refuges pour femmes victimes de violence et les logements institutionnels temporaires. Pour plus d’information, consultez le site Web de Homeless Hub. Lien : https://bit.ly/32HhzwO
- Jennifer Ferreira, « The Toll COVID-19 Is Taking on Canada’s Homeless » dans CTV News (22 mai 2020). Lien : https://bit.ly/2N7AcB8
- Stephen Gaetz, Erin Dej, Tim Richter et Melanie Redman, « L’état de l’itinérance au Canada 2016 » dans Observatoire canadien sur l’itinérance, Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance (2016). Lien : https://bit.ly/3fYiL2s (PDF)
- Ferreira, « The Toll COVID-19 Is Taking on Canada’s Homeless ».
- Nicole Mortillaro, « It’s Heartbreaking: Homeless During Pandemic Left Out in the Cold – Figuratively and Literally » dans CBC News (17 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2NcOQao
- Matthew Bingley, « Coronavirus: Toronto Officials Call for Provincial Pandemic Plan for Shelters to Avoid “Mass Outbreaks” » dans Global News (20 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3dhnWII
- Cec Haire, « Increase in Domestic Violence Calls Persists Throughout Pandemic, Says Non-Profit » dans CBC News (2 juillet 2020). Lien : https://bit.ly/32eJp3p
- Santé publique Ontario, « Examen rapide : Mesures communautaires de santé publique en situation de pandémie (dont la COVID-19) : répercussions négatives sur les enfants et les familles » (2020). Lien : https://bit.ly/3jki8Tl (PDF)
- Aisha Malik, « CAMH Expands Virtual Mental Health Services Amid COVID-19 Pandemic » dans MobileSyrup (4 mai 2020). Lien : https://bit.ly/3gVt73i
- Mortillaro, « “It’s Heartbreaking”: Homeless During Pandemic Left Out in the Cold – Figuratively and Literally. »
- Ferreira, « The Toll COVID-19 Is Taking on Canada’s Homeless ».
- Olivia Stefanovich, « COVID-19 Shouldn’t Overshadow Ongoing Fight Against TB, Inuit Leaders Say » dans CBC News (12 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3doVTr3
- John Borrows et Constance MacIntosh, « Indigenous Communities Are Vulnerable in Times of Pandemic. We Must Not Ignore Them » dans The Globe and Mail (mis à jour le 21 mars 2020). Lien : https://tgam.ca/2YYhTDY
- M. LaFreniere et autres, « La tuberculose au Canada, 2017 » dans Relevé des maladies transmissibles au Canada (7 février 2019). Lien : https://bit.ly/3fFFWP3
- Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, « COVID-19 : 14e CAS CONFIRMÉ AU NUNAVIK », communiqué (19 avril 2020). Lien : https://bit.ly/32qU5vH (PDF)
- Courtney Skye, « Colonialism of the Curve: Indigenous Communities and Bad Covid Data », Yellowhead Institute (12 mai 2020). Lien : https://bit.ly/37W5kgi
- L’Inuit Nunangat est composé de quatre régions inuites : le Nunatsiavut (nord du Labrador), le Nunavik (nord du Québec), le Nunavut et la région désignée des Inuvialuit (nord des Territoires du Nord-Ouest). Inuit Tapiriit Kanatami, « Inuit Nunangat Map » (mis à jour le 4 avril 2019). Lien : https://bit.ly/2WgN4de
- Statistique Canada (Recensement de la population, 2016). « Personnes par pièce » est un indicateur du niveau de surpeuplement dans un logement privé. On l’obtient en divisant le nombre de personnes dans le ménage par le nombre de pièces se trouvant dans le logement et les logements comptant plus d’une personne par pièce sont considérées comme surpeuplés. Dans Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 (3 mai 2017). Lien : https://bit.ly/2ZC1hmN
- Les réparations majeures, telles que définies par Statistique Canada (Recensement de la population, 2016), comprennent une plomberie ou une installation électrique défectueuse, et les logements qui ont besoin de réparations structurelles aux murs, aux sols ou aux plafonds. « État du logement » dans Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 (3 mai 2017). Lien : https://bit.ly/2ZCxB9d
- Thomas Anderson, « Les conditions de logement des peuples autochtones au Canada » dans Recensement en bref (25 octobre 2017). Lien : https://bit.ly/3eEolpe
- Ibidem
- Statistique Canada, « Logement » dans Un aperçu des statistiques sur les Autochtones : 2e édition (24 décembre 2015). Lien : https://bit.ly/3fEQ5eO
- Anderson, « Les conditions de logement des peuples autochtones au Canada ».
- Institut Vanier de la famille, « Les familles autochtones au Canada » dans Faits et chiffres (13 juin 2018).
- Olivia Stefanovich, « COVID-19 Shouldn’t Overshadow Ongoing Fight Against TB, Inuit Leaders Say ».
- Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, « Le logement : un déterminant social de la santé des Premières Nations, des Inuits et des Métis » (2017). Lien : https://bit.ly/30lIwn2 (PDF)
- Asfia Yassir, « Having Grandparents at Home Is a Blessing » dans South Asian Post (4 mars 2018). Lien : https://bit.ly/2WhlrR5
- Institut Vanier de la famille, « Les données du Recensement de 2016 mettent en relief la diversité familiale au Canada » (25 octobre 2017).
- Caroline Alphonso et Xiao Xu, « Multigenerational Households Face Unique Challenges in Battling Spread of Coronavirus » dans The Globe and Mail (mis à jour le 21 mars 2020). Lien : https://tgam.ca/2O9ss24
- Définis par Statistique Canada (Recensement de la population de 2016) comme les ménages où au moins une personne vit avec un enfant et un petit-enfant.
- Statistique Canada, « Catégorie d’admission et type de demandeur (47), statut d’immigrant et période d’immigration (11B), âge (7A), sexe (3) et certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la population active et de la scolarité (825) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires et régions métropolitaines de recensement, Recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %) », tableaux de données, Recensement de 2016 (mis à jour le 17 juin 2019). Lien : https://bit.ly/3fP0tko
- Définis comme vivant dans un ménage avec au moins un parent et un grand-parent.
- Statistique Canada, « Caractéristiques de la famille des enfants, incluant la présence de grands-parents (10), identité autochtone (9), statut d’Indien inscrit ou des traités (3), âge (4B) et sexe (3) pour la population âgée de 0 à 14 ans dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %) », tableaux de données, Recensement de 2016 (mis à jour le 17 juin 2019). Lien : https://bit.ly/39e0VGr
Recherche en bref : La COVID‑19 et la mobilité liée à l’emploi au Canada
Gaby Novoa
16 juillet 2020
La pandémie de COVID‑19 a eu une incidence majeure sur les tendances de l’emploi au Canada avec les mesures de confinement économique et de santé publique entrées en vigueur en mars 2020 et touchant une main-d’œuvre de plus en plus mobile.
Tout au long de la pandémie, le Partenariat en mouvement – un projet de recherche auquel participent L’Institut Vanier et des partenaires universitaires et qui explore les répercussions de la mobilité géographique liée à l’emploi – a publié des renseignements et des aperçus dans sa série La COVID‑19 et la mobilité de la main-d’œuvre. Cette recherche en bref met en lumière certains de leurs travaux sur de multiples aspects de l’incidence de la pandémie, y compris le sexe, les travailleurs migrants, les camionneurs et les répercussions sur les communautés de pêcheurs côtiers.
Walking the Empty City: Feminist Reflections on Life Suspended Under COVID-19 (Marcher dans la ville déserte : réflexions féministes sur la vie suspendue sous la COVID‑19) (en anglais seul.)
Deatra Walsh, Ph. D., fait un compte rendu de première main de son passage à St. John’s en période d’arrêt, au milieu de la pandémie de COVID‑19. Elle souligne l’idée de la marche comme « une forme particulièrement importante de mobilité », une aptitude que les femmes ne ressentent pas toujours comme un acte choisi librement ou agréable, sans souci ou préoccupation.
Walsh présente la marche comme mécanisme d’adaptation à la situation, car elle offre une routine qui peut contribuer au bien-être d’une personne, tandis que tout le reste peut être ressenti comme aléatoire et déraciné. Dans ses réflexions sur le quartier visuellement vide, elle réfléchit aussi sur la vie prépandémique. Les collectivités se sont-elles déjà distancées socialement les unes par rapport aux autres (avant qu’il s’agisse d’une mesure de santé publique obligatoire), se tournant intérieurement « vers leurs appareils électroniques et leurs activités? » se demande-t-elle. Toutefois, elle reconnaît également les symboles de solidarité – être seuls ensemble – à travers les œuvres d’art aux fenêtres et le bruit des casseroles sur le pas de la porte.
Temporary and Precarious Migration Status and the Experience of the Pandemic in Canada’s Health Care Sector: Emerging Themes (Le statut de migration temporaire et précaire et l’expérience de la pandémie dans le secteur des soins de santé au Canada : thèmes émergents) (en anglais seul.)
Shiva Nourpanah, Ph. D., et Kerri Neil explorent la manière dont la pandémie affecte particulièrement la tâche et les moyens de subsistance des travailleurs de la santé migrants au Canada. La pandémie a amplifié la vulnérabilité des personnes âgées et celle des résidents des maisons de soins de longue durée. Nourpanah et Neil soulignent qu’une forte proportion des employés de ces établissements sont des travailleurs migrants et des infirmières qui possèdent un permis de travail temporaire. Comme les travailleurs de la santé sont déjà exposés à un risque élevé d’infection et de problèmes de santé mentale, la précarité de leur statut de résident exacerbe ces tensions. Les auteurs soulèvent deux défis particuliers à cette situation complexe, à savoir que les lignes directrices sur l’isolement volontaire réduisent les quarts de travail des travailleurs de la santé, ce qui peut avoir une incidence sur leurs exigences en matière de visa en ce qui a trait au nombre d’heures obligatoires de travail. Néanmoins, des quarts de travail supplémentaires augmentent leur exposition au virus et le risque de le contracter.
De plus, la pandémie a entraîné la suspension de plans d’immigration concrets, y compris les parrainages, la réunification des familles et les mariages. Ces incertitudes ne font qu’ajouter au fardeau mental et émotionnel imposé aux travailleurs migrants temporaires. Pour ces résidents temporaires qui fournissent un travail essentiel au Canada, leur bien-être et leur statut de résident peuvent être inévitablement et négativement affectés par la pandémie. Cependant, les auteures de l’article affirment que certaines de ces répercussions peuvent être réduites par une recherche et une élaboration de politiques appropriées.
COVID‑19 and Coastal Fishing Communities (La COVID‑19 et les communautés de pêcheurs côtiers) (en anglais seul.)
Gale Burford, Ph. D., et Barb Neis, Ph. D., décrivent les façons dont les communautés de pêcheurs côtiers éloignées sont confrontées à un accès limité aux soins de santé, ce qui, associé à l’interdépendance de la mobilité au travail, soulève leurs propres préoccupations et défis dans le cadre de la gestion d’une pandémie. Bien que ces collectivités soient éloignées, elles sont néanmoins reliées aux marchés nationaux et internationaux. La pêche étant classée comme une industrie essentielle, la mobilité des chaînes d’approvisionnement crée un risque de propagation du virus. C’est un risque qui peut être difficile à éviter, car ces communautés sont aussi souvent des villes mono-industrielles et dépendent donc de ces saisons de pêche.
Dans cet article, Burford revient sur un appel FaceTime avec sa sœur qui habite Cordova, en Alaska, une ville de pêche côtière. Alors que la ville dépend du revenu de la pêche, les craintes d’exposition à l’infection avec l’arrivée des travailleurs migrants et les pressions qui en ont découlé sur les services de soins de santé étaient répandues. Ces préoccupations sont partagées par les collectivités côtières du Canada atlantique. À Terre-Neuve-et-Labrador, la saison de pêche a été retardée et d’autres retards ont encore été nécessaires afin d’élaborer des protocoles pour protéger la sécurité et le bien-être des travailleurs et celui de leurs familles. Les auteurs font remarquer que l’assurance-emploi peut contribuer à atténuer la difficulté d’évaluer la santé par rapport au besoin d’emploi et de revenu.
The Impact of the COVID‑19 Pandemic on Canadian Truck Drivers (La répercussion de la pandémie de COVID‑19 sur les conducteurs de camions canadiens) (en anglais seul.)
Parmi les services jugés essentiels dans la pandémie de COVID‑19 figurent le transport et l’expédition de marchandises. Le camionnage est essentiel au Canada, car il transporte 90 % des aliments et des biens de consommation, y compris les fournitures médicales nécessaires. Natasha Hanson, Ph. D., et Kerri Neil soulignent certains des défis auxquels les camionneurs sont maintenant confrontés sur la route en contexte de pandémie, y compris la disponibilité limitée de sources de nourriture commodes et l’accès aux toilettes.
L’industrie du camionnage connaissait déjà une pénurie de main-d’œuvre avant la pandémie. Aujourd’hui, la difficulté de maintenir le bien-être sur la route et le risque pour la sécurité dans un contexte de déplacements continus ont incité encore plus de conducteurs à prendre leur retraite ou à démissionner. Compte tenu de la dépendance au camionnage pour le transport des biens nécessaires, mais des défis que cela comporte, on ne sait pas encore quelle sera l’incidence à long terme de la pandémie sur cette industrie.
Visitez le site Web du Partenariat en mouvement pour plus de recherches et de ressources.
Gaby Novoa est responsable des communications à L’Institut Vanier de la famille.
Incertitude et report : Les conséquences de la pandémie sur la fécondité au Canada
Ana Fostik, Ph. D.
30 juin 2020
Au cours des premières semaines suivant l’adoption des mesures de santé publique et le début du confinement en réponse à la pandémie de COVID-19, la vie sociale de millions d’adultes a été soudainement interrompue, et plusieurs se sont vus contraints de passer toutes leurs journées à la maison. Certaines personnes se sont donc interrogées sur la possibilité que l’on assiste à une hausse des naissances neuf mois plus tard. Pourrait-il y avoir une génération « coroniale », un baby-boom dû au fait que les couples passent plus de temps ensemble1?
Bien que de nombreux couples se soient côtoyés davantage, ceux-ci ont également été confrontés à une multitude de défis et à des transitions difficiles – une réalité inédite pour les générations actuelles : le système de santé a été fortement touché par la pandémie, les enfants ont soudainement dû quitter leur milieu de garde ou leur école et ont eu besoin d’un enseignement à domicile, certains adultes ont dû se tourner vers le télétravail tout en s’occupant des jeunes enfants du ménage, et beaucoup d’autres ont rencontré des difficultés financières, certains ayant perdu leur emploi ou dû réduire leurs heures de travail et faire face à une baisse de revenus.
En effet, des millions de travailleurs ont perdu leur emploi ou vu leurs heures de travail diminuer en raison des mesures de confinement instaurées, et le taux de chômage a atteint le sommet historique de 13,7 % en mai 2020, comparativement à 5,6 % seulement trois mois auparavant. Près de la moitié des travailleurs autonomes ont connu une baisse de leurs heures de travail, qui s’est accompagnée, dans la plupart des cas, d’une perte de revenus. Par conséquent, ce mois-là, plus de 1 adulte sur 5 vivait dans un ménage éprouvant des difficultés financières à respecter ses obligations de base, comme payer le loyer, l’hypothèque et l’épicerie2.
« Les projets familiaux, dans ces conditions-là, ça m’étonnerait qu’ils ne changent pas », souligne Benoît Laplante, professeur de démographie familiale à l’Institut national de la recherche scientifique de Montréal. En effet, les données disponibles indiquent une très faible probabilité que la fécondité augmente neuf mois après le début du confinement : au contraire, selon les recherches antérieures, on devrait plutôt s’attendre à une réduction de l’indice synthétique de fécondité à court terme. Les périodes de récession ou de ralentissement économique, l’incertitude sur le marché du travail et, de façon plus générale, l’incertitude sociétale globale et les perspectives négatives concernant l’avenir ont toutes été associées à la mise en suspens des projets de procréation, et donc à une réduction du nombre de naissances au sein d’une population.
L’incertitude sur le marché du travail a une incidence sur les projets en matière de procréation
Dans le cadre d’une méta-analyse récente réalisée en Europe à propos des effets du chômage et de l’emploi temporaire sur la fécondité, il a été démontré que les personnes qui se retrouvaient momentanément au chômage avaient tendance à retarder la planification d’une naissance3. Alors que le chômage entraîne une perte de revenus et augmente l’incertitude quant aux perspectives d’emploi futures, les projets de création ou d’agrandissement de la famille au cours d’une telle période sont plus susceptibles d’être interrompus jusqu’à ce que la situation financière s’améliore.
C’était particulièrement vrai chez les couples hétérosexuels lorsque le partenaire masculin se retrouvait au chômage. Cela avait une incidence non seulement sur la décision d’avoir un premier enfant, mais aussi sur les projets visant à agrandir la famille, lorsque les couples avaient déjà des enfants. Les données ont également montré que le chômage avait eu un effet négatif de plus en plus important sur la procréation entre 1970 et 2015, les conditions sur le marché du travail se faisant plus difficiles et les emplois permanents, moins fréquents.
Par ailleurs, les femmes de certains pays profitaient au contraire de leurs périodes de chômage pour réaliser leurs plans en matière de fécondité et avoir des enfants au cours de celles-ci, ces moments leur offrant plus de temps pour la procréation et l’éducation des enfants, alors que les coûts de renonciation étaient moins importants (par rapport au temps passé sur le marché du travail pour acquérir une expérience qui leur permette de faire progresser leur carrière professionnelle). Ce ne fut toutefois pas le cas dans les pays d’Europe du Sud les plus touchés par la Grande Récession de 2008 (c.-à-d. en Italie et en Espagne), là où l’on retrouvait également les taux de fécondité les plus faibles.
On a également constaté que les personnes qui avaient un emploi temporaire étaient moins susceptibles d’avoir des enfants en période d’incertitude économique, surtout lorsqu’il s’agissait d’avoir un deuxième ou un troisième enfant, et ce, comme l’indique l’étude, en raison de l’impact financier accru lié à l’élargissement de la famille. Chez les hommes, le chômage était par ailleurs un obstacle plus important que le fait d’avoir un emploi temporaire, particulièrement lorsque l’on s’attendait à ce qu’ils soient les principaux pourvoyeurs financiers du ménage : pour fonder ou agrandir la famille, il vaut mieux avoir un emploi, peu importe la nature de celui-ci, que de ne pas en avoir du tout.
La Grande Récession est associée à la baisse de la fécondité en Europe
Les crises économiques peuvent avoir une incidence sur les intentions en matière de fécondité et la procréation, même lorsque les individus ne sont pas personnellement touchés par la perte d’un emploi ou de revenus, car les ralentissements se traduisent par une réduction de la croissance du PIB et une hausse du chômage. En période d’incertitude quant aux perspectives économiques et à la stabilité du marché du travail, les gens ont tendance à devenir réfractaires à la prise de risques et à éviter tout engagement à long terme, et le fait de donner naissance à un enfant est certes l’engagement le plus irréversible qui soit. Lorsque l’avenir est entrevu de façon négative, de nombreuses familles tendent à reporter leurs projets de procréation jusqu’à ce qu’elles puissent à nouveau envisager un avenir plus prévisible4.
Le cas récent de l’Europe illustre bien cette situation, car les taux de fécondité y augmentaient depuis le début des années 2000. Or, pendant et après la Grande Récession de 2008-2009, les taux de fécondité se sont stabilisés, puis ont diminué dans la plupart des régions européennes, particulièrement celles qui ont été les plus touchées par la récession.
Un article récent s’intéressant aux répercussions de cette récession sur la fécondité dans 28 pays européens s’est penché sur l’impact du chômage, du chômage de longue durée et de la baisse du PIB sur les taux de fécondité, entre les années 2000 et 2014. L’étude a révélé que lorsque le chômage augmentait, les taux de fécondité diminuaient considérablement. En outre, l’impact du chômage s’est avéré plus important pendant la période de récession (entre 2008 et 2014) qu’avant celle-ci, ce qui suggère que l’impact négatif du chômage sur le comportement en matière de fécondité peut être amplifié en période de récession5.
Les recherches indiquent qu’un contexte de « grande incertitude » a une incidence sur les projets en matière de procréation
Si l’économie européenne a su se redresser après la Grande Récession, la fécondité dans de nombreux pays européens n’est pas pour autant revenue à ce qu’elle était auparavant, et elle a même continué de décliner. Ce fut particulièrement le cas dans certains pays nordiques, où les effets de la Grande Récession ont été modérés, et où la fécondité a connu un déclin plus tardif, qui s’est poursuivi au-delà de 2014, après que les conditions macroéconomiques se furent améliorées. Cela a amené certains chercheurs à se concentrer sur l’existence d’une « grande incertitude » relativement à l’avenir et son incidence sur les aspirations familiales. Ceux-ci font valoir qu’une grande incertitude quant à l’avenir de l’économie, mais aussi des systèmes politiques à l’échelle mondiale, peut avoir des répercussions sur les témoignages, les perspectives et la vision qu’ont les gens du monde qui les entoure, peu importe qu’ils aient eux-mêmes un emploi précaire ou qu’ils soient au chômage. À mesure que les « témoignages d’incertitude » se répandent, les projets de naissances sont retardés, même si l’économie devait se redresser6.
Une étude sur les répercussions d’une crise financière en Italie en 2011-2012 révèle que lorsque les individus utilisent le terme technique « spread » (qui signifie « propagation ») sur un moteur de recherche (un indicateur utilisé par les économistes pour mesurer le manque de confiance dans un système financier), le nombre de naissances observé neuf mois plus tard chute de façon importante. Ils estiment que les naissances diminuent de 2,5 % à 5 % à la suite de tels « témoignages d’incertitude »7.
De récentes études suggèrent que la pandémie de COVID-19 a une incidence sur les projets en matière de procréation
Une récente enquête menée auprès d’adultes de 18 à 34 ans dans plusieurs pays européens (c.‑à‑d. en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni) a permis d’estimer la proportion de naissances prévues pour 2020 qui ont été reportées. On a demandé aux adultes qui disaient prévoir, au début de l’année 2020 (c’est-à-dire avant l’apparition du coronavirus), la conception ou l’adoption d’un enfant avant la fin de l’année, si la pandémie avait modifié ces projets de quelque manière que ce soit. L’étude a révélé que certains individus avaient en effet modifié leur projet de fécondité, et ce, dans tous les pays étudiés, celui-ci ayant été retardé ou abandonné pour cette année.
L’impact varie selon les pays, mais en Italie et en Espagne, près du tiers de ceux qui prévoyaient une naissance en 2020 ont abandonné le projet pour l’année en cours. Plus de la moitié des personnes interrogées en Allemagne, en France, en Espagne et au Royaume-Uni ont affirmé quant à eux qu’ils maintenaient leur projet d’avoir un enfant un peu plus tard au cours de l’année8.
Les naissances prévues chez les mères de 40 ans et plus risquent d’être fortement affectées
Comme en témoignent les crises économiques et sanitaires passées (comme la pandémie de grippe de 1918), certaines des naissances qui sont reportées en périodes de bouleversements sont souvent « rattrapées » par la suite9. Les gens attendent parfois que les temps soient moins incertains avant de donner suite à leurs projets d’avoir un enfant.
Monsieur Laplante souligne que la différence entre le fait de retarder une naissance et celui d’abandonner complètement le projet d’avoir un enfant peut devenir particulièrement floue dans le contexte actuel. « Ce qui est beaucoup plus probable […] c’est que les gens vont reporter ou abandonner [leurs projets d’avoir des enfants] […] et quand on reporte, après un certain temps, ça va finir par abandonner… et là, tout le monde est dans l’incertitude. Est-ce qu’il va y avoir un vaccin? Dans deux ans, peut-être. » Celui-ci présume que les femmes dans la trentaine qui prévoyaient avoir deux enfants, et qui ont décidé d’attendre qu’un vaccin soit disponible avant de planifier la prochaine naissance, pourraient manquer de temps pour concevoir leur premier ou leur deuxième enfant avant d’être contraintes par une limite biologique.
Il est donc possible que certains de ces projets de naissances ne soient pas « rattrapés ». Dans plusieurs pays occidentaux, les femmes attendent de plus en plus longtemps avant d’avoir leur premier enfant, alors qu’elles sont nombreuses à souhaiter d’abord parfaire leur trajectoire scolaire et professionnelle. Le nombre de naissances chez les mères dans la quarantaine a d’ailleurs augmenté au cours des dernières décennies, celui-ci représentant une proportion croissante des premières naissances10. En 2014, on estimait que 3,6 % de toutes les naissances au Canada étaient de mères âgées de 40 ans et plus11.
Chez les femmes de 40 ans et plus, une proportion importante des naissances est facilitée par les techniques de procréation assistée12. Or, étant donné que bon nombre de ces procédures ont dû être interrompues pendant plusieurs mois au cœur de la pandémie, les naissances prévues à un âge plus avancé pourraient être plus gravement touchées. En effet, dans les sociétés où une forte proportion des naissances est associée aux femmes de plus de 40 ans, certaines des naissances prévues qui ont déjà été retardées pourraient ne jamais voir le jour : l’horloge biologique pourrait sonner l’heure de la fin avant que le marché du travail et les systèmes de santé ne reviennent aux normes antérieures.
Les données au Québec et en Ontario montrent une incidence sur la fécondité au-delà de la reprise économique
L’indice synthétique de fécondité est un indicateur « ponctuel », c’est-à-dire une estimation du nombre d’enfants que les femmes auraient en moyenne, au cours de leur vie, si les conditions de fécondité actuelles demeuraient stables durant toute leur vie reproductive. C’est pourquoi nous pouvons nous attendre à une réduction des taux de fécondité lors d’une période de turbulence et/ou d’incertitude socioéconomique, suivie d’une reprise une fois la crise terminée : seule une partie des naissances qui ont été reportées sont simplement « rattrapées » – pourvu que les projets et les idéaux en matière de reproduction demeurent inchangés.
Monsieur Laplante nous met en garde en indiquant qu’au Québec et en Ontario, les taux de fécondité ont commencé à baisser lors de la Grande Récession de 200813, et, comme cela s’est produit dans les pays européens, ils ont continué à baisser après que le ralentissement économique fut terminé et que les taux de chômage eurent redescendu. Il se demande maintenant pourquoi la fécondité n’a pas connu de remontée dans ces deux provinces canadiennes : sommes-nous exposés à des changements plus fondamentaux qui ne résultent pas seulement de bouleversements temporaires?
Seul le temps nous dira si les générations touchées par la crise de la COVID-19 parviendront à avoir autant d’enfants qu’elles le prévoyaient, bien que cela puisse être retardé, ou si le nombre d’enfants qu’elles souhaitaient avoir changera dans ce contexte. Si certains adultes décident de renoncer totalement à la procréation en raison des nouveaux défis posés par la pandémie et la crise économique qui lui est associée, les plus jeunes générations pourraient être plus susceptibles de ne pas avoir d’enfants. Il est actuellement trop tôt pour le dire, mais les recherches sur l’évolution des intentions en matière de fécondité avant et après la pandémie seront d’une importance cruciale afin de comprendre cet aspect de la vie familiale.
Ana Fostik, Ph. D., Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Notes
- À titre d’exemple, consultez l’article « Is the COVID-19 baby boom a myth? How relationships might be tested during the pandemic », CTV News (19 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3hCDUAy
- Statistique Canada, « Enquête sur la population active, mai 2020 » dans Le Quotidien (5 juin 2020). Lien : https://bit.ly/2ViQXO0
- Giammarco Alderotti et autres, Employment Uncertainty and Fertility : A Network Meta-Analysis of European Research Findings, Archives 2019-06 : documents de travail en économétrie, Universita’ degli Studi di Firenze, Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” (2019).
- Tomáš Sobotka, Vegard Skirbekk et Dimiter Philipov, « Economic Recession and Fertility in the Developed World » dans Population and Development Review, vol. 37, no 2, 2011, p. 267-306.
- Francesca Luppi, Bruno Arpino et Alessandro Rosina, The Impact of COVID‑19 on Fertility Plans in Italy, Germany, France, Spain and UK (2020).
- Daniele Vignoli et autres, Economic Uncertainty and Fertility in Europe: Narratives of the Future, Archives 2020_01 : documents de travail en économétrie, Universita’ degli Studi di Firenze, Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” (2020). Lien : https://bit.ly/3eIuVvS.
- Chiara L. Comolli et Daniele Vignoli, Spread-ing Uncertainty, Shrinking Birth Rates, Archives : documents de travail en économétrie, Universita’ degli Studi di Firenze, Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” (2019).
- Francesca Luppi, Bruno Arpino et Alessandro Rosina, The Impact of COVID‑19 on Fertility Plans in Italy, Germany, France, Spain and UK.
- Nina Boberg-Fazlić et autres, Disease and Fertility : Evidence from the 1918 Influenza Pandemic in Sweden, Discussion Paper Series, IZA – Institute of Labor Economics (2017); Sebastian Klüsener et Mathias Lerch, Fertility and Economic Crisis: How Does Early Twentieth Century Compare to Early Twenty-first Century?, document présenté à la Population Association of America; présentation virtuelle (2020).
- Eva Beaujouan, « Latest‐Late Fertility? Decline and Resurgence of Late Parenthood Across the Low‐Fertility Countries » dans Population and Development Review, 2020, p. 1-29. Lien : https://bit.ly/2AjlOD6
- Eva Beaujouan et Tomáš Sobotka, « Late Childbearing Continues to Increase in Developed Countries » dans Population and Societies, no 562 (janvier 2019).
- Eva Beaujouan, « Latest‐Late Fertility? Decline and Resurgence of Late Parenthood Across the Low‐Fertility Countries ».
- Melissa Moyser et Anne Milan, « Taux de fécondité et activité des femmes sur le marché du travail au Québec et en Ontario » dans Regards sur la société canadienne, no 75-006-X au catalogue de Statistique Canada. Lien : https://bit.ly/38iMxMG
Entretien avec Lucy Gallo à propos de l’accès, de l’adaptation et de la résilience chez les jeunes LGBTQI2S
Gaby Novoa
29 juin 2020
Le bien-être financier, physique et mental des communautés LGBTQI2S au Canada a été affecté de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19. Une enquête nationale a révélé que 42 % des membres de la communauté LGBTQI2S ont signalé que la crise avait eu des effets importants sur leur santé mentale, contre 30 % des personnes non LGBTQI2S.
Le 23 juin 2020, nous avons communiqué avec Lucy Gallo, directrice des Services à la jeunesse et au logement de Friends of Ruby, pour découvrir comment les jeunes LGBTQI2S de Toronto ont vécu les derniers mois et de quelle façon son organisme s’est adapté pour continuer à servir et à soutenir ces jeunes.
Parlez-nous de la façon dont Friends of Ruby s’est adapté et a réagi tout au long de la pandémie de COVID-19 pour continuer à servir et à soutenir les jeunes LGBTQI2S.
Nous avons fermé notre espace d’accueil un vendredi, et le lundi suivant, nos conseillers étaient au téléphone pour communiquer avec nos jeunes – ils ont immédiatement assuré les services et les soins requis. Les conseillers ont rapidement adopté l’Internet pour offrir des séances téléphoniques et vidéo, ce qui les tient encore très occupés d’ailleurs, et nous sommes ravis d’avoir lancé un programme de counseling par clavardage. Tous les membres du personnel sont maintenant entièrement formés pour offrir également des services de counseling par clavardage.
Nous avons découvert qu’il y avait des jeunes qui vivaient toujours avec leur famille, à qui certains n’ont pas encore annoncé leur identité sexuelle, et qu’ils ne disposaient pas d’un espace privé pour avoir accès à du counseling téléphonique. Cette option de clavardage leur donne maintenant la possibilité d’accéder à du soutien, tandis que leurs parents croient qu’ils envoient simplement des textos à un ami. C’est un procédé que nous avons toujours souhaité élaborer, mais que nous n’avions jamais entrepris faute de ressources. La pandémie de COVID-19 a donc accéléré les choses et nous a obligés à agir sans attendre. J’ai rapidement organisé la formation des membres du personnel en deux demi-journées et ils peuvent continuellement recevoir de l’aide d’une personne expérimentée en counseling par clavardage.
Comme notre espace d’accueil n’était pas disponible pour les jeunes que nous accompagnons, l’un des thèmes qui ont été soulevés lors de nos conversations avec eux au début de la pandémie était la difficulté d’accéder à de la nourriture. Nous avons répondu en offrant des cartes-cadeaux, et avons également été en mesure d’envoyer des repas en partenariat avec un autre organisme, ce qui nous a permis de livrer deux repas par semaine à certains de nos jeunes.
En nous adaptant à la pandémie, nous avons également essayé d’organiser quotidiennement des groupes virtuels afin de permettre aux jeunes de continuer d’avoir accès à notre organisme au maximum. Cela nous a donné l’occasion de réunir les gens en ligne, de sympathiser et de partager leur quotidien. Notre groupe de discussion pour les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) a été précieux, compte tenu de l’ampleur du racisme et de ce qui se passe actuellement dans le monde. Ce fut une période difficile pour les jeunes Noirs. Lorsque Toronto, au début de la pandémie, a commencé à annoncer qu’on allait demander aux gens qui sortaient de fournir des documents d’identité et qu’il était possible de dénoncer les autres, beaucoup de jeunes appartenant aux PANDC ne voulaient pas se rendre au centre de peur de subir davantage de racisme. Nous avons également ajouté des heures d’utilisation supplémentaires, en particulier avec notre personnel noir, afin de soutenir nos jeunes Noirs.
Parmi les autres programmes que nous avons continué d’offrir, mentionnons notre groupe d’art-thérapie, les séances virtuelles de l’espace d’accueil, les jeux vidéo et « art for change » (l’art comme moteur de changement). De plus, avec le soutien du Centre for Mindfulness Studies, deux de nos conseillers ont dirigé avec succès un groupe axé sur les compétences reliées à la pleine conscience en vue de faire face au stress et à l’anxiété (Mindfulness-Based Skills for Coping with Stress and Anxiety).
Nous avons également commencé à offrir du soutien en personne et des possibilités d’interaction. Nous avons de nouveau ouvert l’espace d’accueil, amorçant notre propre version de la « phase 2 ». Nous fournissons des produits essentiels que les gens peuvent venir chercher comme des repas à emporter, des trousses de réduction des risques, des trousses d’hygiène menstruelle et plus encore. Ils peuvent maintenant accéder à la gestion de cas en personne – nous avons ouvert une salle disposant de suffisamment de distance – et de plexiglas – et avons aménagé l’espace de telle façon qu’elle pourrait dès maintenant recevoir au moins six personnes. Nous avons également pensé que si un jeune ne pouvait pas joindre son conseiller depuis son domicile ou s’il ne voulait pas discuter en ligne, il pourrait venir dans cette salle et avoir l’intimité nécessaire pour communiquer virtuellement avec son conseiller.
Bon nombre des services que nous avons élaborés ou améliorés au cours des derniers mois seront également offerts après la pandémie. L’objectif est d’offrir ces nouvelles modalités à tous nos jeunes tout comme aux jeunes de partout au Canada qui désirent utiliser nos services de counseling ou communiquer avec nous en ligne.
Parlez-nous des thèmes communs que vous avez rencontrés pendant la pandémie chez les jeunes LGBTQI2S que vous accompagnez.
Je pense que le sentiment de solitude est un thème qui s’impose. Le fait de ne pouvoir accéder à nos locaux a créé beaucoup d’anxiété au début quant à la signification de tout ce phénomène. Comment cela affecte-t-il tout un chacun? Ne plus pouvoir compter sur notre habituelle communauté a été difficile, surtout pour les jeunes qui avaient l’impression de ne pas avoir l’intimité, l’espace ou la sécurité nécessaires à la maison avec leur famille.
Parlez-nous de certaines des leçons que vous avez apprises en adaptant Friends of Ruby afin de continuer d’accompagner les jeunes. Y a-t-il eu des surprises ou des prises de conscience?
Une chose intéressante, et je vais l’utiliser comme exemple parmi tant d’autres, c’est que si une personne a des idées suicidaires et qu’elle se trouve avec vous dans un local, vous pouvez évaluer la situation et, avec un peu de chance, la désamorcer, car cette personne se trouve en sécurité près de vous. Mais ce que j’ai constaté, c’est que lorsqu’on est en ligne et qu’on ne sait pas où se trouve la personne, comment peut-on lui procurer un sentiment de sécurité?
Nous avons dû créer rapidement des documents, puis demander aux jeunes de les lire et d’accepter de fournir des renseignements sur l’endroit où ils se trouvent, comme leur adresse et le moyen de communiquer avec eux si la ligne devait couper. Ce protocole s’applique également dans de nombreux cas. Lorsque nous dirigeons nos groupes thérapeutiques virtuels, comment savoir, lorsqu’une ligne se déconnecte, s’il s’agissait d’une déconnexion accidentelle et que la personne n’est pas contrariée, ou si elle n’a pas délibérément interrompu l’appel à cause d’un aspect du groupe qui l’a bouleversée? Ce sont là quelques-unes de nos prises de conscience. Lorsque la personne se trouve devant nous, la façon de travailler est tellement différente. Ce sont quelques-uns des moyens que nous avons dû adopter et instaurer pour la sécurité de tous.
Parlez-nous des expériences uniques ou des histoires d’adaptation ou de résilience des jeunes que vous accompagnez.
Il y a eu une résilience incroyable parmi nos jeunes à travers tout cela. Les gens que nous avons eu de la difficulté à suivre sont nos jeunes de passage, parce qu’ils n’avaient pas de coordonnées pour nous permettre de les joindre lorsque nous avons fermé nos portes. Puisqu’ils viennent généralement nous voir juste en passant, notre fermeture a complexifié nos contacts, même si quelques-uns sont passés nous saluer et nous dire qu’ils se débrouillaient très bien. Évidemment, nous n’avons pas pu voir tout le monde, mais les gens que nous avons vus ont fait preuve de beaucoup de résilience et d’adaptation.
Les conseillers nous ont dit que plusieurs jeunes n’étaient pas certains de vouloir faire du counseling en ligne. Cependant, une personne qui a continué de travailler pendant la pandémie a déclaré qu’elle appréciait réellement cette option, car elle pouvait suivre un programme de counseling sans avoir à se déplacer entre son lieu de travail et le centre. Cela facilite l’accès au counseling pour certains.
Qu’espérez-vous ou qu’envisagez-vous pour les mois à venir?
À l’heure actuelle, nous prévoyons ouvrir davantage l’espace d’accueil, à mesure que la Ville ouvrira de nouveaux espaces. L’objectif est de permettre à plus de gens de venir sur place et, espérons-le, de favoriser un plus grand sentiment communautaire. Chaque conseiller compte deux ou trois personnes qui attendent une consultation en personne. Nous envisageons de faire venir ces conseillers afin qu’ils puissent voir les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire de counseling en ligne. Pour le groupe de discussion des PANDC, nous envisageons de l’animer virtuellement, mais aussi en personne.
Pendant ce temps, les gens pourraient venir sur place pour faire partie du groupe, tandis que d’autres seraient aussi connectés virtuellement : nous pourrions ainsi répondre aux besoins des gens à la fois hors ligne et en ligne. Comme je l’ai mentionné plus tôt, nous envisageons de lancer une autre session de groupe sur les compétences reliées à la pleine conscience en vue de faire face au stress et à l’anxiété vers la mi-juillet, si possible. Au cours des prochaines semaines, le personnel continuera de discuter des moyens d’étendre nos services, et nous continuerons d’offrir des repas à emporter ainsi que de la gestion de cas, tant en personne que virtuellement.
Communiquez avec Friends of Ruby sur les médias sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn) pour suivre l’évolution de leur offre de services et de programmes.
Gaby Novoa, Centre de connaissances sur les familles au Canada, Institut Vanier de la famille
Cet entretien a été révisé afin d’atteindre une longueur, une fluidité et une clarté optimales.
Insécurité alimentaire et finances familiales pendant la pandémie
Nadine Badets
12 juin 2020
Le confinement lié à la COVID‑19 et les répercussions économiques qui en découlent ont engendré un stress financier important chez les familles au Canada. Entre février et avril 2020, environ 1,3 million de personnes au Canada étaient au chômage, dont environ 97 % avaient récemment été mis à pied sur une base temporaire, ce qui signifie qu’elles peuvent s’attendre à retrouver leur emploi lorsque les restrictions liées à la pandémie seront assouplies1.
Des recherches ont démontré que l’insécurité financière peut considérablement limiter l’accès à la nourriture pour les familles à faible revenu en plus d’accentuer les inégalités socioéconomiques2. D’autres facteurs, comme la santé et l’incapacité, le niveau de soutien social et la disponibilité restreinte de certains produits alimentaires, contribuent également à l’insécurité alimentaire pendant la pandémie de COVID‑19.
Les inégalités financières sont renforcées en ces temps de distanciation physique et de confinement
Dans l’ensemble, 5,5 millions d’adultes au Canada ont été touchés par la perte d’un emploi ou ont vu leurs heures de travail diminuer pendant le confinement lié à la COVID‑19, ce qui indique que ces personnes et leur ménage ont subi une importante réduction de leurs revenus destinés aux nécessités, comme la nourriture et le logement3. En 2018, environ 3,2 millions de personnes vivaient en deçà du seuil officiel de la pauvreté au Canada4, et il est fort probable que ces chiffres aient augmenté compte tenu des répercussions économiques de la pandémie.
Ce contexte contribue également à accentuer les inégalités financières actuelles5. En 2015, la fréquence du faible revenu à l’échelle nationale au Canada était de 14 %, mais elle était beaucoup plus élevée chez certains groupes, comme les immigrants (les Arabes, les Asiatiques occidentaux, les Coréens, les Chinois), les peuples autochtones (les Premières Nations, les Inuits, les Métis) et les Noirs6, 7. Ces groupes étaient plus susceptibles de vivre avec un faible revenu avant le confinement lié à la COVID‑19, et d’indiquer que la pandémie avait eu un effet négatif sur leurs finances. Selon les données d’un récent sondage mené par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger8, plus de la moitié des minorités visibles (51 %) ont vu leurs revenus diminuer pendant le confinement, et les Autochtones (42 %) étaient plus susceptibles de signaler avoir éprouvé de la difficulté à respecter leurs obligations financières, notamment à payer leurs factures à temps9, 10.
Le recours aux banques alimentaires de partout au Canada est en forte hausse depuis le début de la pandémie de COVID‑19
Avant la pandémie de COVID‑19, l’organisme Banques alimentaires Canada estimait que la fréquentation des banques alimentaires à l’échelle du pays s’était stabilisée, ayant comptabilisé en 2019 presque le même nombre de visites qu’en 2018, soit un niveau semblable à celui de 2010. Au cours du mois de mars 2019, on enregistrait près de 1,1 million de visites dans les banques alimentaires dans l’ensemble du pays, et plus de 374 000 visites visaient à nourrir les enfants11.
Statistique Canada estime qu’en 2017-2018, environ 9 % des ménages canadiens, soit 1,2 million, étaient en situation d’insécurité alimentaire, ce qui signifie qu’ils éprouvaient des difficultés financières à se procurer de la nourriture et qu’ils n’en avaient pas suffisamment pour que tous les membres du ménage puissent manger des repas nutritifs sur une base régulière12, 13. Comme dans le cas de l’insécurité financière, l’insécurité alimentaire touche certains groupes de manière disproportionnée au Canada. Par exemple, en 2014, l’insécurité alimentaire chez les Noirs (29 %) et les Autochtones (26 %) était plus de deux fois supérieure à la moyenne nationale (12 %)14.
Les recherches démontrent systématiquement que les personnes vivant dans des collectivités isolées et du Nord sont plus susceptibles de connaître l’insécurité alimentaire, c’est notamment le cas des collectivités inuites de l’Inuit Nunangat, la terre natale des Inuits15. Il a également été constaté que les peuples autochtones vivant en milieu urbain sont particulièrement touchés par l’insécurité alimentaire. En 2017, 38 % des Autochtones de 18 ans et plus vivant en milieu urbain étaient en situation d’insécurité alimentaire16.
Depuis le début de la pandémie de COVID‑19, l’organisme Banques alimentaires Canada a signalé une augmentation moyenne de 20 % de la demande pour les services des banques alimentaires dans l’ensemble du pays, se rapprochant de façon alarmante de l’augmentation de 28 % observée pendant la Grande Récession. Selon les projections de Banques alimentaires Canada, on estime que la demande pourrait continuer d’augmenter pour atteindre des niveaux de 30 % à 40 % supérieurs à ce qu’ils étaient avant la pandémie. Certaines banques alimentaires – comme The Daily Bread à Toronto, l’une des plus grandes banques alimentaires au Canada – ont vu la demande augmenter de plus de 50 %17.
L’augmentation des ventes d’épicerie est associée à l’obtention du soutien financier de la PCU
Au début de la pandémie (entre la fin de mars et le début d’avril 2020), 63 % des gens ont déclaré avoir fait des provisions de produits alimentaires et pharmaceutiques essentiels par mesure de précaution18.
Les ventes d’épicerie à l’échelle du Canada ont connu une forte hausse en mars 2020, augmentant de 40 % vers la fin du mois et demeurant élevées jusqu’à la mi-avril19. L’octroi d’une aide financière fédérale aux chômeurs, comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU)20, semble directement relié à une augmentation des ventes d’épicerie, ce qui contribue probablement à atténuer l’insécurité alimentaire pour certains Canadiens21.
Actuellement, les bénéficiaires de la PCU ne peuvent toutefois soumettre leur demande de prestations que quatre fois, pour un total de 16 semaines. Or, à l’approche du mois de juillet 2020, de nombreux Canadiens utiliseront leur dernier versement de PCU, et ils ne seront pas tous admissibles à un transfert vers l’assurance-emploi, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur l’insécurité alimentaire au Canada.
Les parents seuls et les aînés disposant d’un faible niveau de soutien social sont ceux qui éprouvent le plus de difficultés à se procurer des denrées alimentaires
Les mesures de distanciation physique (sociale) ont également créé de nouveaux obstacles pour les individus et les familles qui tentent de s’y retrouver dans les nouvelles règles indiquant quand et comment s’y prendre pour faire l’épicerie, ou auprès de qui ils peuvent ou devraient se tourner pour faire faire leur épicerie. Pour certains, comme les aînés, les parents seuls, les personnes ayant des incapacités et celles qui ont un système immunitaire affaibli (ou qui s’occupent d’une personne présentant une telle condition), le fait de disposer de moyens financiers limités et d’un faible soutien social peut restreindre sérieusement l’accès à la nourriture.
En 2017-2018, les parents célibataires ayant des enfants de moins de 18 ans connaissaient les niveaux d’insécurité alimentaire les plus élevés au Canada. Les mères de famille monoparentale affichaient le plus fort taux d’insécurité alimentaire avec 25 %, suivies par les pères de famille monoparentale avec 16 %22. À titre comparatif, les hommes et les femmes vivant seuls affichaient un taux de 12 %, les couples avec enfants de moins de 18 ans, 7 %, et les couples sans enfant, 3 %23.
Les mesures de distanciation physique peuvent s’avérer particulièrement complexes pour les parents seuls n’ayant pas accès à des services de garde, car ils peuvent être contraints d’emmener les enfants à l’épicerie, enfreignant ainsi les règles de distanciation physique et risquant d’exposer les enfants au virus, ou encore de s’adresser à des organismes comme les banques alimentaires pour obtenir du soutien24.
Les aînés ayant un faible revenu sont moins susceptibles de bénéficier d’un haut niveau de soutien social (77 %) que les aînés vivant avec un revenu élevé (89 %). Durant les périodes d’isolement, comme dans le cas du confinement actuel, l’accès aux produits essentiels comme la nourriture peut être complexe, surtout pour les aînés ayant un faible revenu qui sont malades, inquiets pour leur santé ou incapables de se rendre à l’épicerie par eux-mêmes en raison de restrictions physiques ou financières25.
L’accaparement de certains aliments limite l’approvisionnement et l’accès pour les familles à faible revenu et les banques alimentaires
La pandémie de COVID‑19 a engendré dans le monde entier une série de tendances d’achats dictées par la panique, notamment de désinfectant pour les mains et de papier hygiénique26. Plusieurs épiceries et pharmacies ont vu certains de leurs stocks de produits épuisés à plusieurs reprises au cours de la pandémie.
À la mi-mars 2020, les ventes d’aliments secs et en conserve au Canada dépassaient celles des aliments frais et surgelés. Les ventes de riz ont augmenté de 239 % comparativement à la même période en 2019, les ventes de pâtes de 205 %, les ventes de légumes en conserve de 180 % et les ventes de préparations pour nourrissons de 103 %27. Ces aliments ayant une longue durée de conservation constituent en général une part importante des produits fournis par les banques alimentaires28, mais ont été plus difficiles à trouver pendant la pandémie, ce qui a limité l’approvisionnement pour les familles en situation d’insécurité alimentaire29.
Il serait nécessaire de procéder à des recherches supplémentaires afin de mieux comprendre les effets de la pandémie sur la faim, la nutrition et l’insécurité alimentaire dans les ménages du Canada en vue de soutenir et d’élaborer des programmes visant à réduire les inégalités liées à l’accès à la nourriture.
Pour trouver une banque alimentaire locale ou faire un don, visitez le site Web de Banques alimentaires Canada.
Nadine Badets, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Notes
- Statistique Canada, « La COVID‑19 et le marché du travail en avril 2020 » dans Infographies (8 mai 2020). Lien : https://bit.ly/3csM8HC
- Visitez le site Web de PROOF Food Insecurity Policy Research pour en savoir plus sur l’insécurité alimentaire et les inégalités sociales. Lien : https://bit.ly/2MQH8T8
- Statistique Canada, « La COVID‑19 et le marché du travail en avril 2020 ».
- Statistique Canada, « Défis en matière de santé et enjeux sociaux liés à la situation de la COVID‑19 au Canada » dans Le Quotidien (6 avril 2020). Lien : https://bit.ly/36UnyhJ
- Pour en savoir plus au sujet de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les inégalités au Canada, consultez la Déclaration – Les inégalités amplifiées par la crise de la COVID-19 de la Commission canadienne des droits de la personne (31 mars 2020).
- Statistique Canada, « Minorités visibles (15), statistiques du revenu (17), statut des générations (4), âge (10) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %) » dans Tableaux de données, Recensement de 2016 (mis à jour le 17 juin 2019). Lien : https://bit.ly/2YEGihM
- Statistique Canada, « Identité autochtone (9), statistiques du revenu (17), statut d’Indien inscrit ou des traités (3), âge (9) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %) » dans Tableaux de données, Recensement de 2016 (mise à jour le 17 juin 2019). Lien : https://bit.ly/3eJOx2m
- Le sondage réalisé par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger, du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars et du 3 au 5 avril, du 10 au 12 avril, du 17 au 19 avril, du 24 au 26 avril, du 1er au 3 mai et du 8 au 10 mai 2020, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Tous les échantillons, à l’exception de ceux du 10 au 13 mars et du 24 au 26 avril, comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. De plus, du 1er au 10 mai environ, un suréchantillon de 450 Autochtones a été ajouté. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
- Il est important de souligner qu’il existe une grande diversité au sein des groupes de minorités visibles et des populations autochtones. Tous ces groupes connaissent des expériences uniques et distinctes en matière d’insécurité financière et alimentaire, tout comme le sont les histoires, les régions, les cultures, les traditions et les langues qui leur sont propres.
- Pour en savoir plus sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les familles d’immigrants et les Premières Nations, les Métis et les Inuits, consultez Laetitia Martin, « Les familles nouvellement établies au Canada et le bien-être financier pendant la pandémie » (21 mai 2020) et Statistique Canada, « Premières Nations, Métis, Inuits et la COVID-19 : Caractéristiques sociales et de la santé » dans Le Quotidien (17 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2N2v8ht
- Banques alimentaires Canada, « Bilan-faim 2019 ». Lien : https://bit.ly/2Mkxp78
- Ibidem
- Statistique Canada, « Sécurité alimentaire du ménage selon la disposition de vie », tableau 13-10-0385-01 (consulté le 27 mai 2020). Lien : https://bit.ly/2yXGVtP
- Santé Canada, Insécurité alimentaire des ménages au Canada : Survol (dernière mise à jour le 18 février 2020). Lien : https://bit.ly/30un7K5
- Valerie Tarasuk, Andy Mitchell et Naomi Dachner, « L’insécurité alimentaire des ménages au Canada, 2014 », PROOF Food Insecurity Policy Research (19 mai 2016). Lien : https://bit.ly/2Bw77Nd (PDF)
- Paula Arriagada, « L’insécurité alimentaire chez les Inuits vivant dans l’Inuit Nunangat » dans Regards sur la société canadienne, no 75‑006X au catalogue de Statistique Canada (1er février 2017). Lien : https://bit.ly/2YpZcbR
- Paula Arriagada, Tara Hahmann et Vivian O’Donnell, « Les Autochtones vivant en milieu urbain : Vulnérabilités aux répercussions socioéconomiques de la COVID‑19 » dans StatCan et la COVID‑19 : Des données aux connaissances, pour bâtir un Canada meilleur (26 mai 2020). Lien : https://bit.ly/2Y0Uv8u
- Beatrice Britneff, « Food Banks’ Demand Surges Amid COVID‑19. Now They Worry About Long-Term Pressures », Global News (15 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3boEHRe
- Statistique Canada, « Comment les Canadiens vivent-ils la situation liée à la COVID‑19? » dans Infographies (8 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2BsWieL
- Statistique Canada, « Étude : Les consommateurs canadiens s’adaptent à la COVID‑19 : un aperçu des ventes d’épicerie canadiennes jusqu’au 11 avril » dans Le Quotidien (11 mai 2020). Lien : https://bit.ly/3e8GPis
- En avril 2020, le gouvernement fédéral du Canada a créé la Prestation canadienne d’urgence (PCU), qui fournit 2 000 $ toutes les quatre semaines aux travailleurs qui ont perdu leur revenu en raison de la pandémie. Cette prestation vise les personnes qui ont perdu leur emploi, qui sont malades, qui sont mises en quarantaine ou qui prennent soin d’une personne atteinte de la COVID‑19. Elle s’applique aux salariés, aux travailleurs contractuels et aux travailleurs autonomes qui sont dans l’incapacité de travailler. Les personnes peuvent gagner jusqu’à 1 000 $ par mois tout en percevant la PCU. En raison de la fermeture des écoles et des garderies partout au Canada, la PCU est offerte aux parents qui travaillent, mais qui doivent rester à la maison sans rémunération pour s’occuper de leurs enfants jusqu’à ce que les écoles et les garderies puissent rouvrir et accueillir à nouveau les enfants de tous âges en sécurité. Gouvernement du Canada, « Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 ». Lien : https://bit.ly/36UssLS
- Statistique Canada, « Étude : Les consommateurs canadiens s’adaptent à la COVID‑19 : un aperçu des ventes d’épicerie canadiennes jusqu’au 11 avril ».
- Statistique Canada, « Sécurité alimentaire du ménage selon la disposition de vie ».
- Ibidem
- La Banque d’alimentation d’Ottawa, « COVID‑19 Response Webinar – The First 5 Weeks » (13 mai 2020). Lien : https://bit.ly/2MsQCUl
- Kristyn Frank, « La COVID‑19 et le soutien social des aînés : les aînés ont-ils quelqu’un sur qui compter pendant les périodes difficiles? » dans StatCan et la COVID‑19 : Des données aux connaissances, pour bâtir un Canada meilleur (30 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3dsQlN6
- Statistique Canada, « Les consommateurs canadiens se préparent pour la COVID‑19 » dans Série analytique des prix (8 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2MsReJD
- Ibidem
- Banques alimentaires Canada, « Soutenez votre banque alimentaire locale ». Lien : https://bit.ly/2U79s7x
Les familles canadiennes s’adaptent : Un mariage à distance
Bien que la pandémie de COVID-19 ait touché les familles des quatre coins du Canada ainsi que le paysage socioéconomique, culturel et contextuel qui teinte leur bien-être, la vie de famille ne s’est pas pour autant arrêtée.
Qu’il s’agisse de concilier les responsabilités professionnelles et familiales, de se réunir au moment de célébrer des étapes importantes ou de s’épauler dans les moments difficiles, les gens trouvent des moyens divers et créatifs afin de poursuivre leurs activités, leur vie de famille.
Alors que les familles canadiennes s’affairent à gérer ces transitions, l’Institut Vanier de la famille s’engage à colliger, à compiler et à dépeindre les « histoires derrière les statistiques », afin de mettre en relief les forces, la résilience et la réalité des familles dans toute leur diversité au pays.
Un mariage à distance
Edward Ng, Ph. D.
1er juin 2020
Au début du mois de mai, j’ai assisté pour la première fois à un mariage en ligne. L’événement était prévu depuis longtemps, bien avant que la pandémie de COVID-19 ne soit déclarée. Une fois les mesures de confinement imposées à la mi-mars, le couple a dû repenser son projet de mariage afin que l’événement puisse plutôt se faire en ligne.
La cérémonie, qui s’est tenue à Montréal au domicile de la mariée, a finalement été retransmise sur YouTube partout dans le monde. Est-ce que ce sera la tendance dans le futur? La seule « réunion familiale virtuelle » à laquelle j’aie pris part avant celle-ci avait été organisée pour les funérailles de mon oncle, décédé il y a quelques années à Sydney, en Australie.
La cérémonie a débuté à 10 h 30, un samedi matin (ou à une autre heure, dépendamment de l’endroit où se trouvaient les invités en ligne). Après l’introduction musicale, la bouquetière et le porteur des anneaux ont fait leur entrée sous nos yeux, mais plutôt que de remonter l’allée jusqu’à l’autel d’une église, ils ont foulé le couloir de leur propre maison, lançant des fleurs et des confettis sur leur chemin. Puis a suivi la performance bien orchestrée d’un quatuor, réuni virtuellement, nous offrant quelques pièces musicales pour l’occasion. Celui-ci a cédé la place à un chœur dont les voix séparées n’en étaient pas moins harmonieuses, de là où elles nous provenaient. Puis vinrent les discours des célébrants, suivis de l’échange des vœux et des alliances, et enfin la signature du contrat de mariage. La cérémonie a duré un peu plus d’une heure et s’est terminée par une séance d’égoportraits (pourrait-on dire).
Mais dans l’euphorie du moment, ni la famille ni les invités – ni même les mariés – ne se sont souciés de savoir si nous étions présents, virtuellement. Tout n’était pas pareil – côté tenue vestimentaire, certains d’entre nous avaient choisi de revêtir leurs plus beaux atours pour l’occasion, arborant une robe de soirée ou un complet-veston, tandis que d’autres avaient plutôt opté pour un style décontracté. Les gens s’étaient adaptés tel qu’ils le jugeaient opportun, alors que nous vivions cette expérience tous ensemble, quoique séparés.
La fonction de diffusion sur YouTube a été utilisée, ce qui a permis aux spectateurs des quatre coins du monde de participer à l’événement en temps réel. Dès le début de la cérémonie en ligne, nous avons constaté que de nombreux souhaits et commentaires de félicitations défilaient sous nos yeux. La famille, les amis et les proches de Montréal, d’Ottawa et de Toronto, ainsi que des États-Unis, d’Europe, d’Australie et d’Asie ont transmis leurs vœux au couple. Un invité a fait remarquer que c’était la première fois que les gens présents à un mariage pouvaient apporter leurs commentaires et faire part de leur appréciation du moment aussi instantanément.
En faisant le mariage en ligne, davantage de personnes ont pu y assister, dont certaines qui n’auraient pas pu y participer autrement. Pour ma propre famille, rejoindre Montréal constitue au moins deux ou trois heures de route dans chaque direction; pour ceux qui y assistent depuis l’Asie, cela représente au moins deux jours de voyage aller-retour (pour un coût nettement plus élevé, si les vols étaient autorisés). En outre, ces voyageurs internationaux auraient dû être mis en quarantaine pendant au moins 14 jours. Il leur aurait donc été impossible d’assister au mariage.
À la fin de l’événement, les jeunes mariés ont offert leurs remerciements à l’équipe responsable de l’organisation du mariage en ligne, et nous ont promis que des festivités seraient organisées pour célébrer le mariage une fois l’ordonnance de confinement levée. Nous attendons tous ce jour avec impatience, mais nous avons finalement connu une expérience fort positive dans le cadre de cet événement familial en ligne. Dans ce cas-ci, la célébration virtuelle du mariage était nécessaire, pratique et judicieuse, surtout dans le contexte de la pandémie. Le temps nous dira si les événements familiaux en ligne deviendront la norme dans le futur.
Edward Ng, Ph. D., Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Recherche en bref : Les travailleurs mobiles en Alberta pendant la pandémie de COVID‑19
Gaby Novoa
28 mai 2020
L’industrie des sables bitumineux de l’Alberta ayant été désignée comme service « essentiel » le 2 avril 2020, de nombreux travailleurs par navette de l’industrie n’ont cessé de voyager et de passer de longues périodes sur les sites de travail, dans des milieux souvent bondés, et ce, dans un contexte de pandémie. Bien que ces conditions soient antérieures à l’apparition du coronavirus et qu’elles aient déjà fait l’objet de recherches par le Partenariat en mouvement, elles ont de nouvelles incidences qui auront un impact sur les travailleurs, leur famille, leur communauté d’origine et les employeurs.
Dans l’article intitulé « COVID-19 and (Im)Mobile Workers in Alberta’s ‘Essential’ Oil Industry1 », Sara Dorow, Ph. D., cochercheuse du Partenariat en mouvement, met en lumière certaines expériences de ces travailleurs et partage des recherches portant sur les répercussions sanitaires et sociales de ce contexte de travail en pleine période de pandémie.
L’incidence des déplacements continus sur la santé publique et les relations familiales pendant la pandémie
Les déplacements continus entre les sites d’exploitation des sables bitumineux en Alberta et les communautés d’origine des travailleurs de partout au Canada augmentent le risque de transmission. En mai 2020, parmi plus de 100 cas confirmés de COVID‑19 associés à un site d’exploitation de sables bitumineux, le quart des personnes touchées résidaient à l’extérieur de l’Alberta. Par ailleurs, Sara Dorow explique que la propagation du virus n’est que l’un des enjeux actuels associés au travail mobile. Les industries fondées sur le travail par navette peuvent nuire aux relations que les travailleurs entretiennent avec leur famille, leurs amis et leur communauté. La recherche a démontré que cette pression peut avoir un impact non seulement sur les relations des gens, mais aussi sur de nombreux aspects liés à leur santé physique et mentale.
Étant donné que les déplacements ont été restreints, voire interdits en raison des mesures de santé publique visant à prévenir la propagation virale, de nombreux travailleurs sont confrontés à des roulements plus longs et donc à des séjours prolongés dans des campements de travailleurs, éloignés de leur famille pendant des périodes pouvant atteindre quelques mois. Les familles s’adaptent de manière créative pour rester en contact et gérer leurs responsabilités, mais la tâche peut parfois s’avérer difficile2.
La pandémie exacerbe les difficultés préexistantes dans les campements de travailleurs
Sara Dorow souligne que la pandémie ne fait qu’exacerber les difficultés associées à l’environnement du campement de travail, dans lequel les travailleurs navetteurs interrogés disent se sentir emprisonnés ou avoir la sensation d’être perçus comme du bétail. Selon la saison et le prix du pétrole, les campements peuvent être assez bondés. Même lorsqu’ils sont moins occupés, les campements sont aménagés autour de quartiers rapprochés afin que les résidents puissent partager des espaces communs, comme des salles à manger, des gymnases et parfois des salles de bain, ceux-ci se déplaçant quotidiennement à bord de bus-navettes.
Ce manque d’espace est crucial, car la recherche a démontré que les logements surpeuplés peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé physique et psychique. Sara Dorow souligne également que les services essentiels dans ces campements de travail sont assurés par des travailleurs de première ligne qui sont responsables de l’hébergement, du nettoyage et des soins – tous des travailleurs mobiles qui font également partie du roulement entre les campements, et qui vivent également de longues périodes d’immobilité sur le site.
Les industries fondées sur le travail par navette, comme celle des sables bitumineux, peuvent rendre la distanciation sociale difficile. De plus, au‑delà du contexte pandémique actuel, ces environnements de travail présentent également des risques systémiques pour la santé. La pression qu’exercent le travail mobile et les longs séjours sur place sur les relations des travailleurs doit également être reconnue et analysée en profondeur. Sara Dorow mentionne certains facteurs qui seraient susceptibles d’atténuer l’ampleur de ces difficultés, comme l’accès à une nourriture saine, des programmes de jumelage et des roulements de travail permettant aux gens de passer plus que quelques jours à la fois chez eux. La restructuration et la refonte de ces sites et de ces systèmes peuvent contribuer à assurer la sécurité et le bien-être des travailleurs, de leur famille et de leur communauté d’origine.
Gaby Novoa est responsable des communications à l’Institut Vanier de la famille.
Consultez l’article « COVID-19 and (Im)Mobile Workers in Alberta’s ‘Essential’ Oil Industry » par Sara Dorow, Ph. D.
Notes
- Recherche en bref de l’article de Sara Dorow, Ph. D., « COVID-19 and (Im)Mobile Workers in Alberta’s ‘Essential’ Oil Industry », Partenariat en mouvement (20 mai 2020).
- Sara Dorow et Shingirai Mandizadza, « Réseaux d’entraide : la mobilité, le travail et la gestion des relations familiales », L’Institut Vanier de la famille (10 janvier 2017).
Les finances familiales et la santé mentale pendant la pandémie de COVID‑19
Ana Fostik, Ph. D., et Jennifer Kaddatz
26 mai 2020
En mars 2020, la pandémie de coronavirus a entraîné l’interruption soudaine des activités socioéconomiques dans l’ensemble du Canada, les données montrant d’importantes répercussions sur l’activité du marché du travail. Selon de récentes estimations de Statistique Canada, le nombre de Canadiens ayant un emploi en mars s’élevait à un million de moins qu’en février, ce qui a affecté la participation habituelle au marché du travail de 3,1 millions de Canadiens (c.-à-d. qu’ils ont travaillé moins d’heures ou perdu leur emploi)1.
D’après des données recueillies lors d’un sondage mené du 10 au 12 avril 2020 par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes (AEC) et la firme Léger2, 38 % des hommes et 34 % des femmes de 18 ans et plus ont déclaré avoir perdu leur emploi de façon temporaire ou permanente ou avoir subi des pertes de salaire ou de revenus en raison de la pandémie de COVID‑19. Dans ce contexte, 27 % des hommes et 25 % des femmes ont dit subir des conséquences financières négatives (affectant leur capacité à payer leur hypothèque, leur loyer ou leurs factures).
C’est sans surprise que Statistique Canada a récemment constaté que les adultes ayant subi des répercussions importantes ou modérées de la pandémie étaient beaucoup plus susceptibles de déclarer une santé mentale passable ou faible que ceux qui ont été moins touchés (25 % et 13 %, respectivement)3.
Les données recueillies à la mi-avril par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger montrent que les plus jeunes adultes ont été particulièrement touchés : plus de la moitié (52 %) des 18 à 34 ans ont déclaré avoir subi des répercussions négatives sur leur participation au marché du travail (pertes d’emploi, de salaire ou de revenus), par rapport à 39 % des adultes de 35 à 54 ans et à 21 % des 55 ans et plus. Cette situation se reflète également dans la proportion d’adultes ayant subi des conséquences financières négatives immédiates, qui ont été signalées par 33 % des adultes de moins de 55 ans et 15 % des 55 ans et plus.
Les adultes en difficulté financière sont plus susceptibles de signaler des problèmes de santé mentale
Parmi la population en âge de travailler (de 18 à 54 ans), un peu plus de la moitié a indiqué éprouver souvent ou très souvent de l’anxiété ou de la nervosité (53 %), de l’irritabilité (49 %) ou de la tristesse (48 %) pendant la pandémie de COVID‑19, selon le sondage mené par l’Institut Vanier, l’AEC et la firme Léger. Quatre personnes sur 10 ont affirmé avoir souvent ou très souvent de la difficulté à dormir (40 %) ainsi que des sautes d’humeur (40 %).
Parmi les personnes ayant essuyé des conséquences négatives immédiates, comme l’incapacité de payer le loyer, l’hypothèque ou les factures, environ 6 sur 10 ont dit avoir ressenti souvent ou très souvent de l’anxiété ou de la nervosité (63 %), de l’irritabilité (60 %) ou de la tristesse (57 %), alors que la moitié a indiqué avoir eu souvent ou très souvent de la difficulté à dormir (50 %) ou des sautes d’humeur (52 %) (figure 1).
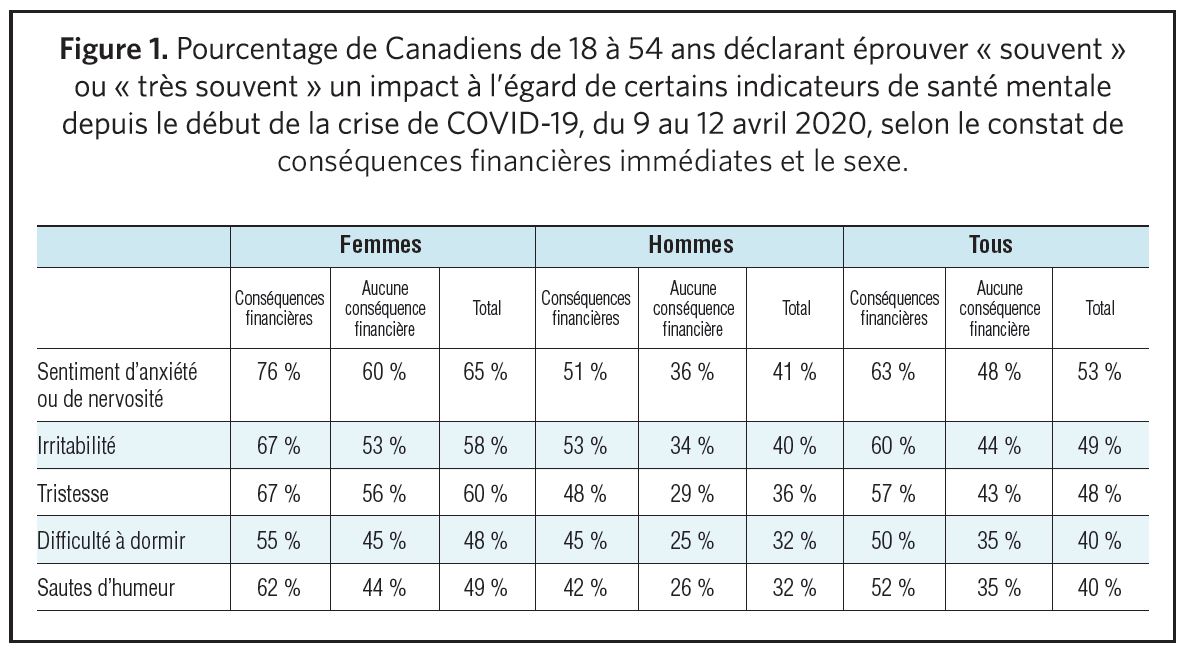
Les femmes en difficulté financière souffrent de problèmes de santé mentale dans des proportions plus élevées que les hommes
D’après l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2018, les femmes étaient légèrement moins susceptibles que les hommes de signaler avoir une santé mentale excellente ou bonne (66 % et 71 %, respectivement)4. Pendant la pandémie de coronavirus, toutefois, Statistique Canada a constaté que la différence était beaucoup plus marquée, avec 49 % des femmes et 60 % des hommes ayant une bonne ou une excellente santé mentale5.
Les données du sondage de l’Institut Vanier, de l’AEC et de la firme Léger montrent que les femmes de 18 à 54 ans déclarant connaître souvent ou très souvent des problèmes spécifiques de santé mentale sont représentées dans des proportions beaucoup plus grandes que les hommes du même groupe d’âge. Environ 6 femmes sur 10 ont indiqué ressentir souvent ou très souvent de l’anxiété ou de la nervosité, de l’irritabilité ou de la tristesse, comparativement à 4 hommes sur 10. De même, environ la moitié des femmes ont eu souvent ou très souvent de la difficulté à dormir ou des sautes d’humeur, par rapport à 3 hommes sur 10 (figure 1).
Cette différence entre les sexes à l’égard des problèmes de santé mentale déclarés est maintenue même lorsque l’on compare les proportions d’hommes et de femmes ayant subi des conséquences financières négatives immédiates et les proportions de ceux qui n’en ont pas subi. Par exemple, les trois quarts des femmes (76 %), par rapport à la moitié des hommes (51 %), qui ont eu de la difficulté à payer leur hypothèque, leur loyer ou leurs factures ont dit ressentir souvent ou très souvent de la nervosité ou de l’anxiété. Près de 7 femmes sur 10 ayant des difficultés financières éprouvent de l’irritabilité (67 %) ou de la tristesse (67 %), comparativement à environ la moitié des hommes vivant la même situation (53 % et 48 %, respectivement) (figure 1).
Environ 6 femmes sur 10 ayant des difficultés financières disent avoir souvent ou très souvent de la difficulté à dormir (55 %) et des sautes d’humeur (62 %), par rapport à 4 hommes sur 10 vivant la même situation (45 % et 42 %, respectivement) (figure 1).
Les adultes ayant des difficultés financières, qu’ils vivent ou non avec de jeunes enfants, signalent des problèmes de santé mentale semblables
Si les femmes sont beaucoup moins susceptibles que les hommes de déclarer une santé mentale positive pendant la pandémie, même en tenant compte des répercussions financières, quels facteurs peuvent entrer en jeu dans l’établissement de ces différences entre les sexes? Ces problèmes de santé mentale peuvent-ils être associés aux responsabilités familiales?
Une analyse des données recueillies du 10 au 12 avril 2020 indique que la présence d’enfants à la maison ne semble pas associée à l’aggravation des symptômes d’une mauvaise santé mentale. Les femmes vivant avec des enfants de 12 ans et moins au sein de leur ménage disent éprouver souvent et très souvent de l’anxiété ou de la nervosité (69 %), de l’irritabilité (60 %), de la tristesse (59 %), de la difficulté à dormir (51 %) et avoir des sautes d’humeur (51 %) dans des proportions semblables à celles des femmes vivant sans enfant (63 %, 57 %, 60 %, 47 % et 48 %, respectivement). Les hommes vivant avec de jeunes enfants signalent également de tels problèmes dans des proportions semblables à celles des hommes vivant sans enfant (figure 2).
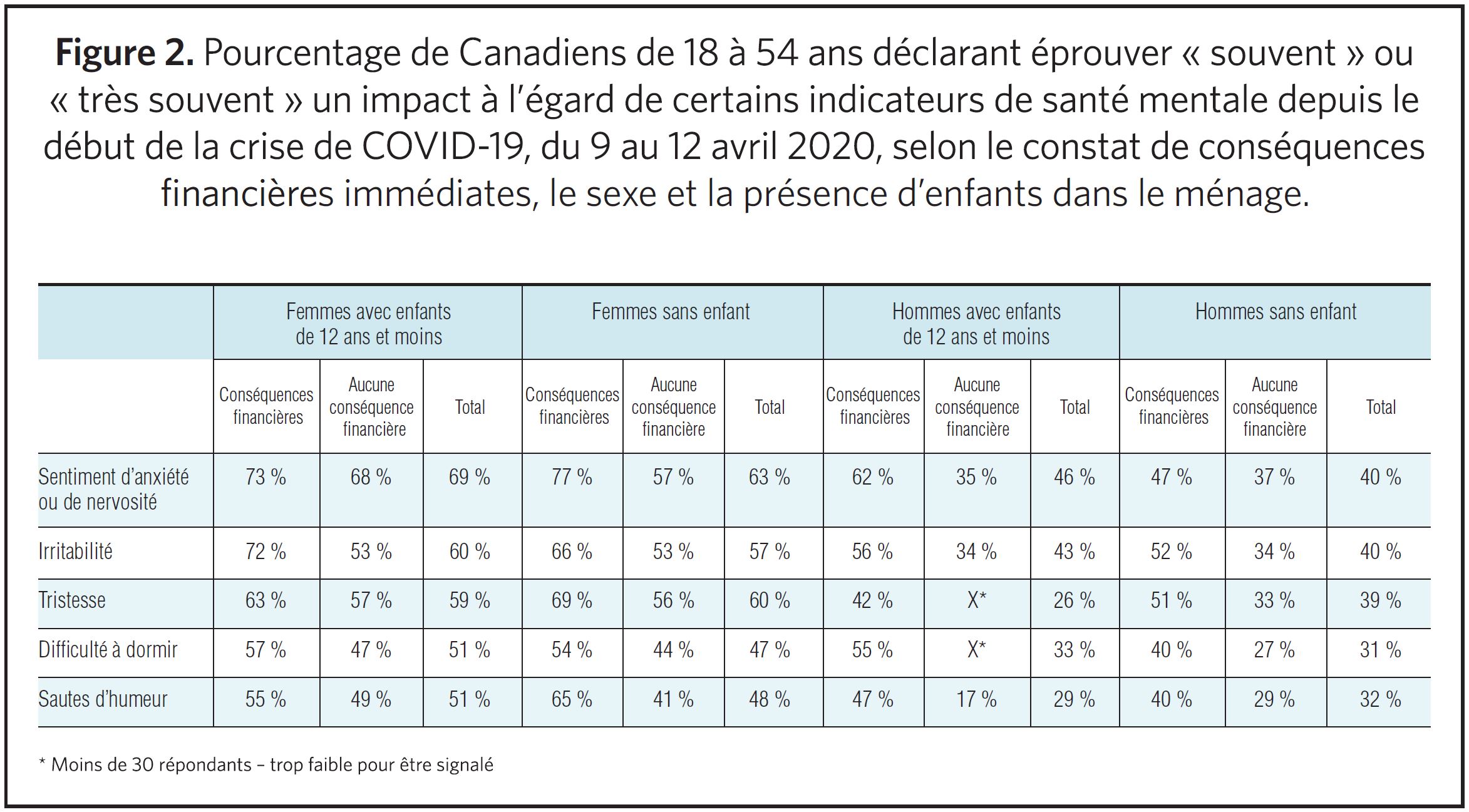
Parmi les femmes en difficulté financière, on observe peu de différences entre les proportions de celles déclarant l’un ou l’autre de ces problèmes de santé mentale, qu’elles aient ou non de jeunes enfants au sein du ménage. Cela est également le cas pour les femmes qui n’ont pas subi de conséquences financières négatives immédiates : la cohabitation dans le ménage avec des enfants de 12 ans et moins ne semble pas changer les choses (figure 2).
L’analyse de l’état de santé mentale autodéclaré démontre la persistance de certaines différences selon le sexe lorsque l’on tient compte de la province de résidence, de l’âge, de la difficulté financière, de la perte d’emploi ou de salaire, de la présence d’enfants de 12 ans et moins, du revenu du ménage, de l’état matrimonial et du niveau de scolarité. En contrôlant ces variables et en les comparant à celles des hommes qui sont en difficulté financière, les femmes en difficulté financière sont environ deux fois plus susceptibles de souffrir d’anxiété, de tristesse ou de sautes d’humeur. Parmi les adultes n’ayant pas subi de conséquences financières négatives, on n’observe aucune différence marquée entre les hommes et les femmes à l’égard de la santé mentale, une fois ces facteurs contrôlés.
Cette analyse n’a pas permis d’identifier les raisons potentielles expliquant pourquoi les femmes sont plus susceptibles que les hommes de signaler des symptômes de mauvaise santé mentale, mais les recherches futures pourraient se concentrer sur les différences psychologiques qui existent entre les femmes et les hommes lors d’une situation de crise, afin de déterminer si oui ou non les femmes et les hommes réagissent différemment dans une situation de crise ou devant une menace immédiate pour la santé ou le bien-être de leur famille ou d’eux-mêmes. Des recherches plus approfondies examinant l’impact des aspects sexospécifiques par rapport à la charge de travail et à la prestation de soins au sein du ménage, y compris la charge mentale associée à ces tâches non rémunérées, pourraient également contribuer à faire la lumière sur ces différences.
Ana Fostik, Ph. D., Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Jennifer Kaddatz, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Notes
- Statistique Canada, « Les répercussions de la COVID-19 sur le marché du travail canadien » dans Infographies (9 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3cQDBzj
- Un sondage de l’Institut Vanier de la famille, de l’Association d’études canadiennes et de la firme Léger, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars et du 3 au 5 avril, du 10 au 12 avril, du 17 au 19 avril et du 24 au 26 avril 2020, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Tous les échantillons, à l’exception de ceux du 10 au 13 mars et du 24 au 26 avril, comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
- Statistique Canada, « Série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes 1 : Répercussions de la COVID‑19 sur la sécurité d’emploi et les finances personnelles, 2020 » dans Le Quotidien (20 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3e7yaMC
- Leanne Findlay et Rubab Arim, « Les Canadiens perçoivent leur santé mentale comme étant moins bonne pendant la pandémie de COVID-19 » dans StatCan et la COVID‑19 : Des données aux connaissances, pour bâtir un Canada meilleur, no 45-28-0001 au catalogue de Statistique Canada (24 avril 2020). Lien : https://bit.ly/36l4Gs7
- Ibidem
Les familles nouvellement établies au Canada et le bien-être financier pendant la pandémie
Laetitia Martin
21 mai 2020
En 2015, les 193 États membres de l’Organisation des Nations Unies, y compris le Canada, ont adopté 17 objectifs de développement durable. Basé sur un horizon de 15 ans, le plan vise à « éliminer la pauvreté, protéger la planète et améliorer la qualité de vie de toutes les personnes partout dans le monde1 ». L’élimination de la pauvreté est placée au premier plan compte tenu de la grande vulnérabilité qu’elle génère, surtout en temps de crise comme la pandémie à laquelle nous sommes confrontés en ce moment.
Étant donné cette période de vulnérabilité accrue, il est d’autant plus important de surveiller l’évolution de la situation économique et du bien-être des familles les plus démunies. Que l’on pense aux familles autochtones, immigrantes, monoparentales ou à tout autre type de familles sujettes à la pauvreté, l’analyse de données régulièrement mises à jour est essentielle pour suivre l’évolution de la situation. Ainsi, nos décideurs publics pourront mettre en œuvre des politiques et des programmes efficaces afin de réduire la pauvreté, et ce, même en période de crise.
Un peu plus de six semaines après l’instauration de mesures de distanciation sociale au pays, nous vous proposons aujourd’hui de poser un regard tout particulier sur les familles immigrantes. Selon les données du Recensement de 2016, chez les immigrants, qui constituent l’un des groupes les plus économiquement vulnérables au pays, près de 1 enfant sur 3 (32,2 %) vit alors sous le seuil de la pauvreté2. Quelles sont les difficultés économiques auxquelles ces familles sont actuellement confrontées?
Trois immigrants sur 10 ont de la difficulté à s’acquitter de leurs obligations financières immédiates
En période de pandémie, l’ensemble de la population peut être affecté par des pertes financières, et ce, nonobstant le degré de vulnérabilité économique préalable de chacun. C’est d’ailleurs ce que démontrent les données recueillies par un récent sondage réalisé sur six semaines par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger3.
Qu’elles aient ou non un statut d’immigrant, près de 4 à 5 personnes sur 10 ont déclaré avoir subi des pertes de revenus à cause de la pandémie. Les immigrants étaient toutefois davantage représentés au sein de la population chez qui cette perte de revenus avait causé des difficultés à s’acquitter des obligations financières à court terme (figure 1). Dans les premières semaines suivant la mise en œuvre des mesures de distanciation sociale, près de 3 immigrants sur 10 (29 %) affirmaient avoir de la difficulté à payer leur loyer ou leur hypothèque à cause de la crise, soit près de 1 personne sur 10 de plus que chez les personnes nées au Canada (20 %). Il s’agit d’un écart qui semble vouloir perdurer au fil des semaines.
De plus, les immigrants étaient proportionnellement plus nombreux que les personnes nées au Canada à éprouver d’autres difficultés d’ordre financier à court terme, comme payer leurs comptes dans les délais prescrits. Ces indicateurs de stress financier rendent la population immigrante d’autant plus vulnérable qu’ils témoignent d’une difficulté à subvenir à leurs besoins essentiels de base, comme avoir un toit pour se loger et accéder aux services publics qui y sont associés, soit le minimum requis pour leur bien-être et celui de leur famille.
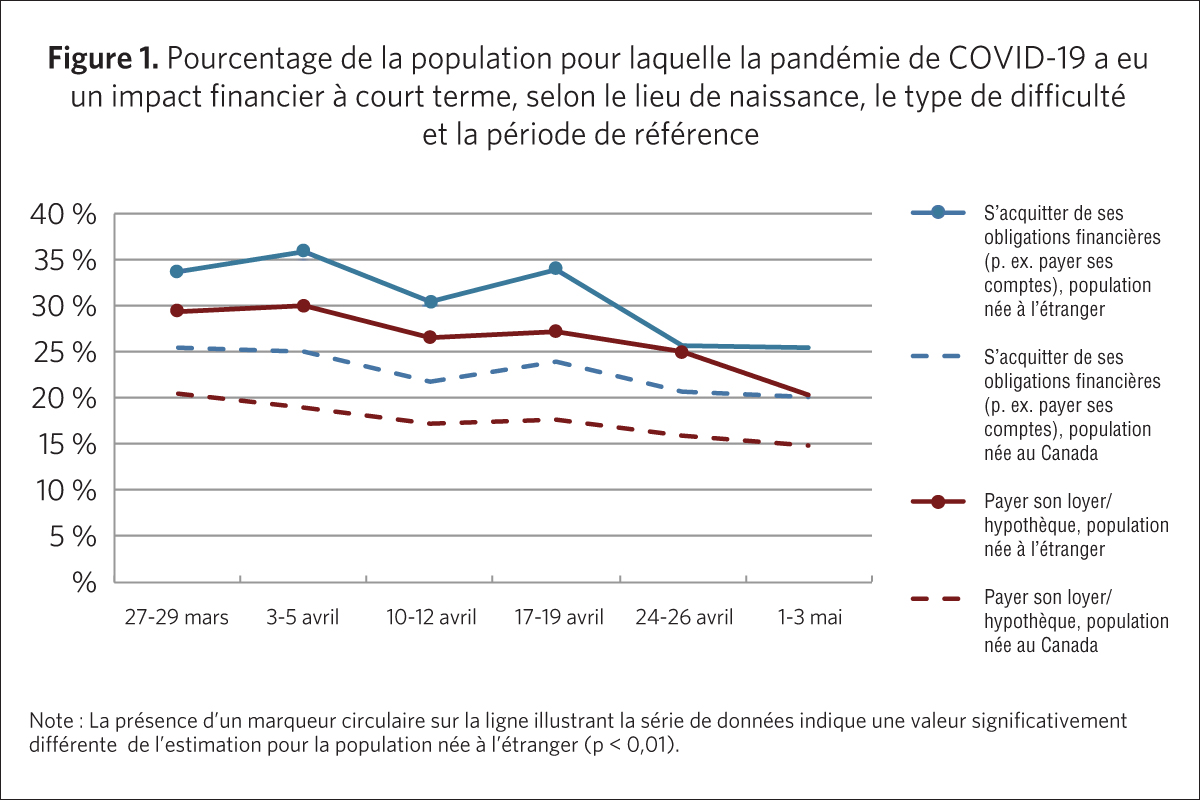
Plus de 1 parent immigrant sur 2 a subi une perte de revenus
Si on regarde plus en détail l’impact économique de la crise sur les familles immigrantes, on remarque que les effets négatifs ont été immédiats (figure 2). Dès la fin de mars, plus de 1 parent immigrant sur 2 affirmait avoir subi une perte de revenus à cause de la pandémie, une perte qui a eu pour effet de réduire sa capacité à venir en aide financièrement aux autres membres de sa famille. Ce soutien aurait pu non seulement s’avérer encore plus utile durant cette période difficile, mais cette incapacité à aider ses proches a pu avoir un effet boule de neige au sein des communautés ethniques les plus vulnérables économiquement.
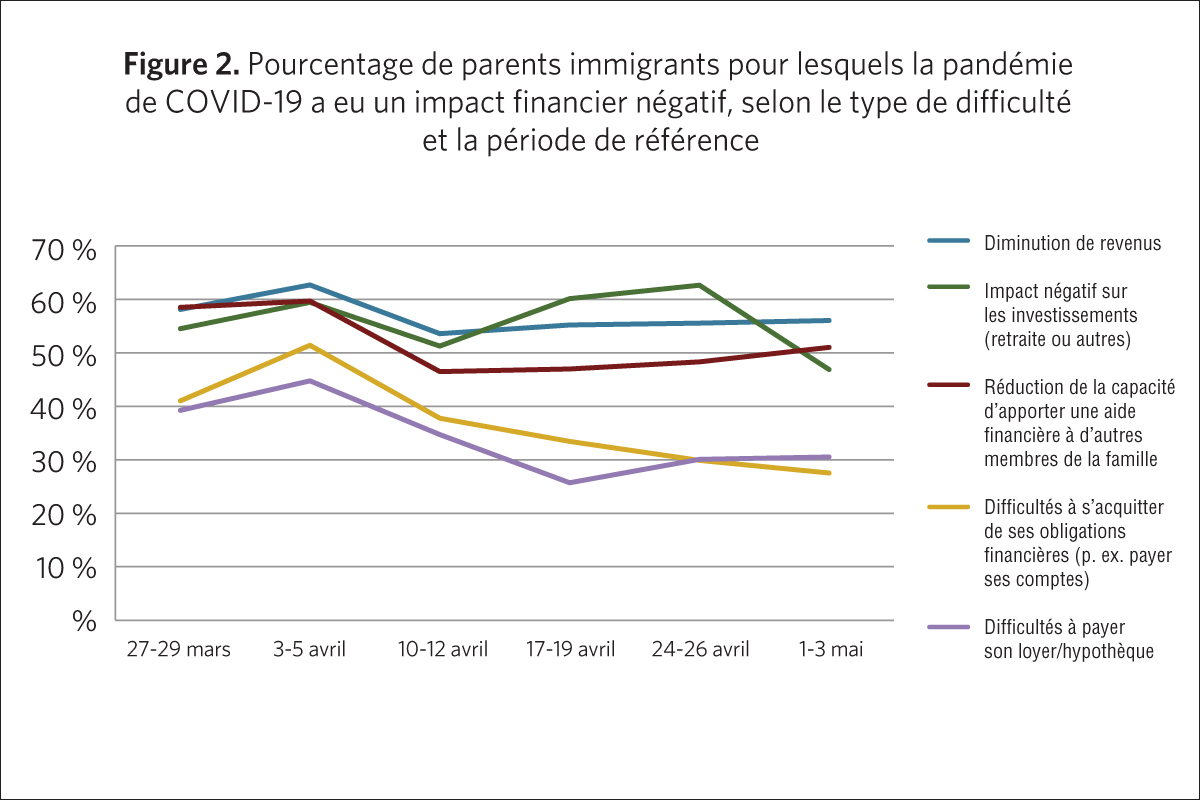
Tendances à la baisse des parents immigrants ayant des difficultés financières immédiates
Sur une note plus positive, les tendances observées depuis les dernières semaines semblent démontrer une baisse de la proportion de parents immigrants subissant des impacts financiers immédiats. Après avoir atteint un sommet durant la première semaine d’avril, les proportions de parents immigrants connaissant des difficultés à payer leur loyer ou leur hypothèque, ou ayant de la difficulté à s’acquitter de leurs autres obligations financières, ont diminué de plus de 15 points de pourcentage au cours des quatre semaines suivantes. S’il est actuellement trop tôt pour déterminer précisément ce qui a pu causer ces diminutions, de tels résultats portent à croire que l’adaptation des entreprises en vue de continuer à maintenir leurs services malgré les règles de distanciation, ainsi que les mesures financières mises en place par les gouvernements ont pu contribuer à réduire la vulnérabilité économique des familles immigrantes dans l’immédiat.
Les parents immigrants financièrement vulnérables se rendent plus souvent à l’épicerie
Au-delà des impacts financiers directs, la vulnérabilité économique peut aussi limiter la possibilité d’adopter certains comportements favorisant une bonne santé. Par exemple, certains parents de familles immigrantes pourraient être tenus de choisir entre les besoins essentiels de leur famille et les ressources dont ils disposent pour réduire leur exposition à la COVID-19. De plus, il est possible que certaines familles économiquement vulnérables ne disposent d’aucune carte de crédit leur permettant de faire leurs achats en ligne, qu’elles ne puissent se permettre de payer le montant excédentaire demandé par les épiceries pour la livraison ou l’emballage des articles, ou encore qu’elles ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour faire des provisions pour plusieurs jours. Sans compter qu’il pourrait s’avérer plus difficile pour les personnes ne possédant pas de voiture de transporter une grande quantité de provisions à pied ou dans les transports en commun.
Ces contraintes pourraient expliquer pourquoi deux fois plus de parents immigrants ayant des difficultés financières immédiates (46 %) sont allés à l’épicerie plus d’une fois dans la semaine, comparativement à leurs homologues qui n’éprouvent pas les mêmes difficultés (23 %) (figure 3). Cette exposition accrue ne semble toutefois pas s’expliquer par un manque de conscientisation puisqu’on n’observe aucune différence significative entre ces deux groupes en ce qui a trait à leur respect des autres pratiques sécuritaires, telles que la distanciation sociale et le lavage des mains fréquent.
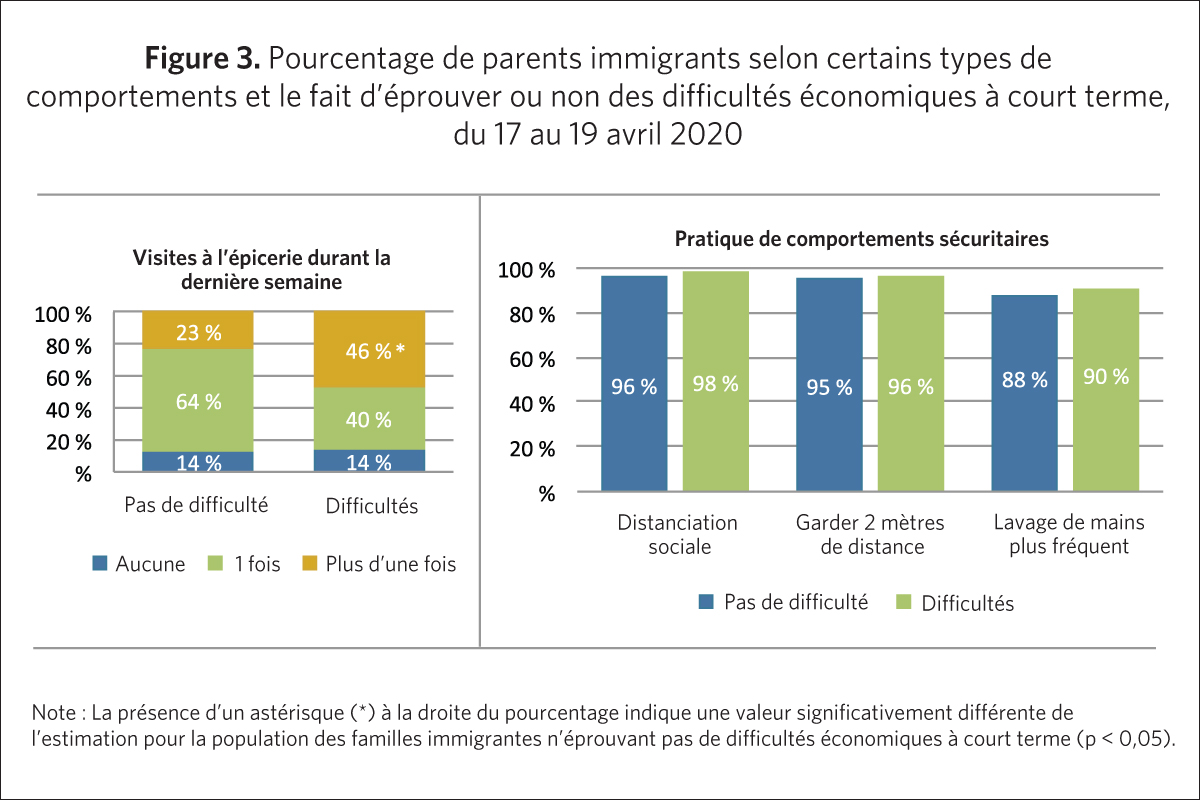
En instaurant les objectifs de développement durable en 2015, 193 États à travers le monde reconnaissaient que « les inégalités constituent une menace pour le développement économique et social4 ». Souvent qualifié de terre d’immigration, le Canada demeure néanmoins un pays où les familles immigrantes sont confrontées à un risque élevé de vulnérabilité économique. Les données récoltées depuis le début de la pandémie démontrent que ces inégalités persistent en période de crise. Les immigrants sont financièrement plus durement touchés dans l’immédiat que les personnes nées au Canada.
Six semaines de collectes de données hebdomadaires semblent toutefois témoigner d’une résilience nationale, c’est-à-dire d’une capacité à s’adapter à cette situation exceptionnelle en atténuant certains des effets négatifs. On peut donc voir d’un bon œil la tendance à la baisse de la prévalence des familles immigrantes éprouvant des difficultés à payer leur hypothèque ou leur loyer ou à remplir leurs autres obligations financières. Mais s’il y a une chose que les dernières semaines nous ont apprise, c’est que la situation change rapidement en période de pandémie. Il est donc important, plus que jamais, de surveiller la situation de près et de s’assurer d’identifier en temps opportun les besoins des familles les plus vulnérables, qu’elles soient autochtones, immigrantes, monoparentales ou autres. L’élimination de la pauvreté est un défi d’autant plus grand en période de crise.
Laetitia Martin, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Notes
- Organisation des Nations Unies, « Le programme de développement durable », dans Objectifs de développement durable. Lien : https://bit.ly/3dclcg6
- Statistique Canada, Tableaux de données, Recensement de 2016, tableau 98-400-X2016206 au catalogue de Statistique Canada. Lien : https://bit.ly/2TquwWd
- Un sondage de l’Institut Vanier de la famille, de l’Association d’études canadiennes et de la firme Léger, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril, du 10 au 12 avril, du 17 au 19 avril, du 24 au 26 avril et du 1er au 3 mai 2020, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Tous les échantillons, à l’exception de ceux du 10 au 13 mars et du 24 au 26 avril, comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
- Organisation des Nations Unies, « Égalité : pourquoi est-elle importante? », dans Objectif de développement durable 10 : Inégalités réduites. Lien : https://bit.ly/35qSzJz (PDF)
Réflexions parentales sur l’avenir postpandémie au Canada
Nadine Badets
6 mai 2020
Les restrictions relatives à la pandémie de COVID-19 ont transformé la vie des familles au Canada. En raison de la fermeture des écoles, des garderies, des restaurants et de plusieurs commerces, ainsi que des importantes pertes d’emplois et des nouvelles mesures favorisant le travail à domicile, plusieurs parents et enfants passent beaucoup plus de temps ensemble qu’auparavant.
Comment les familles conçoivent-elles la vie après la pandémie? Selon des données recueillies pendant six semaines par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger, les familles ne sont pas prêtes à renvoyer leurs enfants à l’école cette année, mais les parents sont disposés à réintégrer leur milieu de travail après la pandémie. C’est ce qu’indiquent certains résultats de cette série de sondages en cours1.
La peur du coronavirus est plus forte chez les familles qui ont des enfants
Au 6 mai 2020, les enfants et les adolescents de 19 ans et moins représentaient une faible proportion des cas de COVID‑19 au Canada (5 %)2. Toutefois, près de 30 % des adultes vivant avec des enfants et des adolescents de moins de 18 ans craignent fortement qu’un membre de leur famille immédiate contracte la COVID-19, comparativement à 22 % de ceux qui vivent sans enfant3 (figure 1).

Malgré cela, plus de la moitié des adultes vivant avec des enfants (56 %) affirment qu’ils appuieraient une politique gouvernementale visant à assouplir les restrictions de distanciation sociale (physique) pour toutes les personnes de moins de 65 ans, alors que 42 % des personnes vivant sans enfant appuieraient une telle politique.
La plupart des parents ne veulent pas que leurs enfants suivent des cours d’été pour rattraper le retard
Plus de 80 % des parents vivent avec leurs enfants pendant la pandémie, et 7 % partagent la garde de leurs enfants avec un parent vivant au sein d’un autre ménage. Six parents sur 10 (60 %) déclarent qu’ils discutent davantage avec leurs enfants actuellement qu’ils ne le faisaient avant le confinement. Les parents d’enfants d’âge scolaire explorent également le système éducatif avec leurs enfants en tant que nouveaux enseignants, tuteurs et aides aux devoirs. L’éducation à domicile est difficile pour plusieurs familles4, en plus de susciter des inquiétudes à l’égard du retard que prennent les élèves.
La plupart des provinces n’ont pas encore annoncé leur intention de rouvrir les écoles, et les trois territoires ont confirmé qu’ils comptaient maintenir les écoles fermées jusqu’en septembre. Toutefois, le Québec s’est engagé à rouvrir la plupart des écoles primaires le 11 mai et, en date du 29 avril 2020, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse ont prévu des dates d’ouverture provisoires plus près du mois de juin, mais leurs dates butoirs changent constamment5. Lorsqu’on les a interrogés à cet égard, les deux tiers (66 %) des parents ont affirmé que, même si les écoles au Canada ouvrent avant la fin de juin, ils préfèrent que leurs enfants ne retournent en classe qu’en septembre, plutôt que d’aller à l’école durant l’été (en juillet et en août) en vue de rattraper le temps perdu.
Plus de la moitié des parents sont disposés à retourner au travail, mais ils ne veulent pas utiliser les transports en commun
La pandémie de COVID-19 a engendré d’innombrables pertes d’emplois à l’échelle du pays6, et les parents vivant avec des enfants qui considèrent la crise sanitaire comme une « menace importante » pour leur emploi sont plus susceptibles d’affirmer se sentir tristes, anxieux ou nerveux, par rapport aux personnes vivant sans enfant7.
Parmi les personnes qui ont conservé leur emploi, celles qui vivent avec des enfants sont plus susceptibles de se déclarer satisfaites des mesures instaurées par leur employeur afin de réagir à la COVID‑19 (59 %) que les personnes sans enfant (37 %). Cet écart peut s’expliquer par le fait que la situation permet aux parents de travailler à domicile tout en s’occupant de leurs enfants, les garderies et les écoles étant fermées. Environ 55 % des adultes vivant avec des enfants déclarent travailler actuellement à domicile (figure 2). Les personnes vivant avec des enfants sont également plus susceptibles (54 %) que les personnes sans enfant (37 %) d’affirmer qu’elles seraient à l’aise de réintégrer leur milieu de travail une fois les restrictions liées à la COVID‑19 levées.
Cependant, plus de 60 % des parents ont affirmé qu’ils ne seraient pas à l’aise d’emprunter les transports en commun, et ce, même lorsque les restrictions liées à la COVID‑19 commenceront à être assouplies, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les déplacements lorsque les gens se rendront à leur lieu de travail (figure 3). Les adultes vivant avec des enfants sont plus susceptibles de dire qu’ils préféreraient se rendre au travail seulement lorsque c’est nécessaire (39 %) que les personnes sans enfant (27 %).
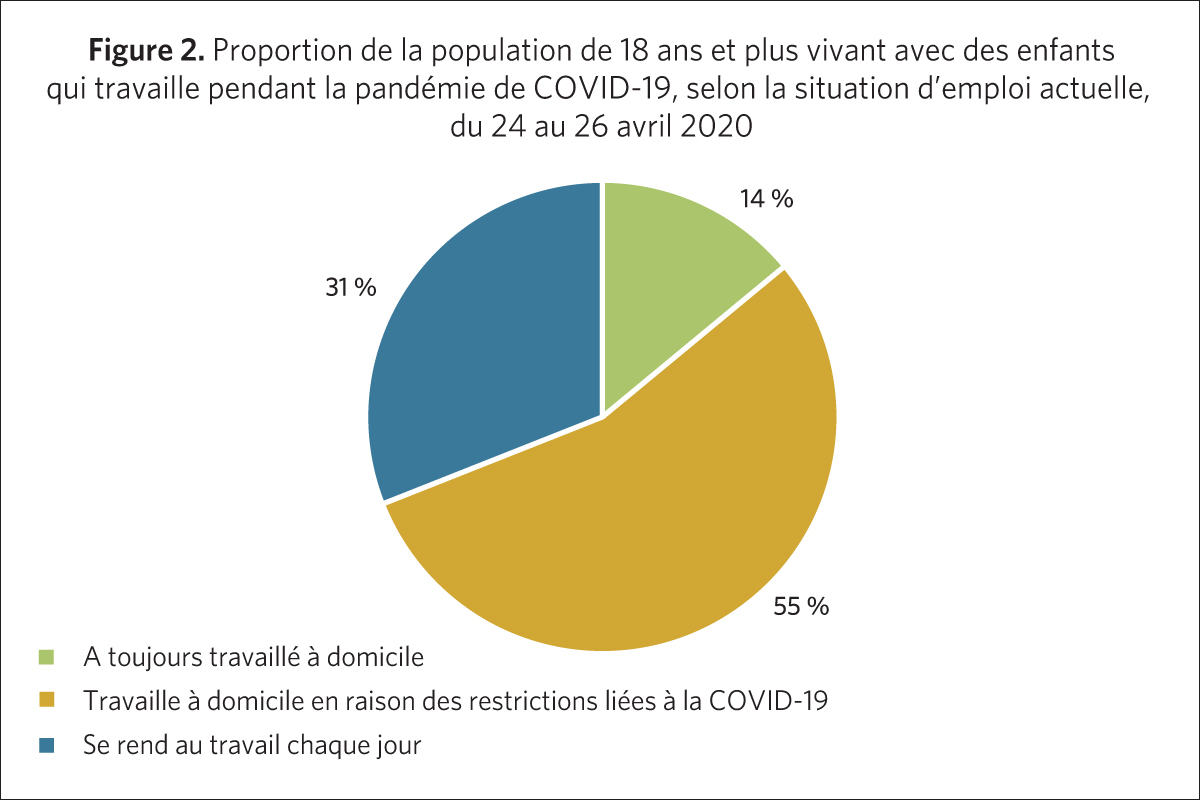
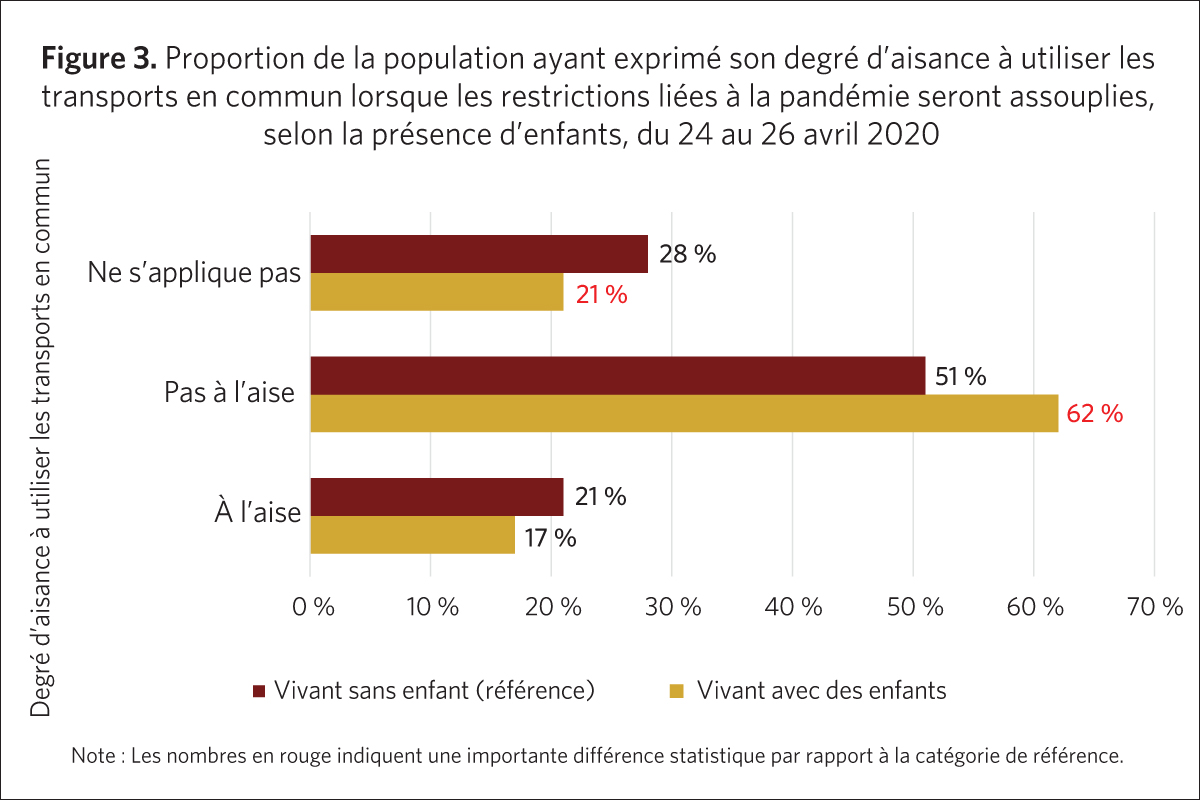
Les parents abandonnent leurs projets de vacances, la plupart ne voyageront pas en 2020
En plus d’exprimer leur malaise à l’égard des transports en commun, les parents ne se disent pas moins préoccupés par rapport aux voyages. Environ 6 adultes sur 10 (59 %) vivant avec des enfants ont indiqué avoir dû modifier leurs projets de vacances en raison de la pandémie de coronavirus de 2020, probablement en lien avec le confinement au Canada et la fermeture des frontières autour de la semaine de relâche. Lorsqu’on leur a demandé s’ils comptaient prendre des vacances en 2020, 72 % des parents ont répondu que c’était peu probable.
Nadine Badets, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Notes
- Un sondage de l’Institut Vanier de la famille, de l’Association d’études canadiennes et de la firme Léger, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril, du 10 au 12 avril, du 17 au 19 avril et du 24 au 26 avril 2020, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Tous les échantillons, à l’exception de ceux du 10 au 13 mars et du 24 au 26 avril, comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
- Agence de la santé publique du Canada, Maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) : Mise à jour quotidienne sur l’épidémiologie (consulté le 6 mai 2020). Lien : https://bit.ly/2z9rMFJ
- Voir la note 1.
- Jessica Wong, « Frustrated Parents in Ontario Pivot from Official Distance-Learning Program Amid COVID-19 », CBC News (30 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3aTOMFR
- CBC Kids News, When Will Your School Reopen? Check Out This Map (29 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2KMhcGW
- Statistique Canada, « Enquête sur la population active, mars 2020 » dans Le Quotidien (9 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2YDGkIm
- Jennifer Kaddatz, « Les familles peinent à composer avec les conséquences financières de la pandémie de COVID‑19 », Institut Vanier de la famille (9 avril 2020).
Quelle est votre « famille élargie et choisie » en cette crise de COVID-19?
Jennifer Kaddatz
1er mai 2020
Il y a près de huit ans déjà, ma famille quittait la Colombie-Britannique afin que je puisse venir travailler à Ottawa. Pour moi, c’est encore comme si c’était hier. Ce déménagement a été un changement de vie important, avec son lot d’inquiétudes. La séparation que nous imposions alors à nos trois jeunes garçons nous a beaucoup bouleversés, alors qu’ils se voyaient arrachés à leurs grands-parents et leur tante habitant sur la côte ouest. Les autres membres de notre relativement petite famille élargie sont répartis dans trois pays, la majorité d’entre eux résidant dans le Pacifique Sud, alors il ne restait plus de petits-enfants à câliner en Colombie-Britannique.
Mon mari et moi avons dû nous débrouiller seuls après notre déménagement en Ontario, mais nous sommes maintenant bien installés, après huit merveilleuses années. Au cours de cette période, nous avons développé des relations privilégiées avec nos nouveaux voisins, et bien que cela ne puisse remplacer la famille, nos relations avec ceux-ci nous sont fort précieuses.
Toujours prévoir où se réfugier en cas d’apocalypse de zombies
Moins d’un an après notre arrivée à Ottawa, ma famille et moi nous étions faits de nouveaux amis extraordinaires – des adultes et des enfants que nous avons rencontrés grâce à notre implication dans l’organisme Scouts Canada. Ces amis – notre « famille choisie » – sont désormais les personnes avec qui notre famille célèbre chacune des fêtes ou des occasions spéciales, comme Noël, le Nouvel An, Pâques, la Saint-Patrick, la fête de la Reine, la fête du Canada, la fête du Travail et l’Action de grâces, ainsi que les divers anniversaires qui ponctuent ce récit.
Ce sont les amis avec lesquels on se divertit, on fait bouillir du sirop d’érable et on vit de nouvelles aventures (On joue au « lancer de la hache »? On se fait un karaoké?) et avec qui l’on passe nos vacances d’été. Nous connaissons les familles biologiques élargies de chacun, nos enfants ont grandi ensemble (comme des frères et sœurs ou des cousins) et nous avons tous vu le petit dernier se départir de sa graisse de bébé et de ses couches, et l’aîné obtenir son permis de conduire et s’engager dans une relation sérieuse avec une fille.
Ces trois familles sont les amis avec lesquels nous avons toujours dit à la blague que nous ferions équipe advenant une apocalypse de zombies. Or, c’est plutôt une apocalypse de COVID‑19 qui nous attendait, mais au moins nous étions prêts! Besoin de papier toilette ou de farine? Quelqu’un en apportera. Besoin d’un sourire? Quelqu’un nous fera rire. En pleine pandémie, les garçons sont en contact avec les autres pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, échangeant en ligne aussi bien lorsqu’ils font leurs devoirs que lorsqu’ils s’adonnent à des jeux vidéo.
- Quelque 90 % des adultes au Canada disent avoir autour d’eux des personnes sur lesquelles ils peuvent compter en cas d’urgence1.
- Chez 44 % des Canadiens, l’une des principales précautions prises en réponse à la situation de COVID‑19 a été d’établir un plan de communication avec la famille, les amis et les voisins2.
Rapprochez-vous de vos voisins – en restant bien sûr à plus de deux mètres
Mais ces trois familles ne constituent pas ma seule communauté locale. Je pense que j’ai les voisins les plus géniaux de la planète. Mon quartier quelque peu rural s’est transformé assez rapidement, passant d’un endroit où la plupart des « enfants » étaient dans la jeune vingtaine, à un voisinage où une maison et une cour sur deux accueillent aujourd’hui les cris et l’énergie d’en moyenne trois enfants et jeunes, dont la plupart ont moins de 12 ans. L’hiver, nous allons ensemble patiner. Chaque année, nous organisons une chasse aux œufs de Pâques, des feux de camp, des randonnées à vélo. Nous avons aussi instauré un système informel d’alerte « tiques et animaux sauvages » ainsi qu’un club de partage de semences de légumes, sans oublier que nous formons un groupe diversifié de mères et de pères incroyablement travailleurs, compatissants, généreux et, ne l’oublions pas, vraiment fatigués.
Lorsque j’ai suivi mon traitement contre le cancer au début de l’année, ce sont ces voisins qui ont pris soin de moi, en s’assurant que ma famille avait tout ce dont elle avait besoin, y compris certains des repas faits maison les plus délicieux jamais partagés. Ce matin, pour déjeuner, j’ai eu droit à un pain fraîchement cuit par l’une de mes voisines qui travaille dans le secteur de la santé, souhaitant me remercier de lui avoir fabriqué des équipements de protection individuelle pendant la pandémie.
- Près des trois quarts (74 %) des Canadiens se sentent très attachés (35 %) ou assez attachés (39 %) à leur voisinage3.
- Quatre personnes sur cinq (80 %) au Canada affirment que leurs voisins suivent rigoureusement (29 %) ou assez rigoureusement (51 %) les conseils des autorités de santé publique concernant la distanciation physique4.
Rester en contact avec la famille et les amis grâce à la technologie
Grâce à la technologie, ma communauté ne s’arrête pas à la frontière de l’Ontario. J’ai grandi dans un village d’agriculteurs et de pêcheurs où la mascotte de l’école secondaire était un cheval et où la rue principale était ornée de buissons de mûres. Ce genre d’enfance est favorable à la création de liens durables et mes meilleures amies d’enfance sont toujours près de moi aujourd’hui. En cette pandémie de COVID‑19, nous échangeons tous les jours des textos et discutons par le biais des diverses plateformes de médias sociaux, même si elles vivent loin de moi, à l’Ouest, sous les cerisiers en fleurs, alors qu’ici, dans l’Est du Canada, le temps est encore aux frissons.
Ces femmes magnifiques me font rire, me donnent de l’espoir et m’incitent même à faire de l’exercice. C’est avec elles que j’échange lorsque j’ai besoin d’une épaule sur laquelle m’appuyer. Nous subissons toutes divers aspects ou effets de la pandémie, et quoique ceux-ci nous touchent de manières différentes, nous sommes toujours là les unes pour les autres, quoi qu’il arrive.
- Depuis le début de la pandémie de COVID‑19, 41 % des personnes au Canada passent davantage de temps sur les médias sociaux5.
- Quelque 88 % des adultes au Canada sont très attachés ou assez attachés à leurs amis, une proportion tout juste inférieure aux 93 % d’adultes étant très attachés ou assez attachés à leur famille6.
Mais ce n’est pas uniquement pour le plaisir et les jeux
Pour moi, rester en contact avec mes meilleures amies de toujours, mes amis lanceurs de hache d’Ottawa et mes extraordinaires voisins (comme nous exténués) ne consiste pas seulement à passer du bon temps. Ce cercle restreint de personnes forme ma « famille extra élargie » et mes relations avec celles-ci me sont essentielles pour préserver une bonne santé mentale. En période de crise, comme dans le cas de la pandémie de COVID‑19, ils sont ma bouée de sauvetage.
- La moitié (50 %) des Canadiens affirment que leur santé mentale s’est détériorée en cette période de COVID‑19, et 1 sur 10 (10 % dans l’ensemble) disent qu’elle s’est détériorée de façon importante7.
- Lorsqu’on leur demande de décrire, de façon générale, comment ils se sentent depuis les dernières semaines, les Canadiens affirment surtout être inquiets (44 %) et anxieux (41 %) et disent s’ennuyer (30 %), alors que plus du tiers (34 %) se sentent plutôt reconnaissants8.
Vers qui d’autre se tourner pour obtenir de l’aide?
Le gouvernement canadien a reconnu que la COVID-19 pouvait entraîner du stress, à divers degrés, chez les nombreuses personnes qui n’ont pas facilement accès à ce réseau social, à cette communauté et à ce voisinage pour lesquels je suis si reconnaissante.
Il a ainsi mis sur pied la plateforme Espace mieux-être Canada, qui propose une série d’outils offrant différents niveaux de soutien en fonction des besoins9. Elle offre en outre la possibilité de discuter avec des travailleurs qui participent au programme de soutien par les pairs et d’autres professionnels.
Rendez-vous sur le site Espace mieux-être Canada pour communiquer avec d’autres personnes dans les moments difficiles.
Jennifer Kaddatz, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Notes
- Un sondage de l’Institut Vanier de la famille, de l’Association d’études canadiennes et de la firme Léger, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril, du 10 au 12 avril et du 17 au 19 avril 2020, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Tous les échantillons, à l’exception de celui du 10 au 13 mars, comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
- Statistique Canada, « Comment les Canadiens vivent-ils la situation liée à la COVID-19? » dans Infographies (8 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3aOn90O
- Sondage de l’Institut Vanier de la famille, de l’Association d’études canadiennes et de la firme Léger, mené du 17 au 19 avril (voir la note 1).
- Entre les 14 et 17 mars 2020, Nanos a mené un sondage aléatoire hybride par téléphone et en ligne à double base d’échantillonnage (lignes terrestres et cellulaires par composition aléatoire) auprès de 1 013 Canadiens de 18 ans et plus. La marge d’erreur pour ce sondage est de ±3,1 points de pourcentage, et ce, 19 fois sur 20.
- Sondage de l’Institut Vanier de la famille, de l’Association d’études canadiennes et de la firme Léger, mené du 10 au 12 avril (voir la note 1).
- Sondage de l’Institut Vanier de la famille, de l’Association d’études canadiennes et de la firme Léger, mené du 17 au 19 avril (voir la note 1).
- Angus Reid Institute, Worry, Gratitude & Boredom: As COVID-19 Affects Mental, Financial Health, Who Fares Better; Who Is Worse? (27 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3eWWzGd
- Ibidem
- Santé Canada, Le gouvernement du Canada aide les Canadiens à accéder à des services favorisant le mieux-être mental pendant la pandémie de COVID‑19 (15 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2yWslCl
Les familles au Canada expriment une « vive préoccupation » à l’égard de la santé et du bien-être des aînés durant la pandémie de COVID‑19
Nadine Badets et Ana Fostik, Ph. D.
30 avril 2020
L’Agence de la santé publique du Canada considère que les personnes plus âgées sont particulièrement vulnérables à la COVID‑19, qui les expose à un risque élevé de maladie grave et de décès1. En 2019, 9,1 millions de Canadiens étaient âgés de 60 ans et plus, ce qui correspond environ au quart de l’ensemble de la population2.
Au 27 avril 2020, environ 37 % des cas confirmés de COVID‑19 au Canada avaient été diagnostiqués chez des adultes âgés de 60 ans et plus, et ce groupe d’âge représentait plus de la moitié (56 %) de tous les cas de coronavirus avec pneumonie. Les adultes de 60 ans et plus affichaient les plus fortes proportions de conséquences graves, soit 66 % des hospitalisations, 63 % des admissions aux unités de soins intensifs et 95 % des décès déclarés liés à la COVID‑193.
La forte sensibilité des personnes plus âgées au virus a engendré un niveau de stress accru chez les aînés, leur famille et leurs aidants alors qu’ils sont confrontés à la pandémie de COVID‑19.
Faits et statistiques clés :
- Environ 37 % des cas confirmés de COVID‑19 au Canada ont été diagnostiqués chez les adultes de 60 ans et plus (27 avril 2020).
- Les adultes de 60 ans et plus représentaient 66 % des hospitalisations, 63 % des admissions aux unités de soins intensifs et 95 % des décès déclarés en lien avec la COVID‑19 (27 avril 2020).
- Chez les adultes de 18 ans et plus, 70 % ont affirmé avoir assez ou très peur qu’un membre de leur famille immédiate contracte la COVID‑19 (27 avril 2020).
- Parmi les adultes, 15 % ont indiqué que certains de leurs proches âgés vivent actuellement dans des CHSLD ou des établissements de soins de longue durée, et 85 % d’entre eux se disent préoccupés par la santé de ces membres de leur famille (27 avril 2020).
- Près de 8 décès sur 10 (79 %) liés au coronavirus au Canada sont survenus dans des CHSLD et des établissements de soins de longue durée (28 avril 2020).
Les familles comptant des proches aînés vivant en CHSLD sont les plus préoccupées
Dans le cadre d’un sondage mené du 17 au 19 avril 2020 par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger, près de 70 % des adultes de 18 ans et plus ont affirmé avoir assez ou très peur qu’un membre de leur famille immédiate contracte la COVID‑194. Pour remettre les choses en perspective, Statistique Canada révélait en 2018 qu’environ 7,8 millions d’adultes de 15 ans et plus prenaient soin d’un membre de la famille ou d’un ami5, et que près de 4 bénéficiaires de soins sur 10 au Canada en 2018 étaient âgés de 65 ans et plus6.
Pendant la pandémie de COVID‑19, 11 % des adultes ont déclaré qu’au moins un proche aîné vivait avec eux7. Près de 47 % ont indiqué que les aînés de leur famille habitaient séparément dans leur propre maison, et 15 % ont affirmé que certains de leurs proches aînés vivaient actuellement dans des CHSLD ou des établissements de soins de longue durée.
La plupart des adultes (85 %) dont les proches aînés vivent dans des établissements de soins se disent préoccupés par la santé de ces membres de leur famille, alors qu’une proportion légèrement plus faible d’adultes vivant avec des aînés (77 %), ou dont les membres âgés de la famille vivent dans une maison séparée (72 %), ont exprimé leur inquiétude à l’égard de la santé de ces aînés.
Les aînés vivant dans des établissements de soins de longue durée peinent à s’adapter aux restrictions liées à la pandémie
La dévastation causée par la pandémie de coronavirus s’est produite en grande partie dans les CHSLD et les établissements de soins de longue durée. La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a annoncé à la mi-avril 2020 qu’environ la moitié des décès dus à la COVID‑19 au Canada était liée à des éclosions dans des établissements de soins de longue durée pour aînés8, et qu’en date du 28 avril 2020, près de 8 décès sur 10 (79 %) liés au coronavirus au Canada étaient survenus dans des CHSLD et des établissements de soins de longue durée9.
Près de 61 % des proches ont affirmé se sentir assez ou très inquiets à propos de la qualité des soins offerts aux aînés dans les CHSLD et les établissements de soins de longue durée. Par ailleurs, près des deux tiers (63 %) des adultes dont des proches aînés vivent dans des établissements de soins de longue durée croient que ces membres de leur famille éprouvent assez ou beaucoup de difficulté à s’adapter aux restrictions liées à la COVID‑19, comme celle les obligeant à rester dans leur chambre sans pouvoir recevoir de visiteurs ou entrer en contact avec d’autres personnes. Environ 12 % sont incertains quant à la réaction de leurs proches à l’égard de ces restrictions.
Nadine Badets, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Ana Fostik, Ph. D., Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Notes
- Agence de la santé publique du Canada, Personnes susceptibles d’être gravement malades si elles contractent la COVID‑19 (20 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3eZIqI2
- Statistique Canada. Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe (tableau 17-10-0005-01). Lien : https://bit.ly/2xlmw18
- Agence de la santé publique du Canada, Maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) : Mise à jour quotidienne sur l’épidémiologie (29 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2VLV7ik
- Un sondage de l’Institut Vanier de la famille, de l’Association d’études canadiennes et de la firme Léger, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril, du 10 au 12 avril et du 17 au 19 avril 2020, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Tous les échantillons, à l’exception de celui du 10 au 13 mars, comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
- Statistique Canada, « Les aidants au Canada, 2018 » dans Le Quotidien (8 janvier 2020). Lien : https://bit.ly/2yRDWCP
- Statistique Canada, « Les soins en chiffres : Les bénéficiaires de soins au Canada, 2018 » dans Infographies, no 11‑627‑M au catalogue de Statistique Canada (22 janvier 2020). Lien : https://bit.ly/2Siz40t
- Sondage mené du 17 au 19 avril par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger (voir note 4).
- Olivia Bowden, « Long-term care homes with the most coronavirus deaths in Canada » dans Global News (17 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2Y2Lihn
- Beatrice Britneff et Amanda Connolly, « Coronavirus Spread Slowing in Canada; Death Rate Rises Due to Long-Term Care Fatalities » dans Global News (28 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2xlWjQ4
Les habitudes en matière de santé pendant la pandémie de COVID-19
Jennifer Kaddatz et Nadine Badets
27 avril 2020
Au Canada, le confinement lié à la pandémie de COVID-19 a infligé de lourdes restrictions aux personnes et aux entreprises, ce qui a engendré des changements dans la pratique de nombreuses activités courantes, comme la préparation et la consommation d’aliments, les achats, l’exercice physique et le temps passé à l’extérieur. La santé des adultes au Canada est en pleine métamorphose, non seulement à cause du virus, mais aussi en raison des habitudes en matière de santé déjà instaurées ou nouvellement adoptées.
Depuis le début de cette période d’isolement social, les adultes consacrent plus de temps à préparer des repas et à boire de l’alcool à la maison, mais ils passent moins de temps à faire de l’exercice et à aller dehors, selon des données recueillies dans un récent sondage réalisé sur quatre semaines par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger1 ainsi que d’autres sources de données portant sur la pandémie.
Il sera important de suivre l’évolution de ces habitudes pendant toute la durée de la pandémie, compte tenu des conséquences potentielles qu’elles peuvent avoir sur la santé physique et mentale des familles dans l’ensemble du pays.
Environ 4 adultes sur 10 consacrent plus de temps à préparer des repas à la maison
Une alimentation saine est primordiale pour avoir une bonne santé : elle constitue un facteur essentiel au développement optimal de l’humain en plus d’être importante pour réduire le risque associé à plusieurs maladies chroniques. Le fait de préparer et de cuisiner de la nourriture à la maison permet à la fois de diminuer la quantité de sodium, de sucre et de graisses saturées qui se retrouvent dans nos repas, mais aussi d’augmenter notre consommation de légumes, de fruits, de grains entiers et de protéines végétales. Par conséquent, manger ou commander des mets qui viennent de l’extérieur peut avoir un impact négatif sur notre santé, car il est possible que les mets soient plus fortement transformés, et qu’ils contiennent moins de légumes, de fruits et de grains entiers2.
Il était donc prévisible qu’au cours de l’isolement relié à la COVID-19, les Canadiens soient plus nombreux à manger des repas faits maison. En effet, 41 % des adultes disent consacrer actuellement plus de temps à préparer des repas qu’ils ne le faisaient avant la pandémie, selon des données recueillies du 9 au 12 avril (figure 1). Les femmes, en particulier, semblent passer plus de temps dans la cuisine, alors que 44 % d’entre elles indiquent préparer des repas « plus souvent », contre 38 % des hommes. Notamment, près de la moitié des femmes (48 %) de 35 à 54 ans consacrent plus de temps à préparer des repas, ce qui est le cas de 44 % des hommes de ce groupe d’âge.

Par ailleurs, une plus faible proportion de femmes (18 %) que d’hommes (24 %) ont commandé des mets pour emporter d’un restaurant dans la semaine précédant le sondage du 9 au 12 avril, bien que les femmes sont presque aussi susceptibles (18 % c. 16 %) que leurs homologues masculins de se faire livrer de la nourriture à la maison ou au travail (figures 2 et 3). Les jeunes hommes de 18 à 34 ans sont plus susceptibles d’avoir commandé des mets pour emporter (24 %) au cours de la semaine précédente, alors que les jeunes femmes de 18 à 34 ans constituent l’association sexe-groupe d’âge le plus susceptible de se faire livrer de la nourriture (27 %).


Un adulte sur 5 boit plus d’alcool à la maison
L’alcool peut avoir d’importantes conséquences sur la santé physique et mentale si on le consomme en grande quantité, ce qui peut aggraver les problèmes de santé mentale actuels, augmenter le risque de blessure ou de maladie aigüe à court terme et accroître le risque de maladies graves à long terme, comme les maladies du foie et certains cancers3. Par conséquent, si la consommation d’alcool augmente pendant la crise du coronavirus, on pourrait observer, suivant la pandémie, d’importantes répercussions sur la santé des personnes et de leur famille ainsi que sur le système de santé au Canada.
Un sondage mené par Statistique Canada du 29 mars au 3 avril a révélé que 20 % des Canadiens de 15 à 49 ans boivent davantage d’alcool à la maison pendant la pandémie de COVID-19 qu’ils ne le faisaient avant qu’elle débute4. D’ailleurs, un autre sondage mené du 30 mars au 2 avril par Nanos pour le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances a permis de constater que 21 % des adultes de 18 à 34 ans et 25 % de ceux de 35 à 54 ans s’étaient mis à consommer davantage à la maison depuis le début de la crise de COVID-195.
Les répondants du sondage Nanos ayant déclaré rester davantage à la maison et boire plus d’alcool ont indiqué que leur consommation avait principalement augmenté en raison de l’absence d’horaire régulier (51 %), ainsi qu’en réaction à l’ennui (49 %), au stress (44 %) ou à la solitude (19 %).
Selon des données recueillies du 9 au 12 avril par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger, 14 % des adultes se sont rendus dans un magasin de vins et spiritueux au cours de la semaine précédente, les hommes (18 %) l’ayant fait davantage que les femmes (11 %).
Près de 4 adultes sur 10 font moins souvent d’exercice
Si le fait d’être confinés à la maison semble avoir augmenté la quantité d’alcool que les adultes consomment, il ne semble pas avoir eu le même impact sur la quantité d’exercices physiques qu’ils pratiquent.
Au contraire, près de 4 femmes sur 10 (38 %) et 33 % des hommes affirment, comme le montrent les données recueillies du 9 au 12 avril, qu’ils font actuellement « moins souvent » de l’exercice qu’ils n’en faisaient avant la pandémie. Les Québécois (42 %) sont d’ailleurs ceux qui déclarent avoir le plus réduit leur fréquence d’exercice, comparativement aux habitants des autres provinces.
Du reste, il semble que les jeunes familles consacrent plus de temps à faire de l’exercice. Une plus grande proportion d’adultes vivant avec des enfants (23 %) disent faire plus souvent de l’exercice depuis le début de la pandémie, comparativement à ceux qui vivent sans enfant (18 %) (figure 4). Par ailleurs, près de 3 adultes sur 10 de 18 à 34 ans (28 %) affirment qu’ils font plus souvent de l’exercice depuis le début de la crise, contre 14 % des adultes de 55 ans et plus.

L’augmentation de l’anxiété liée à la COVID-19 et la diminution de l’exercice peuvent être reliées
Selon la Société canadienne de psychologie, une activité physique régulière peut réduire le stress quotidien, prévenir la dépression et les troubles de l’anxiété, en plus de s’avérer aussi efficace que les traitements psychologiques et pharmaceutiques dans les cas de dépression et d’anxiété6. D’un autre angle, il est possible qu’il soit plus difficile pour une personne souffrant de problèmes de santé mentale, comme l’anxiété et la dépression, d’adopter ou de poursuivre un programme d’exercice, plus particulièrement pendant une période inhabituelle.
En fait, les données recueillies du 9 au 12 avril révèlent que les personnes qui déclarent éprouver « très souvent » de l’anxiété ou de la nervosité depuis le début de la crise de COVID-19 sont plus susceptibles d’affirmer qu’ils font actuellement « moins souvent » de l’exercice (20 %) qu’ils n’en faisaient avant la pandémie, alors que 13 % disent en faire « aussi souvent » qu’avant le début de la crise de COVID-19.
Par comparaison, les adultes qui disent avoir ressenti « très peu » d’anxiété ou de la nervosité depuis le début de la pandémie sont plus susceptibles d’affirmer que leur fréquence d’exercice n’a pas changé depuis le début de la pandémie (24 %) que de dire qu’ils en font actuellement plus souvent (17 %) ou moins souvent (17 %).
Près de la moitié des adultes vont moins souvent à l’extérieur
Passer du temps en plein air, dans la nature, a une incidence importante sur la santé mentale et le mieux-être7. Par ailleurs, en 2016, l’Enquête sociale générale de Statistique Canada a révélé que 7 Canadiens sur 10 prenaient part à au moins une activité extérieure, ce qui démontre que le temps passé en plein air fait partie intégrante du mode de vie des Canadiens8.
Néanmoins, pendant la pandémie de COVID-19, près de la moitié des femmes (46 %) et des hommes (45 %) déclarent aller dehors moins souvent actuellement qu’ils ne le faisaient avant la crise. La proportion des personnes disant aller dehors moins souvent varie selon la province, oscillant entre un faible 39 % au Québec ainsi qu’au Manitoba et en Saskatchewan et un maximum de 49 % en Ontario.
Ce qui s’avère particulièrement intéressant, toutefois, est d’observer comment la proportion des personnes qui vont dehors moins souvent varie selon la région urbaine ou rurale de résidence. Plus de la moitié (54 %) des citadins déclarent qu’ils vont présentement dehors moins souvent qu’avant la pandémie, contre 45 % des adultes vivant en banlieue et 29 % des personnes vivant en région rurale.
À l’autre extrémité, à propos de ceux qui affirment aller dehors plus souvent, on constate qu’une plus forte proportion de femmes (25 %) que d’hommes (15 %) signalent en ressentir un effet positif.
Il sera intéressant d’observer, au moment où le printemps fera place à l’été, si les proportions de Canadiens qui vont dehors et qui font de l’exercice plus souvent augmenteront en même temps que les températures.
Jennifer Kaddatz, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Nadine Badets, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Notes
- Le sondage, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril et du 9 au 12 avril, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Les échantillons du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril et du 9 au 12 avril comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données de recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
- Santé Canada, Guide alimentaire canadien. Lien : https://bit.ly/2W54WH8
- Peter Butt, Doug Beirness, Louis Gliksman, Catherine Paradis et Tim Stockwell, L’alcool et la santé au Canada : résumé des données probantes et directives de consommation à faible risque, Ottawa (Ontario), Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies (25 novembre 2011). Lien : https://bit.ly/3eVZZZQ (PDF)
- Statistique Canada, « Comment les Canadiens vivent-ils la situation liée à la COVID-19? » dans Infographies (8 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2VBpZ4R
- Entre le 30 mars et le 2 avril 2020, Nanos a mené un sondage aléatoire hybride par téléphone et en ligne à double base d’échantillonnage (lignes terrestres et cellulaires par composition aléatoire) auprès de 1 036 Canadiens de 18 ans et plus dans le cadre d’un sondage omnibus. Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone par l’entremise d’agents réels et ont répondu à un sondage en ligne. La marge d’erreur pour ce sondage est de ±3,1 points de pourcentage, et ce, 19 fois sur 20. Cette recherche a été commandée par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances et a été menée par Nanos Research. Lien : https://bit.ly/3aybEue (PDF)
- Société canadienne de psychologie, Série « La psychologie peut vous aider » : L’activité physique, la santé mentale et la motivation (novembre 2016). Lien : https://bit.ly/3d04dxN (PDF)
- Conseil canadien des parcs, Connecter les Canadiens à la nature : un investissement dans le mieux-être de notre société (2014). Lien : https://bit.ly/33LBQBs
- Statistique Canada, Les Canadiens et le plein air (26 mars 2018). Lien : https://bit.ly/2S6HM1E
Coup d’œil sur les liens familiaux durant la pandémie de COVID‑19
Jennifer Kaddatz
24 avril 2020
Les liens familiaux sont essentiels au bien-être de la famille. Ils sont d’ailleurs souvent plus importants, plus solides et plus durables que tout autre lien que connaîtra une personne au cours de sa vie.
Les liens familiaux sont plus forts que les autres types de liens
Comme l’indique un sondage mené par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger, du 17 au 19 avril 20201, les liens familiaux occupent une place importante dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
En fait, selon les répondants, les liens familiaux sont plus forts que tout autre type d’attachement (figure 1).

Les femmes sont plus susceptibles de se dire « très attachées » à leur famille
Les femmes expriment généralement un sentiment d’attachement plus fort que les hommes, ce qui est également le cas à l’égard des liens familiaux (figure 1).
Quelque 95 % des femmes et 91 % des hommes de 18 ans ou plus se disent « très attachés » ou « assez attachés » à leur famille. Lorsque l’on considère uniquement les personnes ayant affirmé être « très attachées » à leur famille, on observe une différence encore plus marquée entre les sexes : près de 8 femmes sur 10 (79 %) déclarent être « très attachées » à leur famille, contre 7 hommes sur 10 (68 %) (figure 1).
L’attachement à sa famille augmente avec l’âge, surtout chez les hommes
Les adultes plus âgés sont particulièrement susceptibles de déclarer avoir des liens familiaux solides. Plus de 8 femmes sur 10 (84 %) et près de 8 hommes sur 10 (76 %) dans cette tranche d’âges se disaient « très attachés » à leur famille, la proportion étant plus faible chez les femmes et les hommes des tranches d’âges plus jeunes (figure 2).
Chez les hommes, la force de l’attachement augmentait avec l’âge : 60 % des 18 à 34 ans se disaient très attachés à leur famille, contre 67 % des 35 à 54 ans et 76 % des 55 ans et plus. Chez les femmes, les différences étaient moins prononcées (figure 2).

Jennifer Kaddatz, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Note
- Le sondage, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril, du 9 au 12 avril et du 17 au 19 avril 2020, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Tous les échantillons, à l’exception de celui du 10 au 13 mars, comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
Les adultes en couple ont-ils une meilleure santé mentale durant la pandémie de COVID‑19?
Ana Fostik, Ph. D., et Jennifer Kaddatz
22 avril 2020
Près de la moitié des adultes de 18 ans et plus au Canada disent se sentir « très souvent » ou « souvent » anxieux ou nerveux (47 %) ou encore tristes (45 %) depuis le début de la crise de COVID‑19, selon les données d’un sondage mené par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger, recueillies du 9 au 12 avril 20201 (figure 1).
Quatre adultes sur 10 affirment se sentir irritables (39 %) et environ le tiers disent éprouver des troubles du sommeil (35 %) et des sautes d’humeur (32 %) « très souvent » ou « souvent » depuis le début de la crise (figure 1).
Mais les adultes qui sont actuellement en couple – qu’ils soient mariés ou en union libre – sont-ils aussi susceptibles que les personnes célibataires ou séparées, divorcées ou veuves de se sentir déstabilisés?
L’anxiété ou la nervosité et la difficulté à dormir durant la pandémie ne semblent pas liées à l’état matrimonial
Les adultes vivant au sein d’un couple (48 %), les célibataires (47 %) ou les personnes séparées, divorcées ou veuves (43 %) (figure 1) sont tous, dans une proportion similaire, susceptibles d’affirmer se sentir anxieux ou nerveux très souvent ou souvent.
De même, la probabilité d’éprouver très souvent ou souvent de la difficulté à dormir est également comparable pour les personnes en couple (35 %), les adultes célibataires (36 %) et les personnes séparées, divorcées ou veuves (35 %).

Célibataires ou en couple, les femmes disent éprouver de l’anxiété et des troubles du sommeil plus fréquemment que les hommes
Des études antérieures sur la santé mentale ont révélé que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de souffrir de troubles anxieux et de dépression2. Il semble que ce soit également le cas en période de pandémie.
Les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes d’affirmer qu’elles éprouvent très souvent ou souvent de l’anxiété durant la pandémie de coronavirus : près de 6 femmes sur 10 vivant en couple (58 %) ou célibataires (59 %)3 déclarent se sentir anxieuses ou nerveuses très souvent ou souvent, comparativement à moins de 4 hommes sur 10 vivant en couple (37 %) ou célibataires (37 %) (figure 2).
En ce qui concerne les troubles de sommeil, plus de 4 femmes 10 indiquent avoir très souvent ou souvent de la difficulté à dormir depuis le début de la pandémie, qu’elles soient en couple (44 %) ou célibataires (44 %). En comparaison, ils sont moins de 3 hommes sur 10, qu’ils soient en couple (26 %) ou célibataires (29 %), à connaître les mêmes troubles.
Les célibataires sont plus susceptibles d’éprouver de l’irritabilité et des sautes d’humeur
L’irritabilité et les sautes d’humeur sont plus fréquentes chez les personnes qui sont actuellement célibataires (figure 1). Près de la moitié des adultes célibataires (48 %) déclarent se sentir très souvent ou souvent irritables depuis le début de la pandémie, comparativement à 37 % des adultes en couple et à 30 % de ceux qui sont séparés, divorcés ou veufs. Les adultes célibataires (39 %) disent aussi éprouver des sautes d’humeur dans des proportions plus élevées que ceux qui sont en couple (31 %) et que ceux qui sont séparés, divorcés ou veufs (27 %).
Encore une fois, les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sont plus susceptibles que les hommes d’éprouver de l’irritabilité ou des sautes d’humeur. Environ 6 femmes célibataires sur 10 (59 %) et 42 % des femmes en couple déclarent se sentir irritables très souvent ou souvent depuis le début de la pandémie. Quant aux hommes, ils disent se sentir irritables très souvent ou souvent dans des proportions plus faibles que les femmes, qu’ils soient célibataires (38 %) ou en couple (32 %) (figure 2).
Les femmes célibataires (46 %) présentent la plus forte probabilité d’éprouver très souvent ou souvent des sautes d’humeur depuis le début de la crise de COVID-19, suivies par les femmes en couple (38 %). Les hommes sont moins susceptibles que les femmes d’indiquer qu’ils ont des sautes d’humeur fréquentes, mais ceux qui sont célibataires (31 %) ont tendance à éprouver des sautes d’humeur très souvent ou souvent dans de plus fortes proportions que les hommes en couple (23 %).

Les femmes séparées, divorcées ou veuves sont plus susceptibles de ressentir de la tristesse
Les adultes séparés, divorcés ou veufs (51 %) et les célibataires (48 %) sont plus nombreux que les adultes en couple (43 %) (figure 1) à déclarer se sentir très souvent ou souvent tristes durant la crise de coronavirus.
Les fréquents sentiments de tristesse sont également plus courants chez les femmes, qu’elles soient célibataires (59 %) ou en couple (53 %), que chez les hommes, qu’ils soient célibataires (37 %) ou en couple (33 %) (figure 2).
La santé mentale a une incidence sur le bien-être des familles
Il sera important de surveiller, à court, à moyen et à long termes, les tendances en matière de santé mentale, en fonction de l’état matrimonial et du sexe, ainsi que d’autres facteurs, dans le contexte de la pandémie de COVID‑19. Une première analyse a permis de démontrer que la perte de revenus ou d’emploi et les contraintes financières immédiates affectent également les symptômes de santé mentale, comme l’anxiété et la difficulté à dormir pendant la pandémie. Par ailleurs, la santé mentale et la santé physique sont interreliées : les personnes souffrant de troubles de l’humeur sont beaucoup plus susceptibles de développer un problème de santé à long terme que celles qui n’en ont pas4.
Les problèmes de santé mentale peuvent avoir une incidence profonde sur la scolarité, le travail et la vie sociale d’une personne, ainsi que sur les interactions qu’elle entretient avec sa famille5. Parmi les Canadiens dont au moins un membre de la famille souffrait d’un problème de santé mentale en 2012, plus du tiers (35 %) considéraient que la santé mentale de ce dernier avait affecté leur vie et, de ce nombre, environ 71 % ont affirmé avoir prodigué des soins à ce membre de la famille6.
Ainsi, le bien-être des familles au Canada repose sur la santé mentale des personnes qui les composent. Une prise de décision fondée sur des données probantes permettra de mieux orienter les mesures de soutien sociales ciblées, tant pour les personnes sur le plan individuel que pour les familles, suivant l’évolution de cette période de coronavirus tout comme lorsque la crise actuelle sera passée.
Ana Fostik, Ph. D., Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Jennifer Kaddatz, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Notes
- Un sondage de l’Institut Vanier de la famille, de l’Association d’études canadiennes et de la firme Léger, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril 2020 et du 9 au 12 avril, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Les échantillons du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril et du 9 au 12 avril comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
- Caryn Pearson, Teresa Janz et Jennifer Ali, « Troubles mentaux et troubles liés à l’utilisation de substances au Canada » dans Coup d’œil sur la santé, no 82‑624‑X au catalogue de Statistique Canada (septembre 2013). Lien : https://bit.ly/2KsCEAW (PDF)
- Les comparaisons selon le sexe sont impossibles à obtenir pour les adultes séparés, divorcés ou veufs sur cette question en raison du faible taux de réponse.
- Patten et autres, « Long-Term Medical Conditions and Major Depression: Strength of Association for Specific Conditions in the General Population » dans Canadian Journal of Psychiatry, vol. 50, p. 195‑202, 2005. Comme mentionné dans le texte du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), intitulé « Mental Illness and Addiction: Facts and Statistics ». Lien : https://bit.ly/3eEjyWc
- Commission de la santé mentale du Canada, Changer les orientations, changer des vies : Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada (Calgary, Alberta, 2012). Lien : https://bit.ly/2XXTM9q (PDF)
- Caryn Pearson, « L’incidence des problèmes de santé mentale sur les membres de la famille » dans Coup d’œil sur la santé, no 82‑624‑X au catalogue de Statistique Canada (7 octobre 2015). Lien : https://bit.ly/3eJVl0Q
Être parent en temps de pandémie : Une histoire et des statistiques
Jennifer Kaddatz
21 avril 2020
Tout en veillant à ce que leurs enfants demeurent en sécurité, qu’ils soient douchés et scolarisés durant la pandémie de COVID-19, de nombreux parents au Canada, comme dans d’autres pays, sont présentement confrontés au stress et aux nuits blanches. Selon un sondage mené du 9 au 12 avril 20201, 42 % des adultes interrogés vivant avec des enfants ou des jeunes ont déclaré éprouver souvent ou très souvent de la difficulté à dormir depuis le début de la pandémie de COVID-19. Je suis l’un de ces parents.
Ma famille à moi compte trois garçons (préado et ado), et bientôt, je serai confrontée à une importante facture de carte de crédit et à un certain stress supplémentaire, car les garçons ont laissé leurs chaussures de sport dans leur casier à l’école le 12 mars. Ayant ce jour-là quitté pour l’école avec des bottes usées aux pieds, ils n’ont aujourd’hui plus rien à porter qui convienne pour une chaude journée printanière à Ottawa.
Jusqu’à maintenant, ma famille a eu beaucoup de chance durant cette pandémie. J’ai conservé mon travail rémunéré, et comme environ 6,8 millions de Canadiens interrogés par Statistique Canada au cours de la dernière semaine de mars (39 %)2, je travaille à domicile, où il est plus facile d’éviter les germes.
Mes parents et ma belle-famille vivent isolés à l’autre bout du pays, en sécurité au sein de relations attentionnées, comme 81 % des couples engagés qui affirment qu’eux-mêmes et leur conjoint se soutiennent mutuellement durant la crise3. Mon mari et moi faisons d’ailleurs partie des 79 % des couples avec enfants à la maison qui se soutiennent mutuellement pendant cette période singulière.
Pour ma famille, le plus grand facteur de stress quotidien durant la pandémie de COVID-19 est, en fait, lié aux activités scolaires – ou plus précisément à l’école à la maison. Dans ma famille maternelle, il y a eu trois générations d’enseignants, mais je n’en suis pas une. Mes garçons se font l’école à la maison par eux-mêmes pour la durée de cette pandémie. Les enseignants de niveau primaire et secondaire ne représentent qu’environ 2 % de la population active du Canada4 – ce qui signifie que le reste d’entre nous n’est probablement pas qualifié pour ce travail.
D’après Statistique Canada, 32 % des Canadiens sont très ou extrêmement inquiets à propos des tensions familiales dues au confinement lié au coronavirus5. Je ne peux m’empêcher de m’interroger à savoir quelle partie de cette anxiété est reliée directement ou indirectement aux responsabilités d’enseignement, additionnées à celles de parents, alors que les écoles sont fermées.
Certaines familles ne disposent pas des ressources qui permettent une scolarisation sans stress à la maison
Heureusement – ou malheureusement, selon le point de vue de mon fils de 14 ans – une éducation « pandémique » à la maison est maintenant accessible en ligne, dans la plupart des régions du Canada. Cependant, pour avoir accès à cette éducation, il faut : a) une connexion Internet haute vitesse stable, avec une bande passante adéquate; b) un accès à un ou, de préférence, plusieurs appareils; c) un enfant capable de se concentrer et d’être autonome; ou d) toutes ces réponses. La réponse est, bien entendu, d). La question qui s’impose alors est : est-il possible pour les enfants de toutes les familles au pays d’avoir accès à une éducation en ligne?
L’examen des données disponibles auprès des sources officielles donne un aperçu des caractéristiques familiales pouvant indiquer d’importants obstacles à l’obtention d’une éducation en ligne de niveau primaire ou postsecondaire durant la pandémie de COVID-19 et, par conséquent, des cas où cette vulnérabilité accrue peut entraîner un écart éducatif à long terme :
- Les ménages à faible revenu, les ménages ruraux et les ménages autochtones sont moins susceptibles de disposer d’un accès Internet ayant la vitesse minimale requise pour prendre part à des activités scolaires en ligne à la maison. En 2017, seuls 24 % des ménages des communautés autochtones et 37 % des ménages ruraux avaient accès à Internet à la vitesse minimale requise pour profiter pleinement des possibilités en ligne, alors que 97 % des foyers urbains avaient accès à cette vitesse ou à une vitesse encore plus rapide6. En 2018, environ 4 % des ménages se trouvant dans le quartile de revenu inférieur n’avaient pas d’accès Internet à la maison7.
- Les familles à faible revenu sont moins susceptibles d’avoir un appareil autre qu’un appareil mobile, ce qui pourrait complexifier la réalisation de travaux scolaires en ligne. Près du quart (24 %) des ménages situés dans le quartile de revenu inférieur ont indiqué en 2018 n’utiliser des appareils mobiles que pour naviguer sur Internet, une proportion qui s’avère trois fois plus élevée que celle associée aux ménages du quartile de revenu supérieur (8 %)8.
- Dans de nombreuses familles, plus d’un enfant doit effectuer des travaux scolaires à la maison, alors que la majorité des ménages n’ont probablement pas le nombre d’appareils nécessaire pour le faire. Près de 6 ménages sur 10 (58 %) ayant accès à Internet en 2018 disposaient de moins d’un appareil par membre du ménage9. Cette proportion était plus élevée (63 %) au sein des ménages situés dans le quartile de revenu inférieur.
- Tout comme les chaussures, il est possible que des dispositifs d’assistance n’aient pas été envoyés à la maison avant la fermeture des écoles, ce qui pourrait affecter l’aptitude des enfants et des jeunes ayant des incapacités à entreprendre certaines activités éducatives à la maison. La moitié des jeunes ayant une incapacité ont besoin d’au moins une aide, un appareil fonctionnel ou une mesure d’adaptation pédagogique pour suivre leurs cours, d’après l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 201710.
- Certains enfants ne vivent pas dans des familles où l’environnement est favorable à l’apprentissage en ligne :
- Près de 19 000 enfants ont été maltraités par un membre de leur famille au Canada en 2018, et dans 59 % des cas, c’était par l’un de ses propres parents, qui vivait la plupart du temps dans la même résidence11.
- L’insécurité alimentaire des ménages, qui contribue à une mauvaise santé mentale et physique, apparaît lorsque les ménages n’ont pas les moyens d’acheter des aliments de qualité ou en quantité suffisante pour rester en bonne santé. Il n’est pas étonnant que les données de 2017-2018 montrent un taux élevé d’insécurité alimentaire dans les ménages qui dépendent de l’aide sociale (60 %) et de l’assurance-emploi ou encore de l’Indemnisation des travailleurs (32 %)12.
Les statistiques mentionnées ci-dessus ont à peine abordé la multitude d’obstacles pouvant nuire à l’apprentissage à domicile, sans parler du bien-être global, pour les familles au Canada.
Pour plusieurs enfants et parents, l’école apporte des bénéfices qui vont au-delà de l’éducation – comme le soutien social et émotionnel, la nutrition, plus d’exercices physiques ainsi qu’un espace sécuritaire où les enfants peuvent être eux-mêmes.
Pour ma part, j’ai compris tous ces bénéfices qui manquent à mes garçons depuis le début de la crise de la COVID-19, simplement parce qu’ils ne sont plus à l’école. Et, même si j’adore les avoir avec moi à la maison, je suis impatiente qu’ils y retournent.
Jennifer Kaddatz, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Notes
- Le sondage de l’Institut Vanier de la famille, de l’Association d’études canadiennes et de la firme Léger, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril et du 9 au 12 avril, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Les échantillons du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril et du 9 au 12 avril comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
- Les données d’enquête de Statistique Canada montrent que pendant la semaine du 22 au 28 mars, 6,8 millions de Canadiens ont travaillé de la maison (39 %), ce qui inclut 4,7 millions de personnes qui n’ont pas l’habitude de fonctionner ainsi. Lien : https://bit.ly/3cMObqX
- Sondage de l’Institut Vanier de la famille, de l’Association d’études canadiennes et de la firme Léger, mené du 9 au 12 avril (veuillez consulter la note no 1).
- Statistique Canada, « Profession – Système de classification des professions (CNP) 2016 (693A), plus haut certificat, diplôme ou grade (15), situation d’activité (3), âge (13A) et sexe (3) pour la population active âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %) » dans Tableaux de données, Recensement de 2016, no 98‑400‑X2016295 au catalogue de Statistique Canada (29 novembre 2017). Lien : https://bit.ly/3auUbmq
- Statistique Canada, « Comment les Canadiens vivent-ils la situation liée à la COVID-19? » dans Infographies, no 11‑627‑M au catalogue de Statistique Canada (8 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2ywOyad
- Ministre du Développement économique rural, La haute vitesse pour tous : la stratégie canadienne pour la connectivité, Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Lien : https://bit.ly/3exYe4C
- Statistique Canada, Des données aux connaissances, pour bâtir un Canada meilleur – Pandémie de COVID-19 : La fermeture des écoles et la préparation des enfants à l’apprentissage en ligne, no 45‑28‑0001 au catalogue de Statistique Canada (15 avril 2020). Lien : https://bit.ly/3cCRG32
- Ibidem
- Ibidem
- Statistique Canada, « Expériences pédagogiques des jeunes ayant des incapacités » dans Infographies, no 11‑627‑M au catalogue de Statistique Canada (10 septembre 2019). Lien : https://bit.ly/2KkBW8v
- Statistique Canada, La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2018, no 85‑002‑X au catalogue de Statistique Canada (12 décembre 2019). Lien : https://bit.ly/2ytlG2D
- Valerie Tarasuk et Andy Mitchell, Household Food Insecurity in Canada 2017-2018, Toronto : Research to identify policy options to reduce food insecurity (PROOF) (mars 2020). Lien : https://bit.ly/3cFHDKB
Les Canadiens se tournent vers leurs écrans pour s’occuper durant la période d’isolement reliée à la COVID-19
Jennifer Kaddatz, Ana Fostik, Ph.D., et Nathan Battams
17 avril 2020
À certains égards, les Canadiens optimisent leur temps du mieux qu’ils peuvent durant l’isolement social, selon les données du sondage1 réalisé pendant quatre semaines en mars et avril 2020 par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger.
Depuis la longue fin de semaine d’avril (du 9 au 12 avril 2020), la moitié de la population âgée de 18 ans et plus du pays déclare se détendre « plus souvent » qu’avant la pandémie.
Six adultes sur 10 regardent des films, des émissions de télévision et des vidéos ou écoutent des balados plus souvent qu’avant le début de la crise de la COVID‑19. Quatre sur 10 suivent plus régulièrement les réseaux sociaux.
Plus de deux adultes sur 10 au Canada ont augmenté le temps qu’ils consacrent à écouter de la musique, à lire et à se divertir avec des jeux en ce temps de pandémie.
La moitié des adultes se détendent davantage, mais certaines familles signalent une diminution du temps d’inactivité
Bonne nouvelle en ces temps difficiles : les Canadiens déclarent se détendre davantage.
Près de la moitié (49 %) de la population canadienne âgée de 18 ans et plus affirme se détendre plus souvent maintenant qu’elle le faisait avant le début de la pandémie, selon les données du sondage du 9 au 12 avril 2020 (figure 1). Une proportion de 38 % déclarent se détendre aussi souvent, tandis que 13 % disent le faire moins souvent.
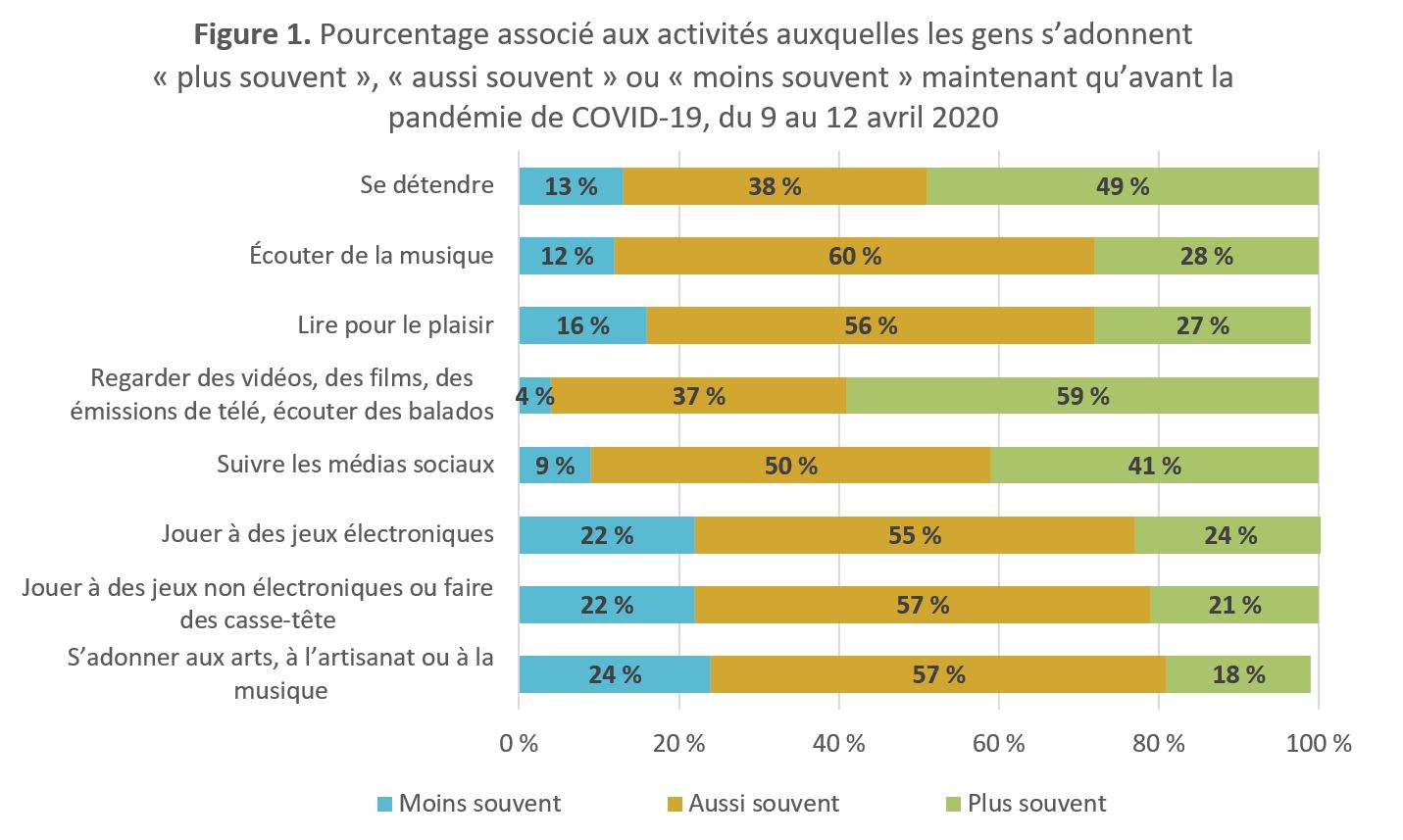
Une proportion légèrement plus élevée d’hommes (50 %) que de femmes (47 %) déclarent se détendre « plus souvent » depuis le début de la crise, l’écart étant principalement attribuable aux jeunes adultes de 18 à 34 ans : 64 % des jeunes hommes disent se détendre plus souvent depuis le début de la pandémie, comparativement à 56 % des jeunes femmes (figure 2).
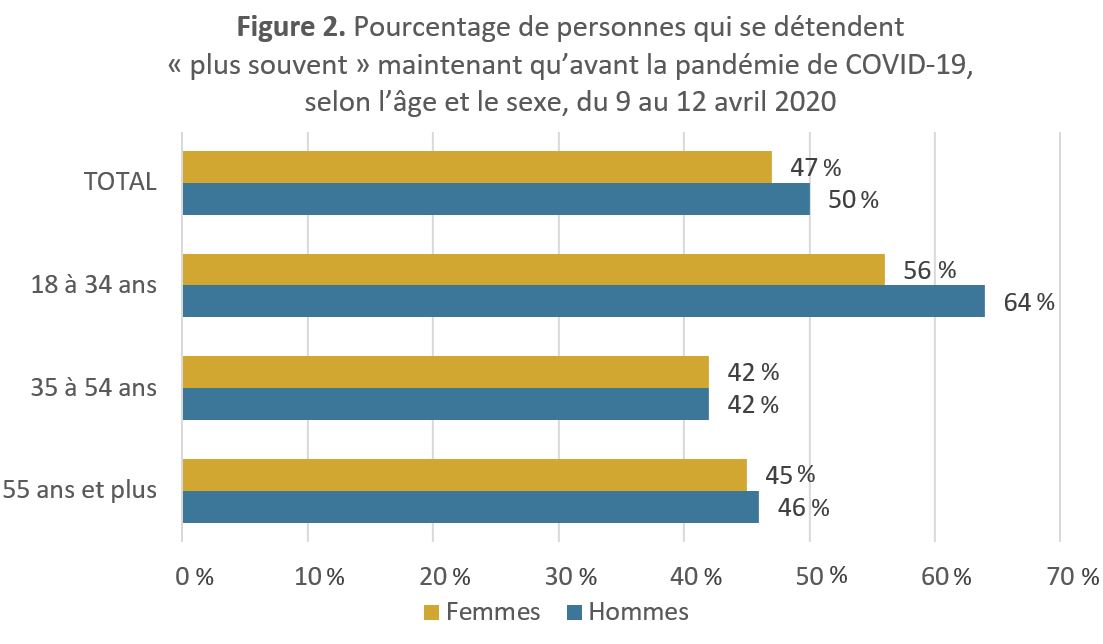
Il n’est pas tellement étonnant que les adultes ayant de jeunes enfants à la maison (43 %) soient moins susceptibles d’affirmer se détendre plus souvent pendant la pandémie de COVID-19 que ceux n’ayant ni enfant ni jeune à la maison (48 %) (figure 3).
Près d’un adulte sur quatre (24 %) vivant dans la même maison qu’un ou plusieurs enfants de moins de 13 ans déclare se détendre moins souvent qu’avant le début de la crise.
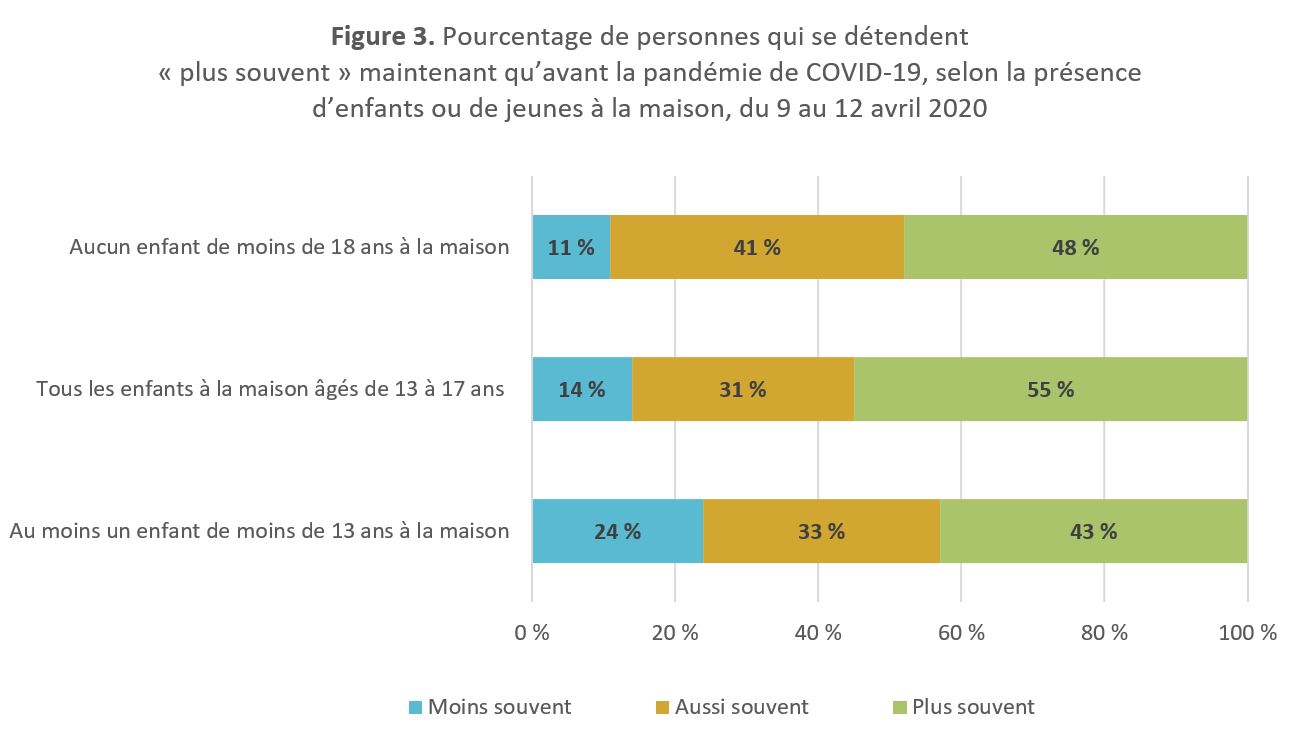
Trois adultes sur 10 se permettent plus souvent d’écouter de la musique et de lire pour le plaisir
Au Canada, environ 3 adultes sur 10 écoutent de la musique plus souvent maintenant (28 %) qu’avant le début de la crise de la COVID-19 (figure 1). Cette proportion est comparable à celle des gens qui disent lire pour le plaisir plus fréquemment (27 %).
D’après une analyse des tendances au fil du temps au cours de cette pandémie de COVID-19, on observe une tendance marquée à la hausse à l’égard de la lecture : alors que du 27 au 29 mars, 23 % de la population avait indiqué lire plus souvent, ce pourcentage est passé à 27 % du 9 au 12 avril.
Les femmes sont à peu près aussi susceptibles que les hommes de consacrer plus de temps à écouter de la musique (27 % et 29 %, respectivement), mais une plus forte proportion de femmes que d’hommes (29 % et 24 %) déclarent lire plus souvent depuis le début de la crise.
Les passe-temps électroniques ou sur écran sont populaires et affichent la plus forte augmentation d’utilisation
Les données du sondage du 9 au 12 avril montrent que de nombreux adultes au Canada se tournent vers leurs écrans pour s’occuper, alors que les mesures de santé publique les maintiennent à la maison.
Parmi toutes les activités pour lesquelles les adultes ont été interrogés, « regarder des films, des émissions de télévision, des vidéos ou écouter des balados » et « suivre les médias sociaux » présentaient les plus fortes proportions d’adultes, soit 59 % et 41 % respectivement, ayant affirmé s’adonner à ces activités « plus souvent » depuis le début de la crise de la COVID-19 (figure 1).
La proportion des personnes qui affirment avoir augmenté le temps qu’elles consacrent à regarder des films, des émissions de télévision, des vidéos ou à écouter des balados était plus du double de la proportion des personnes qui disent lire pour le plaisir (27 %) ou écouter de la musique (28 %) plus souvent qu’auparavant.
Par ailleurs, une certaine tendance semble vouloir indiquer une augmentation à l’égard de l’utilisation des écrans pour la suite de la pandémie : 53 % des adultes au Canada ont affirmé, à la deuxième semaine du sondage (du 27 au 29 mars), regarder des films, des émissions de télévision, des vidéos ou écouter des balados plus souvent qu’avant, alors qu’ils étaient 59 % à la quatrième semaine (du 9 au 12 avril) à en faire autant.
La proportion associée au temps consacré aux jeux électroniques semble également à la hausse : 24 % de tous les adultes, soit 26 % des hommes et 22 % des femmes, disent jouer plus souvent à des jeux électroniques qu’ils ne le faisaient avant le début de la pandémie, selon le sondage du 9 au 12 avril (figures 4 et 5). Ces résultats étaient similaires à ceux publiés par Statistique Canada pour la période du 29 mars au 3 avril, selon les données recueillies lors d’un panel en ligne, qui indiquait que 22 % de tous les Canadiens consacraient maintenant plus de temps à jouer à des jeux vidéo2.
Les jeunes adultes, en particulier les hommes, ont considérablement augmenté le temps qu’ils consacrent à des jeux vidéo électroniques depuis le début de la pandémie. Plus de la moitié des hommes (54 %) et le tiers des femmes (36 %) de 18 à 34 ans déclarent jouer à des jeux vidéo électroniques plus souvent maintenant qu’auparavant (figures 4 et 5).
De plus, les adultes qui avaient au moins un enfant de moins de 13 ans vivant dans leur ménage (28 %) étaient légèrement plus susceptibles que ceux ayant seulement des adolescents à la maison (26 %) et que ceux n’ayant pas d’enfant à la maison (22 %) de déclarer jouer à des jeux vidéo plus souvent depuis le début de la crise de la COVID-19.
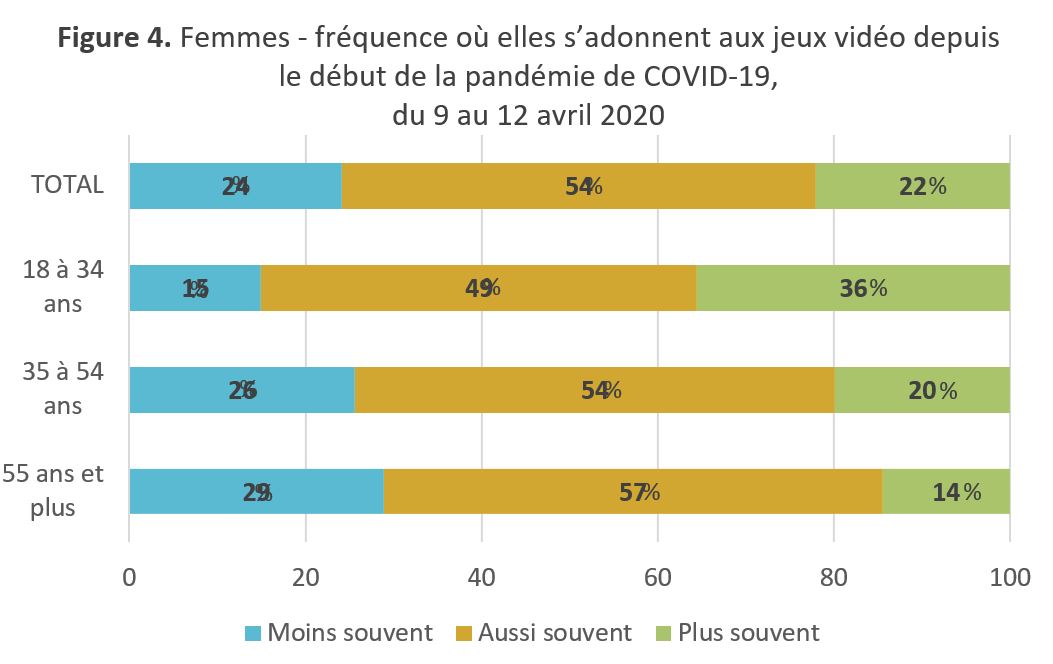
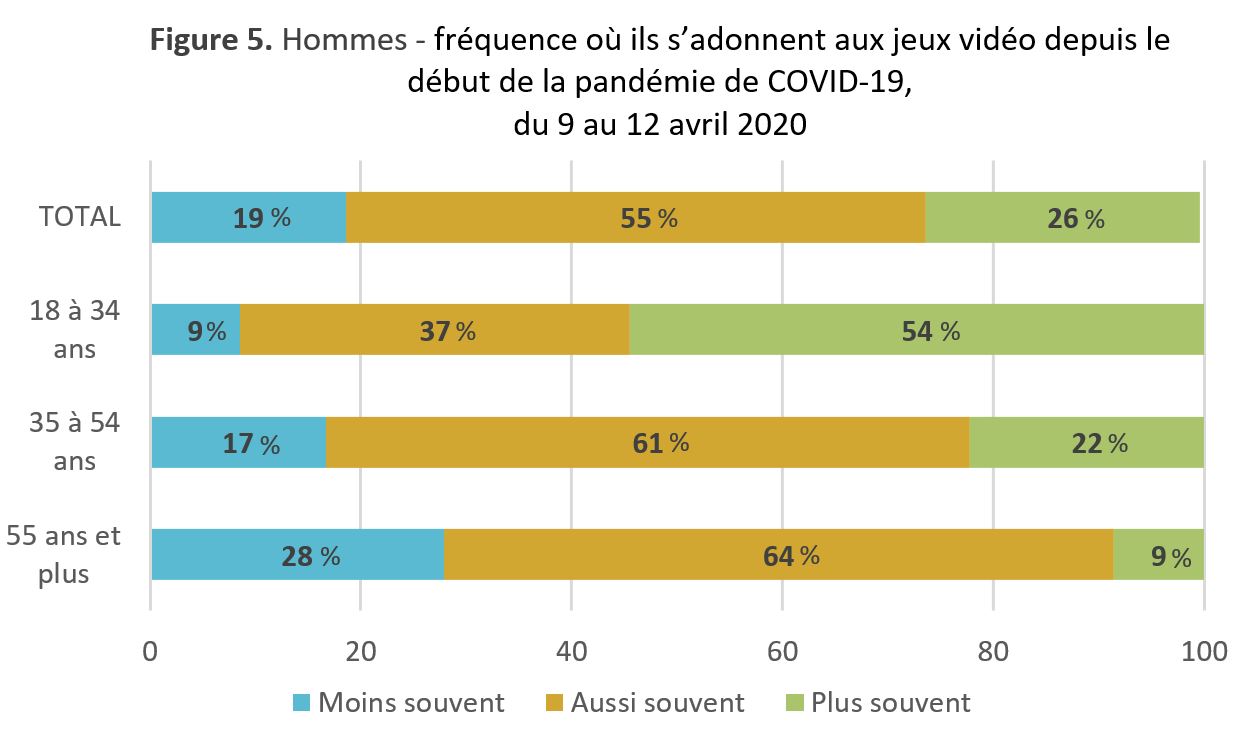
Les femmes consacrent plus de temps à des jeux de société et à des casse-tête, et les hommes, à des jeux électroniques
Malgré l’apparente popularité du temps passé devant un écran chez les adultes au Canada, la proportion des gens qui déclarent avoir augmenté leur temps de jeu électronique depuis le début de la pandémie (24 %) n’est que légèrement supérieure à la proportion de ceux qui ont augmenté le temps qu’ils consacrent à des jeux de société ou à des casse-tête (21 %) (figure 1). La proportion d’adultes qui déclarent s’adonner maintenant à ces activités « moins souvent », soit 22 % et 22 % respectivement, est également très semblable. Cependant, des différences existent selon le sexe et la présence d’enfants et de jeunes dans le ménage.
Des proportions semblables de femmes affirment qu’elles jouent à des jeux électroniques plus souvent maintenant qu’elles le faisaient avant la pandémie (22 %), ou qu’elles s’adonnent à des jeux vidéo non électroniques ou à des casse-tête (23 %). En comparaison, chez les hommes, on note une différence de 8 points de pourcentage entre l’adoption de ces deux passe-temps, 26 % des hommes déclarant qu’ils jouaient aux jeux électroniques plus souvent maintenant et 18 % des hommes disant qu’ils jouaient à des jeux de société ou faisaient des casse-tête plus souvent maintenant qu’avant la pandémie.
De plus, une proportion légèrement plus élevée de jeunes femmes que de jeunes hommes ont augmenté le temps consacré à des jeux non électroniques ou à des casse-tête : environ le tiers des femmes (33 %) et environ le quart des hommes (27 %) âgés de 18 à 34 ans déclarent consacrer plus de temps à ce type d’activité.
Relativement peu de personnes âgées au Canada déclarent s’adonner à des jeux de société ou à des casse-tête plus souvent maintenant qu’avant la pandémie du coronavirus, soit environ un homme sur 10 (9 %) de 55 ans et plus, et une femme sur 7 (15 %) de 55 ans et plus.
Une importante proportion de femmes (54 %) et d’hommes (55 %) ont déclaré qu’ils jouaient à des jeux vidéo « aussi souvent » qu’avant la pandémie de COVID-19 (figures 4 et 5), mais il serait pertinent de mentionner que, dans certains cas, cette réponse peut simplement indiquer qu’ils ne jouaient pas aux jeux vidéo au départ.
Les familles avec enfants jouent à des jeux de société et s’adonnent plus souvent aux arts et à l’artisanat
Les adultes ayant au moins un enfant de moins de 13 ans vivant dans leur ménage (28 %) ou des adolescents à la maison (22 %) sont considérablement plus susceptibles que ceux vivant sans enfant (14 %) de déclarer jouer à des jeux non électroniques et faire des casse-tête plus souvent qu’avant le début de la pandémie de coronavirus (figure 6).
De plus, dans les foyers où vivent de jeunes enfants, les adultes sont presque deux fois plus susceptibles que ceux n’ayant ni enfant ni jeune à la maison d’avoir augmenté le temps consacré aux arts, à l’artisanat ou à la musique depuis le début de la crise de la COVID-19. Du 9 au 12 avril, 3 adultes sur 10 (31 %) vivant dans un foyer où habite au moins un enfant de moins de 13 ans affirment qu’ils se sont adonnés aux arts, à l’artisanat ou à la musique plus souvent depuis le début de la pandémie, comparativement à 27 % de ceux qui n’ont que des adolescents à la maison et à 17 % de ceux qui n’ont pas d’enfant de moins de 18 ans à la maison (figure 7).
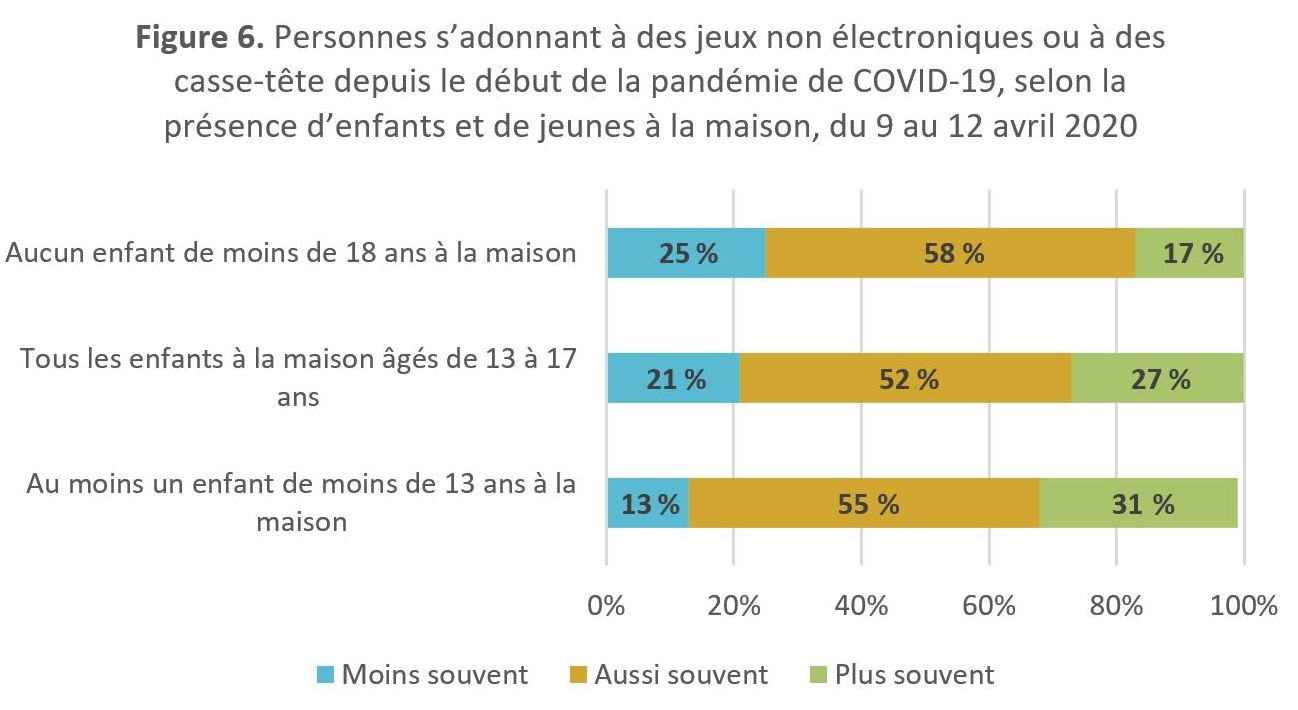

Jennifer Kaddatz, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Ana Fostik, Ph. D., Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Nathan Battams est gestionnaire des communications à l’Institut Vanier de la famille.
Notes
1. Le sondage, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril et du 9 au 12 avril, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’un sondage en ligne. Les échantillons du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril et du 9 au 12 avril comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ± 2,52 %, et ce, 19 fois sur 20. Les chiffres exprimés en pourcentage ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
2. Statistique Canada, « Comment les Canadiens vivent-ils la situation liée à la COVID-19? » dans Infographies, no 11‑627‑X au catalogue de Statistique Canada (8 avril 2020). Lien : https://bit.ly/2VyeEl1
Un sondage révèle des écarts entre les sexes par rapport aux expériences et aux réactions relatives à la pandémie de COVID-19
16 avril 2020
Pendant une pandémie, comme c’est le cas dans la vie en général, les femmes et les hommes ont souvent des réalités et des comportements différents. Selon les données du sondage réalisé au cours des trois dernières semaines1 par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger, une proportion plus élevée de femmes que d’hommes perçoivent la pandémie de COVID-19 comme une menace et ont subi des conséquences physiques, émotionnelles et sociales résultant de la distanciation sociale et de l’isolement à domicile.
- Les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes d’éprouver de l’anxiété ou de la nervosité, de la tristesse, de l’irritabilité ou de la difficulté à dormir durant la pandémie.
- Les femmes sont également plus susceptibles de respecter les consignes de sécurité, se disent satisfaites des mesures fédérales et provinciales mises en œuvre pour aplanir la courbe et affirment qu’elles accepteraient des mesures d’application plus strictes.
Les femmes sont plus susceptibles de percevoir le coronavirus comme une menace, mais avec le temps, les différences convergent
En général, les femmes perçoivent la COVID-19 comme une menace plus grave que ne la perçoivent les hommes à l’égard de ses répercussions sur la société. Dans le plus récent cycle du sondage, mené du 3 au 5 avril 2020, une plus forte proportion de femmes que d’hommes disent percevoir le virus comme une menace pour l’économie canadienne (94 % c. 91 %), une menace pour la vie quotidienne au sein de leur communauté (81 % c. 75 %) et une menace pour la santé de la population dans son ensemble (83 % c. 74 %). Une proportion égale de femmes et d’hommes (53 %) affirment que la COVID-19 est une menace pour leur situation financière personnelle.
À l’égard de l’impact personnel sur la santé*, les femmes ont également tendance à exprimer une inquiétude plus vive. Près de 7 femmes sur 10 (68 %) de 18 ans et plus indiquent qu’elles ont « très peur » ou « assez peur » de contracter le coronavirus, par rapport à 63 % des hommes (figure 1). En parallèle, 8 femmes sur 10 (80 %) craignent qu’un membre de leur famille en soit infecté, comparativement à 73 % des hommes.
Lorsqu’on leur demande si le pire de la crise est derrière nous, si on le vit actuellement ou s’il est à venir, 69 % des femmes indiquent qu’elles croient que le pire est à venir, par rapport à 64 % des hommes. À l’autre extrémité, 11 % des femmes et 18 % des hommes disent penser que le virus ne constitue pas une menace réelle et qu’on le présente de façon « démesurée »*; néanmoins, les données se rapportant aux femmes et aux hommes recueillies au cours des trois dernières semaines suggèrent qu’avec le temps, ces écarts se sont resserrés (figures 1 et 2).


On remarque des différences marquées entre les sexes chez les jeunes adultes à l’égard des relations avec la famille et les amis
Les données montrent que les femmes et les hommes au Canada se sont appliqués à aplanir la courbe de la COVID-19. Près de 9 femmes et hommes sur 10 disent pratiquer la distanciation sociale, maintenir une distance sécuritaire de 2 mètres des autres personnes, laver leurs mains plus souvent qu’à l’habitude et ne sortir que lorsque c’est nécessaire (figure 3).
Les différences entre les femmes et les hommes sont peu prononcées par rapport aux activités d’achat déclarées au cours de la dernière semaine. Les femmes sont légèrement moins susceptibles de s’être rendues à l’épicerie (69 % c. 72 %), dans un magasin de vins et spiritueux (13 % c. 17 %) ou à un comptoir de mets à emporter d’un restaurant (20 % c. 22 %). Toutefois, les écarts sont plus importants entre les femmes et les hommes ayant fréquenté un dépanneur au cours des 7 derniers jours (15 % c. 22 %).

Des différences plus marquées entre les sexes ont été relevées en matière de gestion des relations avec la famille et les amis durant la pandémie, plus particulièrement lorsque l’on prend l’âge en considération. Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de déclarer avoir demandé aux autres de pratiquer la distanciation sociale (86 % c. 79 %), comme le montre la figure 3. L’écart entre les sexes le plus marqué à cet égard se trouve chez les femmes et les hommes de 18 à 24 ans (une différence de 13 points de pourcentage), mais il demeure perceptible à une échelle réduite au sein du groupe des 35 à 54 ans (une différence de 2 points de pourcentage) et de celui des 55 ans et plus (une différence de 8 points de pourcentage), comme on peut le constater à la figure 4.
Par ailleurs, les hommes – plus particulièrement les jeunes hommes – sont plus susceptibles de visiter les amis et la famille durant la pandémie de COVID-19 : 30 % des hommes de 18 à 34 ans affirment avoir visité des amis ou des membres de la famille depuis le début de la crise du coronavirus, ce qui représente plus du double de la proportion (14 %) des femmes du même groupe d’âge et environ quatre fois la proportion des hommes (8 %) et des femmes (6 %) de 55 ans et plus (figure 5).


Les femmes acceptent mieux les mesures potentiellement plus strictes visant à aplanir la courbe
Près des trois quarts des femmes au Canada (74 %) sont satisfaites des mesures instaurées par le gouvernement fédéral dans le but de combattre la COVID-19, et 84 % le sont des mesures instaurées à l’échelle provinciale, selon les résultats du sondage réalisé du 3 au 5 avril 2020. Ces données sont comparables à 69 % et à 79 % des hommes, et révèlent un écart entre les sexes semblable à ce qui avait été observé lors du cycle du sondage du 10 au 13 mars.
Les femmes indiquent aussi plus couramment être en accord avec des mesures potentiellement plus strictes qui pourraient être appliquées afin de contenir la pandémie de COVID-19. Comme le montre le sondage du 3 au 5 avril, 7 femmes sur 10 (68 %) sont entièrement d’accord à ce que les policiers puissent remettre des contraventions aux citoyens qui ne respectent pas les mesures instaurées, comparativement à 62 % des hommes, alors que 49 % des femmes et 46 % des hommes sont d’avis que les policiers devraient même pouvoir arrêter des gens. Si les villes devaient se mettre en quarantaine complète, 43 % des femmes affirment qu’elles seraient entièrement d’accord avec cette mesure, comparativement à 36 % des hommes.
Une proportion plus élevée de femmes éprouvent de l’anxiété, de la tristesse, de l’irritabilité et de la difficulté à dormir
Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de déclarer qu’elles ont « très souvent » ou « souvent » éprouvé de l’anxiété ou de la nervosité, de la tristesse, de l’irritabilité ou de la difficulté à dormir depuis le début de la pandémie de COVID-19. En effet, c’est à l’égard de ces indicateurs que l’on observe la plus grande différence entre les sexes dans le cadre du sondage mené du 3 au 5 avril, avec une proportion de femmes plus importante de 9 à 15 points de pourcentage par rapport aux hommes affirmant avoir connu de tels épisodes (figure 6).
Les jeunes femmes, de 18 à 34 ans, sont plus particulièrement susceptibles de déclarer éprouver « très souvent » ou « souvent » de l’anxiété ou de la nervosité comparativement à leurs homologues masculins (63 % c. 40 %). En outre, elles sont aussi beaucoup plus susceptibles de déclarer ressentir de la tristesse (56 % c. 36 %) et de l’irritabilité (61 % c. 41 %). Près de la moitié (45 %) des femmes de 18 à 34 ans indiquent éprouver de la difficulté à dormir, comparativement à moins de 3 hommes sur 10 (29 %) du même groupe d’âge.

Les hommes se sentent plus proches de leur partenaire, mais sont aussi moins susceptibles d’avoir quelqu’un sur qui compter en cas d’urgence
Malgré certaines différences qui existent entre les sexes en matière de sentiments et de réactions à l’égard de la pandémie de COVID-19, les femmes et les hommes déclarent en proportions égales qu’ils gèrent mieux (7 %), à peu près de la même façon (65 %) ou moins bien (25 % à 26 %) leur vie qu’avant la pandémie.
Il est toutefois intéressant de noter qu’une plus grande proportion d’hommes mariés ou vivant en union libre indiquent que la pandémie de COVID-19 les a rapprochés de leur conjoint(e) (49 %) et/ou a donné lieu à des conversations plus enrichissantes (52 %), comparativement aux femmes (41 % et 49 %).
Pour ce qui est d’avoir quelqu’un sur qui compter en cas d’urgence, près de 9 femmes et hommes sur 10 (85 % dans chacun des cas) disent avoir des personnes sur qui ils peuvent compter. Toutefois, 6 % des hommes, comparativement à 3 % des femmes, affirment n’avoir personne sur qui compter dans une période de crise.
Jennifer Kaddatz, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Notes
1. Le sondage, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars et du 3 au 5 avril 2020, comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Les échantillons du 27 au 29 mars et du 3 au 5 avril comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
* Les données portant sur la menace relative à leur propre santé, sur la menace relative à la santé d’un membre de leur famille et sur le fait que le virus constitue une menace réelle ou démesurée excluent les femmes et les hommes ayant indiqué qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille a déjà contracté le virus ou ayant répondu « Ne sais pas » à la question sur la menace concernée (ces personnes ont été incluses dans les données des autres questions du sondage faisant l’objet de ce rapport).
Les familles peinent à composer avec les conséquences financières de la pandémie de COVID-19
Jennifer Kaddatz
9 avril 2020
En matière de finances personnelles et familiales, le Canada dans son ensemble a été durement touché par la pandémie de COVID-19. Selon les premières estimations, plus de 3 millions de personnes dans ce pays ont demandé l’aide d’urgence et l’assurance-emploi du gouvernement depuis le 16 mars 2020.
Le ralentissement financier a été ressenti par presque toutes les familles, plusieurs d’entre elles indiquant que le stress financier a une incidence sur leur humeur, leur santé mentale et leur sommeil. Les personnes ayant immigré au Canada au cours des 10 dernières années et les familles qui ont des enfants et des adolescents à la maison sont parmi les plus susceptibles de dire qu’elles ont été confrontées à des difficultés financières en raison de la pandémie.
Les familles considèrent le coronavirus comme une menace pour leur bien-être financier
Selon les données du sondage1 réalisé du 3 au 5 avril 2020 par l’Institut Vanier de la famille, l’Association d’études canadiennes et la firme Léger, plus de la moitié (53 %) des adultes de 18 ans et plus rapportent que l’éclosion de coronavirus constitue une menace importante pour leur situation financière personnelle, tandis que 36 % considèrent la crise comme une menace négligeable. Par ailleurs, 11 % des adultes disent que l’éclosion ne représente pas une menace pour leurs finances.
Plus de 7 immigrants récents sur 10 (73 %) au Canada (c.-à-d. ceux qui sont arrivés au Canada au cours des 10 dernières années) déclarent que leur bien-être financier est menacé par la pandémie de façon « importante », comparativement à 58 % des immigrants arrivés au Canada il y a 10 ans ou plus, et à 50 % des Canadiens nés au pays (figure 1).
Figure 1. Pourcentage de la population âgée de 18 ans et plus affirmant que l’éclosion de la COVID-19 constitue une menace pour leur situation financière personnelle, selon le statut d’immigrant.
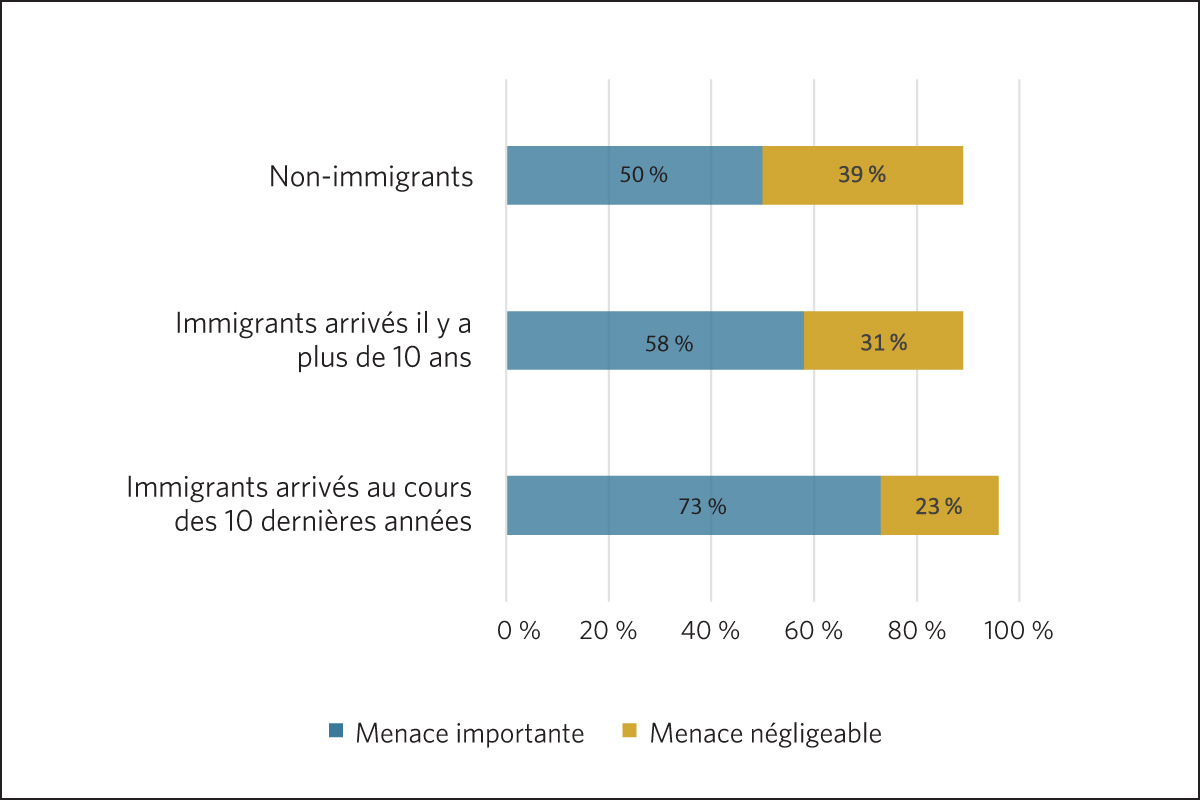
Les familles confrontées à d’importantes menaces financières subissent une diminution de leur bien-être
Les adultes affirmant que la pandémie constitue une « menace importante » pour leur situation financière déclarent éprouver « très souvent » ou « souvent » de l’anxiété ou de la nervosité (58 %), de la tristesse (56 %) ou de la difficulté à dormir (44 %) depuis le début de la crise de COVID. Les familles ayant des enfants à la maison étaient les plus susceptibles de signaler une anxiété accrue et une diminution du sommeil (figure 2).
Ce qui est particulièrement intéressant chez ceux qui voient l’éclosion comme une « menace importante » pour leur situation financière, c’est que ce sont les parents d’adolescents, davantage que les parents de jeunes enfants, qui déclarent le plus se sentir anxieux ou tristes « très souvent » ou « souvent ». Il est possible que ce résultat reflète l’inquiétude des parents à l’égard des jeunes qui ne peuvent pas aller à l’école, qui doivent être scolarisés à la maison, qui perdent leur emploi ou leur expérience de travail et qui sont confrontés à un avenir incertain par rapport à leurs études postsecondaires, en plus de leurs préoccupations concernant le bien-être financier global de la famille.
Figure 2. Pourcentage de la population considérant l’éclosion de la COVID-19 comme une « menace importante » pour leur situation financière et qui éprouvent « très souvent » ou « souvent » de l’anxiété ou de la nervosité, de la tristesse ou de la difficulté à dormir, selon la présence d’enfants à la maison.

Les immigrants récents, les familles à faible revenu et les familles avec enfants sont affectés de façon disproportionnée par la perte de revenus
Près de la moitié (45 %) des Canadiens disent que leur revenu a diminué en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, les pertes de revenus touchent certaines personnes plus que d’autres. Par exemple, les adultes ayant déclaré un revenu total du ménage, avant impôt, de moins de 19 999 $ en 2019 sont plus susceptibles de déclarer une perte de revenus en 2020 en raison de la crise, soit 56 % d’entre eux, alors que ce résultat oscille entre 37 % et 48 % dans les groupes à revenu plus élevé.
Une troublante proportion de 7 immigrants récents sur 10 (68 %) affirment avoir enregistré une baisse de revenus depuis le début de la crise du coronavirus, une proportion qui s’élève à environ 4 sur 10 chez les immigrants antérieurs (45 %) et les adultes nés au Canada (43 %) (figure 3).
Les familles ayant des enfants et des jeunes à la maison signalent plus fréquemment des répercussions négatives sur leur revenu que les familles qui n’ont aucun membre de moins de 18 ans à la maison. Plus précisément, 54 % des adultes ayant des enfants et des jeunes vivant dans leur ménage indiquent qu’à l’heure actuelle, la crise a une incidence négative sur leur revenu, comparativement à 41 % de ceux qui n’ont pas d’enfants.
Figure 3. Pourcentage de la population âgée de 18 ans ou plus déclarant que leur revenu a diminué en raison de la crise actuelle, selon le statut d’immigrant.

Les familles indiquent une baisse de l’épargne-retraite et des autres placements
Si la diminution du revenu total attribuable à la perte d’emploi constitue l’incidence la plus importante ou la plus significative sur les familles au Canada, l’impact financier négatif le plus courant de la pandémie de COVID-19 n’est pas une perte de salaire, mais plutôt une diminution de l’épargne-retraite et des autres placements. Plus de la moitié (54 %) des adultes déclarent que leurs fonds de retraite ou leurs autres placements ont été affectés négativement depuis le début de la crise actuelle, et cette proportion augmente avec l’âge (figure 4).
Plus de 6 personnes de 65 ans et plus sur 10 (63 %) déclarent que la situation a une incidence négative sur leurs fonds de retraite ou leurs placements, tout comme 62 % des 55 à 64 ans et 58 % des 45 à 54 ans.
Les répercussions financières négatives sur l’épargne-retraite et les autres placements ne sont vraisemblablement que l’un des facteurs qui suscitent des sentiments d’anxiété ou de nervosité depuis le début de la pandémie. Bien que 63 % des personnes âgées de 65 ans et plus aient déclaré que leur épargne était affectée négativement, elles représentaient en fait la plus faible proportion de ceux qui ont déclaré une anxiété ou une nervosité accrue comparativement à d’autres groupes d’âge ayant subi des répercussions négatives en matière d’épargne-retraite et de placements (figure 4).
Figure 4. Pourcentage de la population âgée de 18 ans ou plus déclarant que la crise actuelle a eu une incidence négative sur leur épargne‑retraite ou leurs autres placements, selon l’âge et les sentiments d’anxiété ou de nervosité éprouvés.

Les immigrants récents, les jeunes adultes et les familles avec enfants ont du mal à payer leurs factures et leur loyer ou leur hypothèque
Compte tenu des pertes de revenus et de la valeur des placements, il n’est pas étonnant que près de 3 adultes sur 10 au Canada affirment que la pandémie de COVID-19 affecte déjà négativement leur capacité de payer leurs factures à temps (28 %), et que 2 adultes sur 10 peinent à payer leur loyer ou leur hypothèque (22 %).
Dans la crise actuelle, un peu plus de la moitié (51 %) des immigrants récents ont de la difficulté à payer leurs factures à temps. Ces données s’élèvent à 30 % des immigrants arrivés antérieurement et à 25 % des personnes nées au Canada. Près de la moitié (46 %) des immigrants récents affirment que la crise a eu une incidence négative sur leur capacité de payer leur loyer ou leur hypothèque (figure 5).
Les personnes de moins de 45 ans sont plus susceptibles de déclarer avoir de la difficulté à assumer leurs coûts de logement, 31 % d’entre elles ayant indiqué avoir de la difficulté à payer leur hypothèque ou leur loyer, comparativement à 24 % des personnes de 45 à 54 ans, à 17 % des 55 à 64 ans et à seulement 4 % des 65 ans et plus.
Près de 3 adultes sur 10 (27 %) vivant avec des enfants de moins de 18 ans dans leur ménage affirment que la pandémie de COVID-19 pose des difficultés quant à leur capacité de payer le loyer ou l’hypothèque, comparativement à 2 adultes sur 10 qui vivent sans enfant à la maison. Ceux vivant avec de jeunes enfants, âgés de moins de 12 ans, étaient légèrement plus susceptibles de rapporter cette difficulté, soit 29 % d’entre eux.
Figure 5. Pourcentage de la population âgée de 18 ans et plus déclarant que la crise de COVID-19 a eu une incidence négative sur leur capacité de payer leurs factures à temps ou de payer leur loyer ou leur hypothèque, selon le statut d’immigrant.

Le fait de ne pas être en mesure de payer les factures, le loyer ou l’hypothèque peut avoir une incidence considérable sur le bien-être mental de nombreux Canadiens. Plus de 6 adultes sur 10 qui n’arrivent pas à payer leurs factures (61 %), leur loyer ou leur hypothèque à temps (63 %) ajoutent qu’ils se sentent « très souvent » ou « souvent » anxieux ou nerveux depuis le début de la crise de COVID-19 (figure 6).
Figure 6. Pourcentage de la population âgée de 18 ans et plus déclarant ressentir de l’anxiété « très souvent » ou « souvent » depuis le début de la crise de COVID-19 et indiquant que cette crise a une incidence négative sur leur capacité de payer leurs factures à temps ou de payer leur loyer ou leur hypothèque.

Jennifer Kaddatz est conseillère principale à l’Institut Vanier de la famille.
Note
- Le sondage comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus, en plus d’un échantillon de rappel de 500 immigrants, qui ont été interrogés à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.
Les couples se soutiennent mutuellement pendant la pandémie de COVID-19
Ana Fostik, Ph. D., Jennifer Kaddatz et Nora Spinks
21 avril 2020
Une famille, c’est un système de relations constituées d’actions et de réactions qui se produisent au fil du temps. Le bien-être d’une famille repose sur la capacité de tous ses membres de s’aimer, de s’entraider et de se soutenir les uns les autres, à la fois dans les moments difficiles comme dans les périodes plus tranquilles. Or, les forces et les tensions au cœur de ces relations familiales – comme dans tout système – sont amplifiées et renforcées lorsqu’elles sont soumises à un stress.
Alors que la pandémie de COVID-19 marque potentiellement l’un des moments les plus difficiles de l’histoire du Canada, les couples au pays semblent toutefois se porter relativement bien à ce jour. Les données recueillies au cours de quatre semaines de la pandémie1 révèlent que la plupart des personnes engagées dans des relations sérieuses offrent leurs forces à ces relations, s’appuient l’une sur l’autre et agissent/réagissent de façon positive dans leur gestion commune de la distanciation sociale.
La plupart des couples au Canada se soutiennent mutuellement, ont des conversations enrichissantes et se disputent à peu près autant qu’avant la période d’isolement à domicile.
Huit adultes en couple sur 10 affirment bien se soutenir mutuellement
Selon les données recueillies du 9 au 12 avril 2020, 8 personnes sur 10 âgées de 18 ans ou plus (80 %), et mariées ou vivant en union libre, affirment qu’elles et leur conjoint se soutiennent davantage depuis le début de la pandémie de COVID-19. Ces proportions sont à peu près les mêmes pour les personnes ayant des enfants ou des jeunes à la maison (77 %) que pour celles qui ne comptent aucun enfant de moins de 18 ans dans leur ménage (82 %).
Les adultes se soutiennent davantage qu’auparavant, quelle que soit l’incidence de la pandémie sur leur situation d’emploi : 82 % de ceux dont la situation professionnelle s’est détériorée (perte d’emploi temporaire ou permanente, perte de revenus ou de salaire) et 81 % de ceux dont la situation professionnelle n’a pas été affectée déclarent bénéficier d’un soutien accru de la part de leur partenaire.
Les personnes d’âge moyen sont moins susceptibles que les personnes plus âgées de dire qu’elles et leur partenaire se soutiennent mutuellement, 75 % des 35 à 54 ans étant d’accord avec l’affirmation, contre 84 % des 55 ans et plus.
Il est intéressant de noter que les hommes sont plus nombreux que les femmes (84 % et 77 % respectivement) à affirmer entretenir une relation de soutien avec leur partenaire.
Plus de 4 adultes sur 10 ont des conversations plus enrichissantes avec leur conjoint
Communiquer de façon claire est important pour le bien-être de la famille. Selon les données recueillies entre les 9 et 12 avril, plus de 4 adultes sur 10 (43 %) étant engagés dans une relation sérieuse au Canada disent avoir des conversations plus enrichissantes depuis le début de la pandémie de COVID-19. C’est particulièrement le cas chez ceux dont la situation sur le marché du travail s’est détériorée depuis le début de la pandémie : 51 % d’entre eux déclarent avoir des conversations plus enrichissantes avec leur partenaire, contre 36 % de ceux dont l’emploi ou le revenu n’a pas été touché par la pandémie. Seuls 10 % des adultes ne sont pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle ils auraient des conversations plus enrichissantes avec leur conjoint.
Les hommes sont légèrement plus nombreux que les femmes à affirmer entretenir des conversations plus enrichissantes avec leur conjoint(e) ou partenaire depuis le début de la pandémie de COVID-19, soit 45 % contre 40 %. Les jeunes sont également plus nombreux (52 % des 18 à 34 ans) que les adultes plus âgés (40 % des 35 à 54 ans et 41 % des 55 ans et plus) à faire une telle affirmation.
Les personnes mariées ou vivant en union libre et ayant des enfants ou des jeunes à la maison sont à peu près aussi nombreuses que celles qui n’ont pas d’enfants à affirmer entretenir des conversations plus enrichissantes avec leur partenaire depuis le début de la crise, soit 44 % et 42 % respectivement.
Quatre adultes sur 10 se sentent plus proches de leur partenaire
Possiblement en raison du bon soutien mutuel ou des conversations enrichissantes qu’ils entretiennent, près de 4 adultes engagés dans une relation sérieuse sur 10 (41 %) affirment se sentir plus proches de leur conjoint ou partenaire depuis le début de la pandémie de COVID-19. Cette proportion est encore plus élevée chez les Canadiens qui ont perdu leur emploi, leur revenu ou leur salaire en raison de la pandémie : 48 % d’entre eux déclarent se sentir plus proches de leur conjoint ou de leur partenaire, contre 34 % chez ceux dont l’emploi n’a pas été touché par la pandémie.
La proportion de ceux qui se sentent plus proches de leur conjoint est à peu près la même chez les hommes (44 %) et les femmes (38 %), et est également relativement stable selon le groupe d’âge et la présence ou non d’enfants dans le ménage. Selon les données recueillies du 9 au 12 avril, 43 % des personnes mariées ou vivant en union libre avec des enfants de moins de 18 ans à la maison disent se sentir plus proches de leur conjoint depuis le début de la pandémie.
Lorsque l’on regarde les données en fonction des régions, c’est en Ontario et en Colombie-Britannique que l’on retrouve le pourcentage le plus élevé de personnes affirmant se sentir plus proches de leur conjoint, avec 48 % et 43 % respectivement, et dans les Prairies que l’on retrouve le pourcentage le plus faible, avec 30 %.
L’Ontario est la seule province qui affiche actuellement une augmentation de la proportion d’adultes se sentant plus proches de leur conjoint aujourd’hui comparativement à plus tôt dans la pandémie, la proportion étant passée de 39 % lors du sondage du 10 au 13 mars à 48 % dans le sondage du 9 au 12 avril.
Moins de 2 adultes sur 10 engagés dans une relation sérieuse se disputent davantage
Seulement 18 % des personnes mariées ou vivant en union libre ont déclaré se disputer davantage avec leur conjoint ou leur partenaire depuis le début de la pandémie. En effet, environ 54 % se disent en désaccord avec l’affirmation selon laquelle ils se disputeraient davantage, alors que 28 % ne sont ni en accord ni en désaccord avec celle-ci.
Cependant, les jeunes adultes engagés dans une relation sérieuse – avec une personne de leur âge ou une personne plus âgée – sont plus susceptibles de déclarer qu’ils se disputent davantage avec leur partenaire que les personnes plus âgées. Près de 3 adultes sur 10 âgés de 18 à 34 ans (28 %) déclarent se disputer davantage avec leur conjoint ou leur partenaire depuis le début de la pandémie de COVID-19, contre 19 % des 35 à 54 ans et seulement 12 % des 55 ans et plus.
Les Canadiens qui ont subi une perte d’emploi ou de revenus en raison de la pandémie ont tendance à se disputer davantage qu’auparavant dans des proportions plus importantes que ceux qui ont conservé leur emploi : 26 % et 16 % affirment se disputer davantage.
Les disputes avec un partenaire sont souvent liées au stress et à d’autres indicateurs de bien-être et, selon les données du 9 au 12 avril, environ 6 jeunes femmes sur 10, âgées de 18 à 34 ans, disent éprouver « très souvent » ou « souvent » de l’anxiété ou de la nervosité (64 %), de l’irritabilité (64 %) ou de la tristesse (59 %), et 45 % affirment avoir de la difficulté à dormir. Ces pourcentages sont nettement plus élevés que ceux de leurs homologues masculins et sont également supérieurs à ceux des femmes de plus de 55 ans, parmi lesquelles environ 5 sur 10 disent ressentir « très souvent » ou « souvent » de l’anxiété ou de la nervosité (46 %) ou de la tristesse (50 %), alors que moins de 3 sur 10 (28 %) affirment se sentir irritables et 36 % disent avoir de la difficulté à dormir.
Ana Fostik, Ph. D., Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Jennifer Kaddatz, Institut Vanier, en détachement de Statistique Canada
Nora Spinks est directrice générale de l’Institut Vanier de la famille.
Note
- Le sondage, mené du 10 au 13 mars, du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril et du 9 au 12 avril 2020 comprenait environ 1 500 personnes de 18 ans et plus qui ont été interrogées à l’aide d’une technologie ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) dans le cadre d’une enquête en ligne. Les échantillons du 27 au 29 mars, du 3 au 5 avril et du 9 au 12 avril comprenaient également un échantillon de rappel d’environ 500 immigrants. À l’aide des données du Recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage, afin d’assurer un échantillon représentatif de la population. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne, dans le présent cas). Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon probabiliste de 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,52 %, et ce, 19 fois sur 20.



































