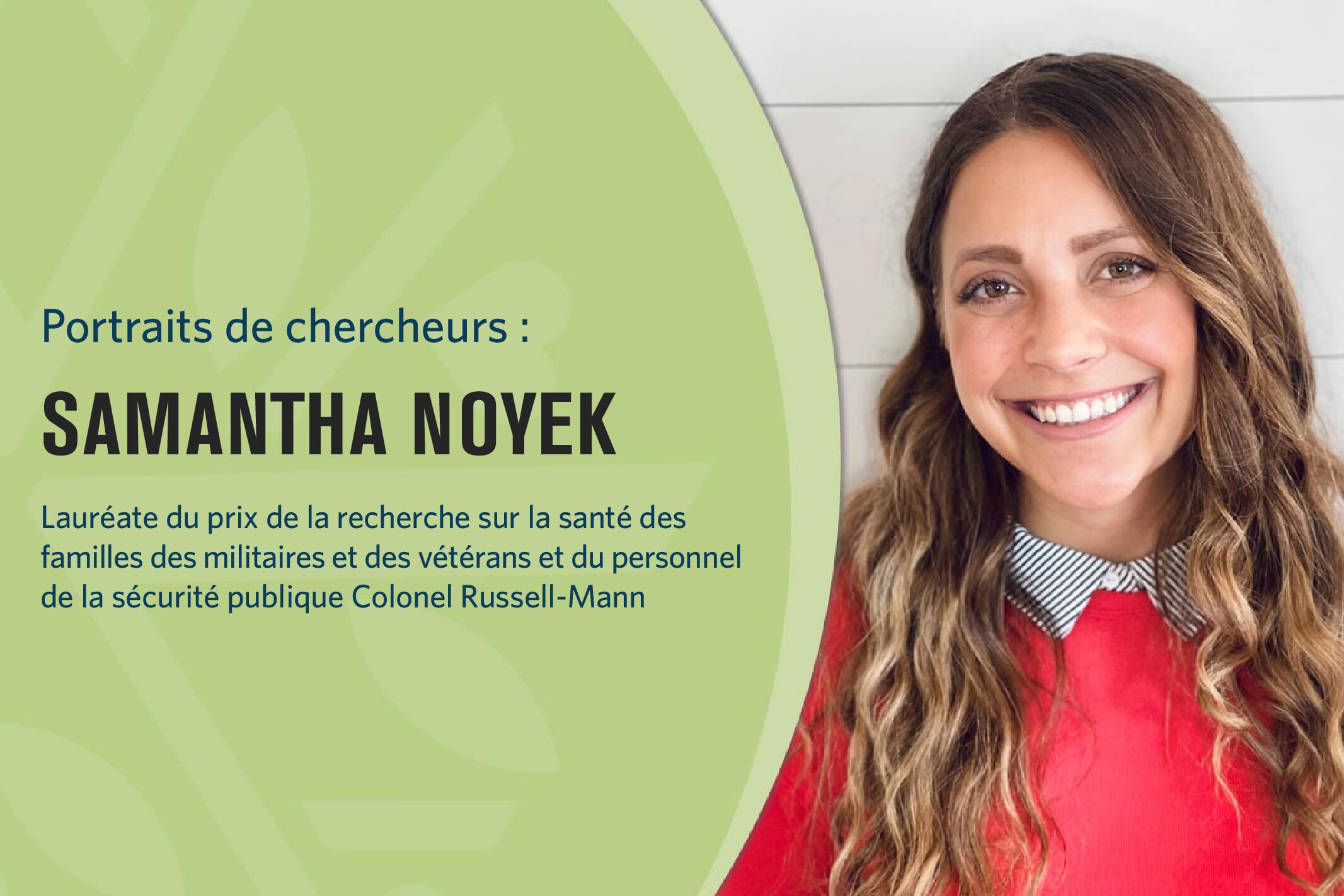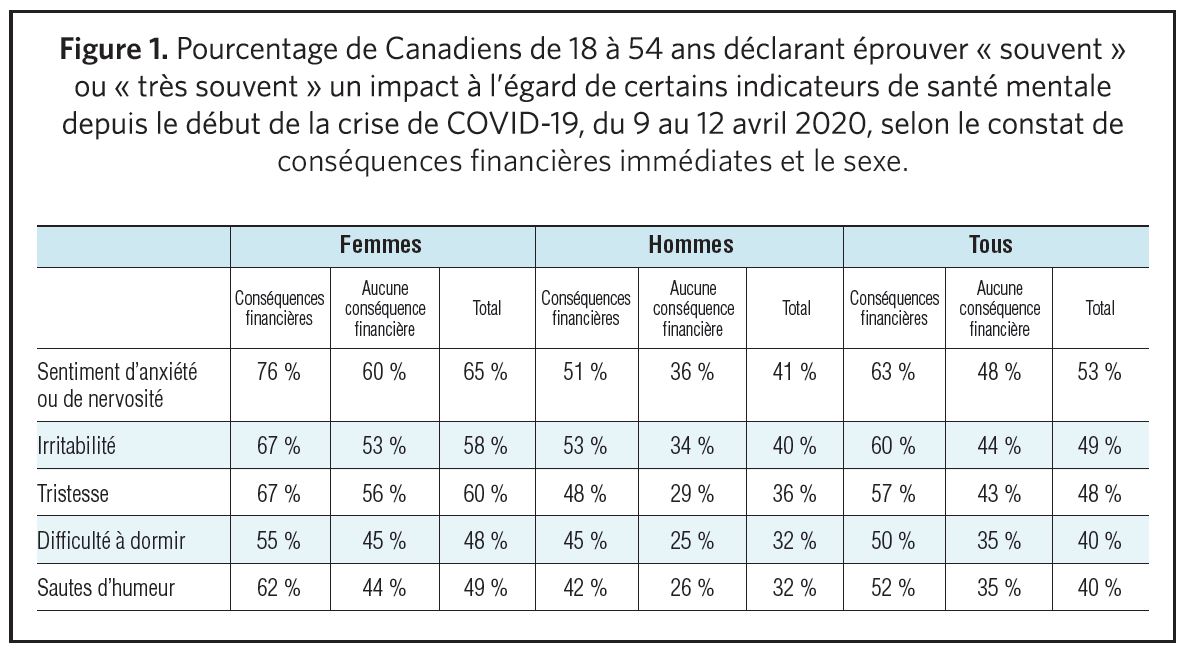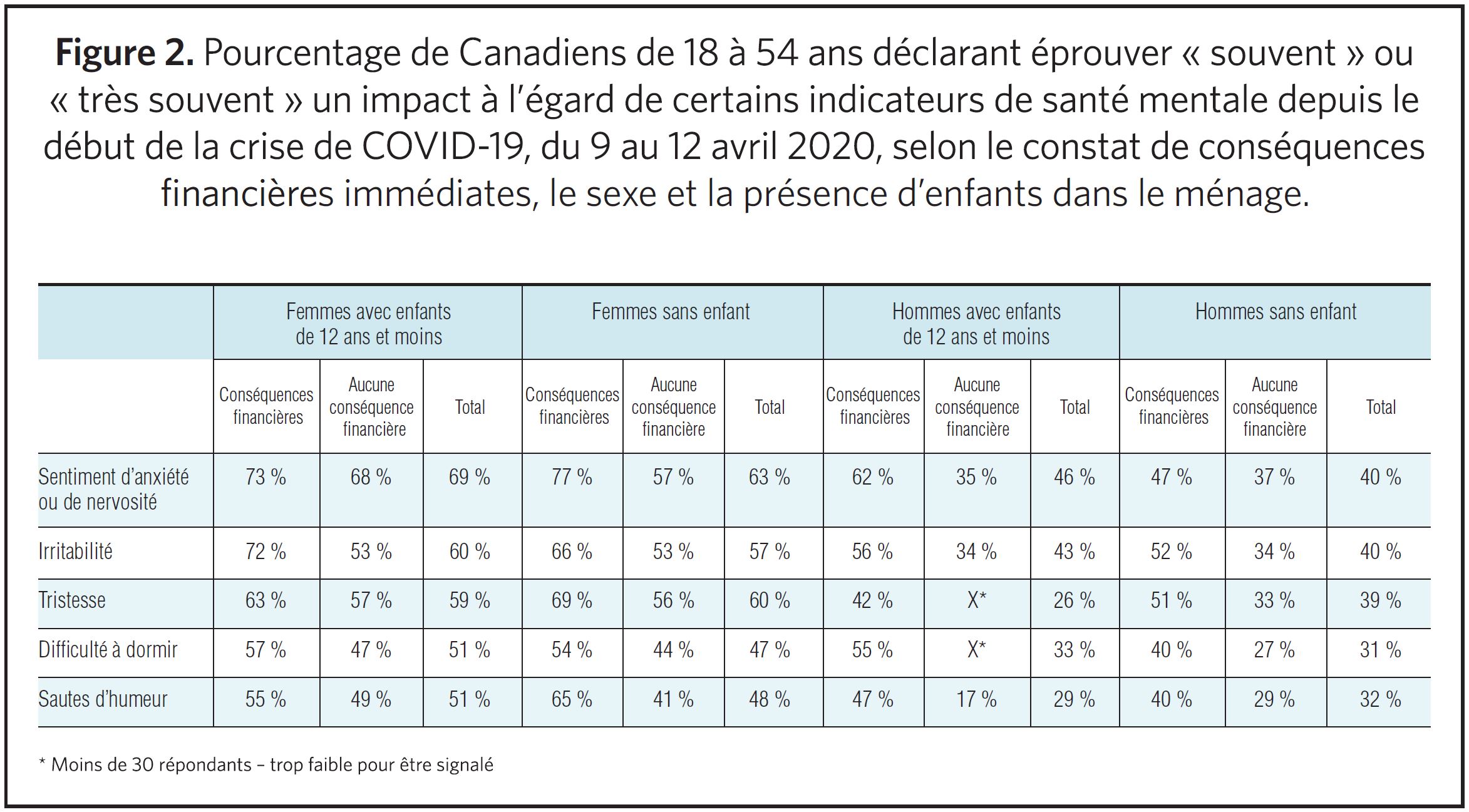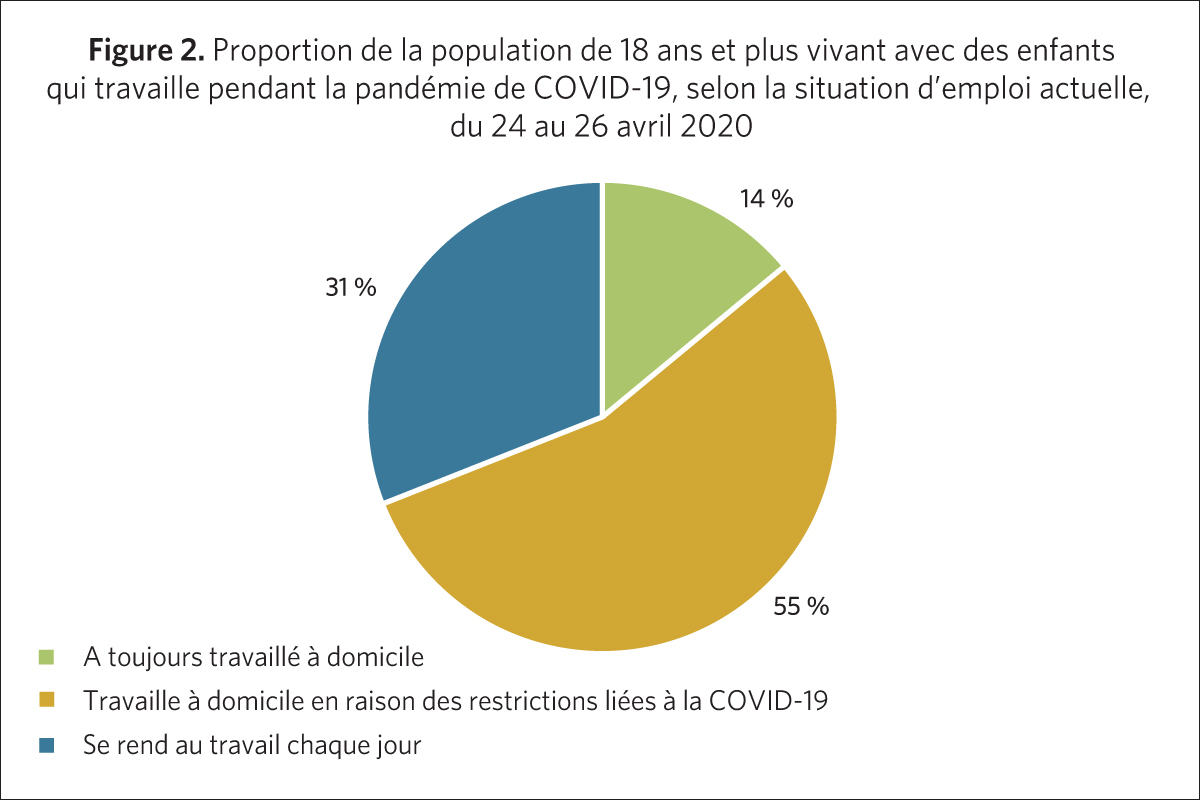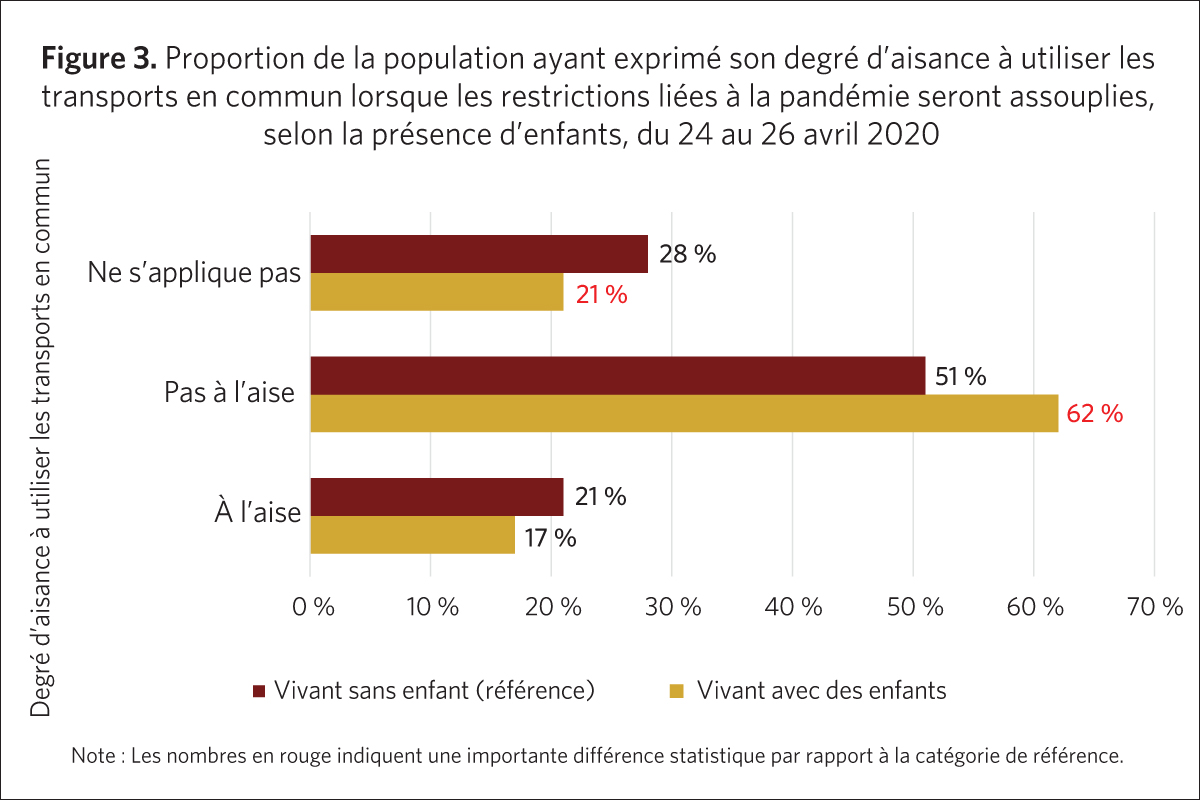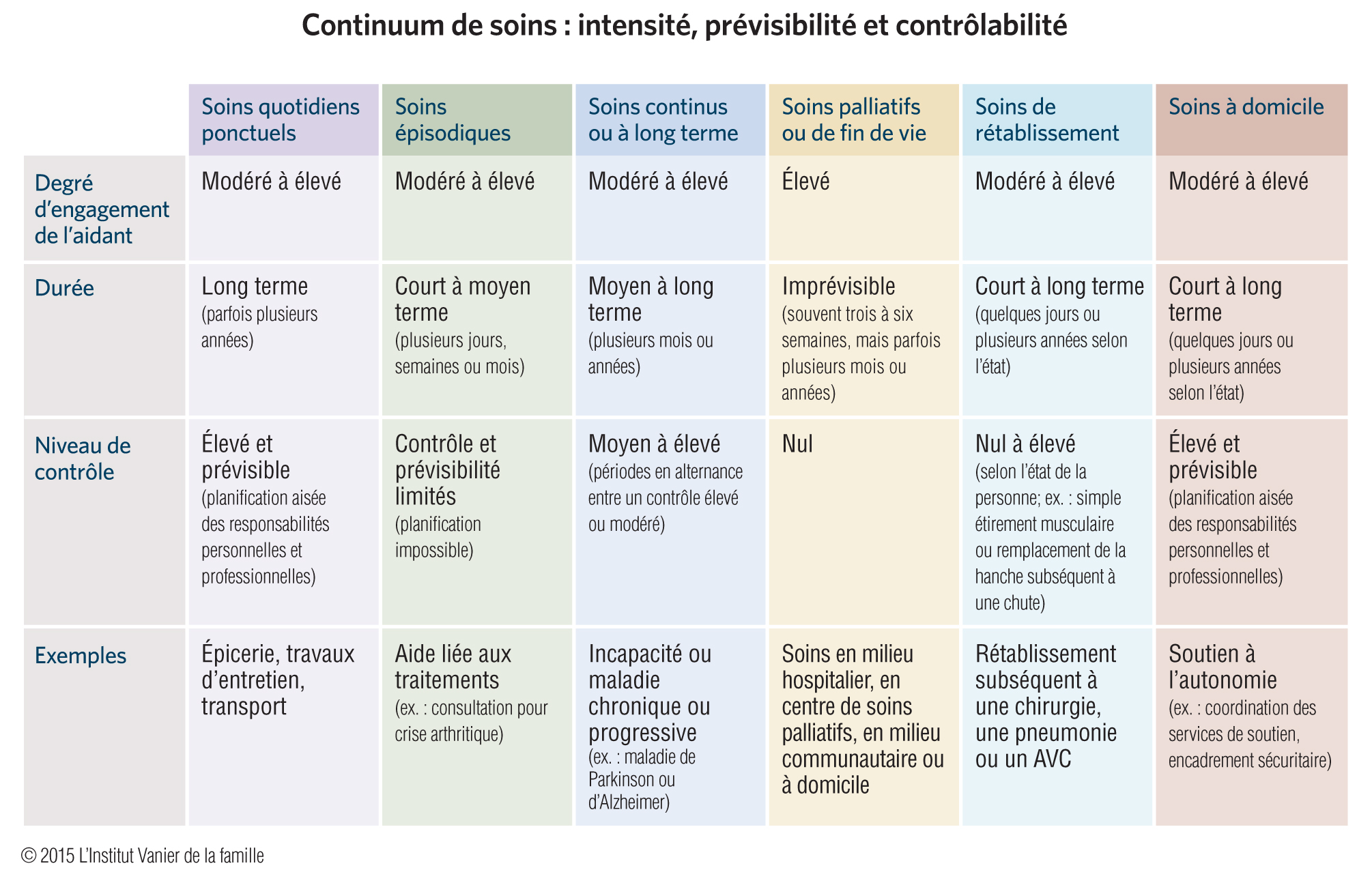John-Paul Boyd, M.A., LL.B.
Directeur général
Institut canadien de recherche sur le droit et la famille (Université de Calgary)
En juin 2016, l’Institut canadien de recherche sur le droit et la famille a commencé à s’intéresser aux diverses perceptions concernant la notion de polyamour au Canada. Le projet n’en est encore qu’à mi-parcours, mais les données colligées jusqu’ici pourraient avoir une incidence importante sur la législation et les politiques au cours des prochaines décennies, suivant l’évolution constante de la notion de famille.
Le terme polyamour est formé du préfixe grec poly (qui signifie « plusieurs » ou « en abondance ») et du mot d’origine latine amour. En accord avec cette étymologie, les polyamoureux vivent donc plusieurs relations intimes simultanées, ou manifestent une telle préférence. Certains polyamoureux sont engagés dans des relations amoureuses stables à long terme impliquant deux ou plusieurs autres partenaires, alors que d’autres entretiennent simultanément plusieurs relations plus ou moins durables ou engagées. Dans certains cas, les relations simultanées se vivent à court terme ou sur une base purement sexuelle, et parfois elles sont plus durables et se caractérisent par un engagement affectif plus marqué.
Polyamour
Pratique ou condition se caractérisant par la participation à plusieurs relations intimes simultanément, sans motivation religieuse ni obligation découlant du mariage.
Polygamie
Pratique ou condition se caractérisant par le fait d’avoir plusieurs époux ou épouses simultanément (habituellement des femmes), la plupart du temps pour des motifs religieux.
Polyamour et polygamie
Lorsqu’il est question de polyamour, on pense souvent à la série Sister Wives de TLC, ou encore à la communauté religieuse de Bountiful, en Colombie-Britannique. Cependant, il faut établir plusieurs distinctions entre le polyamour et la polygamie, que préconise notamment l’Église fondamentaliste de Jésus-Christ des saints des derniers jours (celle-ci étant d’ailleurs le point commun entre Sister Wives et Bountiful). En ce sens, la polygamie désigne les mariages entre un homme et plusieurs femmes (le suffixe d’origine grecque « gamie » signifie mariage), et cette union répond à une obligation nettement patriarcale dictée par les écritures.
A contrario, les polyamoureux que nous avons interrogés vivent des relations avec deux ou plusieurs autres adultes, mais affirment que l’égalité des partenaires occupe une place prépondérante, sans égard au genre ou à la situation parentale. Ils considèrent généralement que leurs partenaires devraient avoir leur mot à dire dans l’évolution des relations et que chacun est entièrement libre de mettre fin à son engagement à n’importe quel moment.
Statistique Canada ne collige pas de données sur le nombre de Canadiens polyamoureux ou engagés dans une relation polyamoureuse. Par ailleurs, dans le cadre de notre propre enquête sur le polyamour, annoncée principalement dans les médias sociaux, nous avons reçu 547 réponses valides en seulement trois semaines.1</ŝup> Plus des deux tiers des répondants (68 %) disent être actuellement engagés dans une relation polyamoureuse. Parmi les autres, les deux cinquièmes (39,9 %) affirment avoir vécu une telle relation au cours des cinq dernières années. Au moins huit répondants sur dix (82,4 %) pensent que le nombre de personnes se disant polyamoureuses tend à augmenter, et à peu près la même proportion de répondants (80,9 %) pensent qu’il y a aussi augmentation du nombre de relations ouvertement polyamoureuses.
Or, si le nombre de personnes engagées dans une relation polyamoureuse augmente effectivement, il faudra s’attendre à d’importantes répercussions sur le plan économique et légal, puisque la plupart des grandes institutions sociales au Canada sont fondées sur le principe de dualité des relations entre adultes.
Or, si le nombre de personnes engagées dans une relation polyamoureuse augmente effectivement, il faudra s’attendre à d’importantes répercussions sur le plan économique et légal, puisque la plupart des grandes institutions sociales au Canada sont fondées sur le principe de dualité des relations entre adultes. Ainsi, le Régime de pensions du Canada ne verse des allocations de survivant qu’à un seul conjoint, et la même situation s’applique relativement à l’allocation au conjoint du Programme de sécurité de la vieillesse. De même, dans ses formulaires de calcul des obligations fiscales, l’Agence du revenu du Canada prévoit que les contribuables puissent entretenir des relations successives, mais pas simultanées. Le même postulat ressort dans la législation provinciale sur le droit successoral et, la plupart du temps, dans les dispositions régissant les relations familiales.
Des polyamoureux plus jeunes et des relations plus diversifiées au Canada
La plupart des répondants à notre sondage proviennent de la Colombie-Britannique (144), suivis de ceux de l’Ontario (116), de l’Alberta (71) et du Québec (37). L’âge moyen des répondants est généralement inférieur à celui de la population canadienne. En effet, 75 % des répondants appartiennent au groupe des 25 à 44 ans (alors que cette tranche d’âge occupe 26 % de l’ensemble de la population), et seulement 16 % des répondants sont âgés de 45 ans et plus (comparativement à 44 % au sein de la population totale).
La majorité des répondants à notre sondage ont fait des études secondaires (96,7 %), et leur niveau de scolarité le plus élevé concerne des études de premier cycle universitaire (26,3 %), des études professionnelles ou de cycles supérieurs (19,2 %) ou des études collégiales (16,3 %). Les répondants présentent un niveau de scolarité largement supérieur à l’ensemble de la population canadienne. De fait, 37 % des répondants détiennent un diplôme de premier cycle universitaire (par rapport à 17 % pour l’ensemble de la population), et 19 % d’entre eux ont un diplôme d’études professionnelles ou de cycles supérieurs (comparativement à 8 % au sein de la population totale).

De même, dans le cadre de notre sondage, les répondants déclarent des revenus supérieurs au reste de la population canadienne. En effet, les revenus annuels inférieurs à 40 000 $ sont moins fréquents parmi nos répondants (46,8 %) qu’au sein de la population totale (60 %), et la proportion de répondants ayant un revenu annuel supérieur à 60 000 $ s’avère plus importante (31 %) que dans l’ensemble de la population (23 %). Même si presque la moitié des répondants ont un revenu annuel inférieur à 39 999 $, près des deux tiers des personnes interrogées (65,4 %) comptent aussi sur un autre soutien au sein du ménage, et plus des trois cinquièmes des répondants (62,3 %) vivent au sein d’un ménage où le revenu total annuel se situe entre 80 000 $ et 149 999 $.
Un peu moins du tiers des répondants se disent de genre masculin (30 %) et près des trois cinquièmes de genre féminin (59,7 %), les autres s’identifiant comme intergenres (3,5 %), de genre fluide (3,2 %), transgenres (1,3 %) ou « autres » (2,2 %). Quant à l’orientation sexuelle, un nombre important de répondants se définissent comme hétérosexuels (39,1 %) ou bisexuels (31 %).
La plupart des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage se disent soit athées (33,9 %) ou agnostiques (28,2 %). Parmi les répondants se réclamant d’appartenance confessionnelle, la plupart sont chrétiens (7,2 % sans confessionnalité particulière; 3,2 % catholiques; 1,3 % protestants). Enfin, plus d’un cinquième des répondants (22,1 %) s’identifient à une « autre » catégorie religieuse (notamment Quakers, païens et polythéistes).
Nous avons également tenu compte du type de relations et du mode de cohabitation de nos répondants. Près des deux tiers d’entre eux (64,6 %) affirment que leur relation implique trois personnes, 17,9 % disent faire partie d’une relation à quatre personnes, et 13,8 % vivent une relation impliquant six personnes ou plus. Par ailleurs, seulement un cinquième des répondants affirment que leur relation se vit au sein d’un seul et même ménage (19,7 %). Les autres vivent donc une relation répartie dans plusieurs ménages, c’est-à-dire surtout deux ménages (44,3 %) ou trois ménages (22,2 %).

S’agissant des répondants dont la relation se vit dans un seul ménage, les trois cinquièmes (61,2 %) attestent la présence d’un couple marié (mais jamais plus d’un seul couple). Parmi les répondants dont la relation est répartie dans plusieurs ménages, près de la moitié (45,4 %) rapportent la présence d’au moins un couple marié (un seul couple marié : 85 %; deux couples mariés : 12,9 %; trois couples mariés : 1,4 %; plus de trois couples mariés : 0,7 %).
Près du quart des personnes interrogées (23,2 %) affirment qu’au moins un enfant de moins de 19 ans vit à plein temps au sein du ménage sous la responsabilité d’au moins un parent ou tuteur, et 8,7 % des répondants déclarent qu’au moins un enfant vit à temps partiel au sein du ménage sous la responsabilité d’au moins un parent ou tuteur.

En résumé, les répondants à notre sondage étaient généralement plus jeunes et plus éduqués et affichaient un meilleur taux d’emploi que l’ensemble de la population canadienne. Deux fois plus de répondants s’identifiaient au genre féminin comparativement au genre masculin, et la répartition d’hétérosexuels et de bisexuels était similaire. Au moment de répondre au sondage, la plupart des répondants étaient engagés dans une relation polyamoureuse avec deux autres personnes. Toutefois, plusieurs répondants vivaient une relation avec trois autres personnes ou plus. Enfin, pour la majorité des répondants, ces relations se vivaient au sein de deux ménages ou plus.
Pour les polyamoureux interrogés, l’égalité est importante au sein de la relation et dans les décisions familiales
Notre sondage s’intéresse aussi à la manière dont les répondants perçoivent les relations polyamoureuses et les liens entre les personnes qui y sont engagées, ainsi qu’à leur opinion sur la perception du public à leur endroit.
Dans l’ensemble, les répondants sont particulièrement attachés au principe d’égalité des personnes engagées dans la relation, peu importe le genre ou le statut parental. Plus des quatre cinquièmes des répondants (82,1 %) sont « tout à fait d’accord » et 12,5 % sont « d’accord » avec l’énoncé selon lequel chacun des membres d’une relation polyamoureuse mérite d’être traité équitablement sans égard au genre ou à l’identité de genre. Plus de la moitié (52,9 %) sont « tout à fait d’accord » et 21,5 % sont « d’accord » avec l’assertion selon laquelle chacun des membres d’une relation polyamoureuse mérite d’être traité équitablement sans égard aux responsabilités en tant que parents ou tuteurs.
De même, une forte majorité des répondants conviennent que tous les membres d’une telle union devraient avoir leur mot à dire concernant l’évolution de la relation. Environ huit répondants sur dix (80,5 %) sont « tout à fait d’accord » ou « d’accord » pour dire que les décisions concernant la nature de la relation concernent équitablement chacun des membres d’une relation polyamoureuse. Par ailleurs, 70,3 % se disent « tout à fait d’accord » ou « d’accord » avec l’affirmation voulant que chacun des membres d’une relation polyamoureuse ait pleinement voix au chapitre concernant l’arrivée d’une nouvelle personne au sein de la relation. Plus des neuf dixièmes des répondants (92,9 %) sont « tout à fait d’accord » et 6,3 % sont « d’accord » pour dire que chacun des membres d’une relation polyamoureuse peut librement mettre fin à son engagement au sein de la relation à tout moment.
L’attachement manifesté par nos répondants vis-à-vis des principes d’égalité, d’autonomie et de participation des membres concorde avec une autre conclusion importante de notre étude : 89,2 % des répondants sont « tout à fait d’accord » et 9,2 % sont « d’accord » pour dire que chacun des membres d’une relation polyamoureuse doit faire preuve d’honnêteté et de franchise envers les autres.
En ce qui concerne la perception de l’opinion publique à l’égard du polyamour, il ne fait aucun doute que certaines émissions de télévision à succès (Sister Wives et My Five Wives du réseau TLC, ainsi que l’émission Big Love de HBO) ont contribué à brouiller les pistes en faisant un amalgame avec la notion de polygamie. La publicité entourant la récente poursuite en justice à l’endroit de certains leaders de la communauté de Bountiful en vertu de l’article 293 du Code criminel a aussi alimenté certaines perceptions. D’ailleurs, les répondants eux-mêmes semblent avoir été influencés par la teneur des articles 291 et 293 du Code criminel, qui interdisent respectivement la bigamie et la polygamie.
Ainsi, même si la majorité des répondants (72,6 %) croient que la tolérance du public s’améliore vis-à-vis du polyamour, plus des quatre cinquièmes d’entre eux (80,6 %) pensent que les gens considèrent les relations polyamoureuses comme une sorte de perversion ou de fétichisme. De même, seulement 16,7 % des répondants sont d’avis que les gens considèrent les relations polyamoureuses comme une structure familiale parfaitement légitime.
Familles polyamoureuses : des rapports uniques et complexes vis-à-vis de la loi
Les personnes engagées dans une relation à long terme au sein de familles polyamoureuses sont confrontées à plusieurs difficultés pour parvenir à assumer leurs responsabilités, surtout lorsqu’il faut traiter avec des personnes hors de la famille, solliciter des services gouvernementaux ou faire valoir leur statut légal. De fait, à peu près toutes les facettes de la vie au Canada posent des obstacles aux familles polyamoureuses – et particulièrement celles ayant des enfants :
- Qui sera reconnu comme parent ou tuteur aux yeux des autorités scolaires? Qui aura le droit de passer prendre les enfants à l’école? À qui reviendra-t-il d’autoriser les sorties scolaires ou de participer aux rencontres de parents avec l’enseignant?
- Qui sera désigné pour traiter avec les médecins, les dentistes, les conseillers ou les autres professionnels de la santé?
- Qui sera désigné comme bénéficiaire d’un régime d’assurance collective offert par un employeur? Qui sera couvert en vertu des régimes provinciaux de soins de santé (ex. : RAMO en Ontario, MSP en Colombie-Britannique)?
- Qui aura droit aux prestations des régimes publics, comme les allocations au conjoint du Programme de sécurité de la vieillesse, ou les allocations au survivant du Régime de pensions du Canada?
- Quels seront les droits et privilèges de chacun des adultes concernés dans le cadre provincial du droit successoral ou de la législation fédérale en matière d’immigration?
- Combien d’adultes pourront légalement réclamer le statut parental d’un enfant en vertu des lois régissant l’adoption ou la procréation assistée?
- Compte tenu des législations provinciales sur les relations domestiques, de quels droits et privilèges bénéficieront ceux et celles qui mettront fin à leur engagement au sein d’une famille polyamoureuse?
Pour trouver des réponses à plusieurs de ces questions, il faut s’en remettre à certaines définitions dans le libellé des lois, des politiques et des règlements, notamment celles de parent, époux ou tuteur, et celles de partenaire interdépendant adulte (en Alberta) ou conjoint de fait (dans la plupart des lois fédérales).
Les personnes engagées dans une relation à long terme au sein de familles polyamoureuses sont confrontées à plusieurs difficultés pour parvenir à assumer leurs responsabilités, surtout lorsqu’il faut traiter avec des personnes hors de la famille, solliciter des services gouvernementaux ou faire valoir leur statut légal.
Même si les écoles et les hôpitaux se basent généralement sur la véritable nature des relations entre les individus concernés plutôt que sur une définition normative de la notion de « parent », les organismes chargés d’administrer les programmes d’allocations s’en tiennent en revanche à une terminologie plus restrictive. Ainsi, certaines familles polyamoureuses en viennent à devoir déterminer quel adulte de leur famille sera désigné comme l’« époux » ou l’« épouse » de l’employé aux fins du régime de soins de santé et d’assurance-médicaments, les autres étant dès lors exclus de la couverture.
Toutefois, la question qui est sans doute la plus pressante concerne les droits et les obligations des individus en vertu des législations provinciales sur les relations domestiques. En effet, les difficultés qui surviennent lors de la rupture d’une relation polyamoureuse ne sont pas différentes de celles affectant un couple monogame. Selon les circonstances, il risque d’y avoir des désaccords lorsqu’un ou plusieurs membres d’une famille polyamoureuse décident de partir. Où les enfants vivront-ils? Comment se prendront les décisions parentales? Comment répartir la cohabitation des enfants de part et d’autre? Une pension alimentaire sera-t-elle exigée? Si oui, qui paiera la note? Faudra-t-il verser une pension de soutien au conjoint? Si oui, qui devra payer? Comment répartir les dettes et les actifs immobiliers? L’un des membres peut-il revendiquer un droit de propriété sur un bien détenu par les autres membres de la famille?
Les difficultés qui surviennent lors de la rupture d’une relation polyamoureuse ne sont pas différentes de celles affectant un couple monogame.
Dans les provinces régies par la common law, la législation a tendance à s’assouplir lorsqu’il est question des droits et des obligations envers les enfants, mais l’approche est souvent plus tranchée en ce qui concerne le partage des biens ou le soutien à verser à un conjoint.
L’intérêt prioritaire de l’enfant étant au cœur des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, les dispositions législatives des provinces canadiennes régies par la common law prévoient que les beaux-parents ou toute autre personne ayant un rôle parental auprès d’un enfant puissent se voir imposer le paiement d’une pension alimentaire, et ce, sans égard au fait qu’une autre personne y soit déjà contrainte. Par conséquent, on peut envisager que tous les membres d’une famille polyamoureuse pourraient être tenus d’assumer un tel soutien financier pour l’enfant d’un autre membre de la famille, surtout si l’enfant vivait principalement au sein du ménage polyamoureux.
Par ailleurs, un adulte à charge pourrait être admissible à des versements de soutien au conjoint de la part d’un autre membre d’une famille polyamoureuse :
a) si la personne est mariée à l’autre membre de la famille;
b) si, vis-à-vis de l’autre membre de la famille, la personne répond à la définition de partenaire interdépendant adulte (Alberta), de conjoint non marié (Colombie-Britannique, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, Saskatchewan), de partenaire (Terre-Neuve-et-Labrador) ou de conjoint de fait (Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse)2</ŝup> .
On peut aussi imaginer qu’un adulte à charge soit admissible à plusieurs versements de soutien au conjoint de la part des autres membres d’une famille polyamoureuse, si la législation n’exclut pas nommément les relations conjugales simultanées (comme en Alberta) ou si la personne répond à la définition de partenaire ou conjoint non marié vis-à-vis des autres membres (comme ce serait le cas en Colombie-Britannique).
Dans la plupart des provinces régies par la common law (sauf en Alberta et au Manitoba), les parents peuvent partager la garde d’un enfant et bénéficier de droits afférents, c’est-à-dire le droit de s’informer de l’enfant et de prendre des décisions à son égard, et ce, conjointement avec :
a) d’autres membres de la famille répondant à la définition légale de tuteur (Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse) ou de parent (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Ontario, Île-du-Prince-Édouard);
b) tout autre membre de la famille, lorsque la législation autorise la garde d’un enfant même sans lien biologique (Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, Saskatchewan).
En Colombie-Britannique ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador, lorsque l’enfant a été conçu par procréation assistée, la législation permet que d’autres personnes que les parents biologiques obtiennent la reconnaissance du statut parental.
À l’exception du Manitoba, toutes les provinces régies par la common law autorisent les parents à partager la garde de leur enfant avec un ou plusieurs autres membres de la famille (ainsi que les obligations inhérentes en tant que fiduciaires du patrimoine de l’enfant).
Dans les provinces régies par la common law (sauf en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan), les droits légaux concernant la propriété et la possession de biens se limitent aux conjoints mariés, si bien que les membres non mariés d’une famille polyamoureuse doivent s’en remettre :
a) aux dispositions générales régissant la copropriété de biens immobiliers ou personnels;
b) à tout autre principe d’équité ou de common law jugé pertinent compte tenu de la nature de la relation.
En Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan, les membres des familles polyamoureuses bénéficient de droits de propriété prévus par la loi en vertu des dispositions touchant les conjoints non mariés (Colombie-Britannique, Saskatchewan) ou les conjoints de fait (Manitoba). En effet, la législation dans ces provinces n’interdit pas explicitement les relations conjugales simultanées.
Perspectives…
Depuis le début de l’ère industrielle, on assiste à une évolution de plus en plus rapide du modèle pratiquement inaltéré durant plus d’un millénaire de la famille nucléaire occidentale traditionnelle – c’est-à-dire celui de parents mariés hétérosexuels et de leurs descendants légitimes. Et les conceptions ainsi que les structures légales qui l’encadrent évoluent à l’avenant. Les incapacités de droit qui touchaient les femmes mariées ont été les premières à tomber, entre autres le refus au droit de propriété ou l’impossibilité de détenir une entreprise en leur nom. D’autres incapacités légales ont ensuite été améliorées, notamment en ce qui concerne les liens de filiation, comme le droit d’hériter ou de faire valoir un titre paternel.
Promulguée en 1968 par le gouvernement fédéral, la Loi sur le divorce légitimait la cessation du mariage autrement que par décès au Canada. La génération des baby-boomers (dont les plus âgés ont atteint l’âge de 65 ans en 2011) a donc été la première à traverser l’âge adulte sous un régime fédéral où le divorce était autorisé. Non seulement cette transition a-t-elle largement dissipé les préjugés, mais elle a contribué à la progression continue du taux de remariage et de nouvelles unions durant les deux dernières décennies, ainsi qu’à l’augmentation du nombre de familles recomposées (qui semblent désormais aussi communes que les familles non reconstituées).
Vers le milieu des années 90, l’orientation sexuelle a finalement été admise comme motif de discrimination illicite. Dans le sillage de ce changement, l’Ontario a légalisé les mariages homosexuels dès 2002, et huit autres provinces et territoires lui ont rapidement emboîté le pas. Finalement, en 2005, le gouvernement fédéral adoptait la Loi sur le mariage civil qui légalisait le mariage entre conjoints de même sexe à l’échelle pancanadienne. Entre-temps, la Saskatchewan adoptait, en 2001, une législation conférant aux couples non mariés vivant ensemble les mêmes droits de propriété que les couples mariés, ce que le Manitoba a décidé d’imiter (en 2004), tout comme la Colombie-Britannique (en 2011).
Au Canada, la famille s’affranchit désormais de toute notion liée au mariage, au genre, à l’orientation sexuelle, à la reproduction ou à l’éducation des enfants. La prochaine étape consistera à revoir le précepte selon lequel toute relation affective se vit seulement entre deux personnes simultanément, qu’il s’agisse de relations informelles, de cohabitation ou de liens conjugaux.
À la lumière des données somme toute restreintes qui existent à l’heure actuelle au sujet des relations polyamoureuses, il est permis de croire que ce type de relations concerne aujourd’hui un nombre relativement important de personnes, et que la progression pourrait se poursuivre. Selon un article publié dans Newsweek en 2009, plus de 500 000 Américains vivraient au sein de relations ouvertement polyamoureuses et on compterait même environ « 15 000 lecteurs habituels » du magazine Loving More destiné aux polyamoureux. Dans son ouvrage intitulé Polyamory in the Twenty-First Century, l’auteure Deborah Anapol estime qu’environ un Américain sur cinq cents se désigne comme polyamoureux aux États-Unis. Le site Web de la Canadian Polyamory Advocacy Association (www.polyadvocacy.ca) dresse une liste d’autres organismes nationaux de soutien et de réseautage pour les polyamoureux, notamment 2 autres organismes nationaux ainsi que plusieurs organismes semblables à l’échelle régionale, soit 8 dans les Maritimes, 36 au Québec et en Ontario, 23 dans les Prairies et 22 en Colombie-Britannique.
Par le passé, nous avons su très bien accueillir la profonde transformation qu’a connue la famille. Pourquoi en serait-il autrement cette fois-ci?
L’augmentation du nombre de relations polyamoureuses exigera des changements importants touchant nos coutumes et nos institutions sociales. Une telle évolution nécessitera de revoir notre conception de la parentalité ainsi que le partage des responsabilités parentales. Il faudra réévaluer les frontières des relations entre adultes pour déterminer quelles obligations et quels privilèges s’appliquent ou non en vertu du cadre législatif, et définir leurs modalités d’application au sein d’une relation comptant plus de deux personnes.
Malgré l’ampleur des changements à envisager, ceux-ci se feront progressivement. Nous aurons le temps de nous faire à l’idée et de nous adapter à l’augmentation du nombre de personnes et de familles polyamoureuses. Par le passé, nous avons su très bien accueillir la profonde transformation qu’a connue la famille. Pourquoi en serait-il autrement cette fois-ci?
Notes
- Données de sondage non pondérées.
- Il est à noter que le Québec applique le Code civil plutôt que la common law, si bien que la législation québécoise se distingue des autres provinces canadiennes. Par conséquent, la situation québécoise déborde du cadre de la présente démarche.
John-Paul Boyd, M.A., LL.B., est directeur général de l’Institut canadien de recherche sur le droit et la famille, un organisme multidisciplinaire sans but lucratif affilié à l’Université de Calgary.
Pour en savoir davantage au sujet des travaux de John-Paul Boyd sur le droit de la famille et les relations polyamoureuses, consultez l’article « Polyamorous Families in Canada: Early Results of New Research from CRILF » publié par l’Institut canadien de recherche sur le droit et la famille.
Téléchargez cet article en format PDF.
Publié le 11 avril 2017