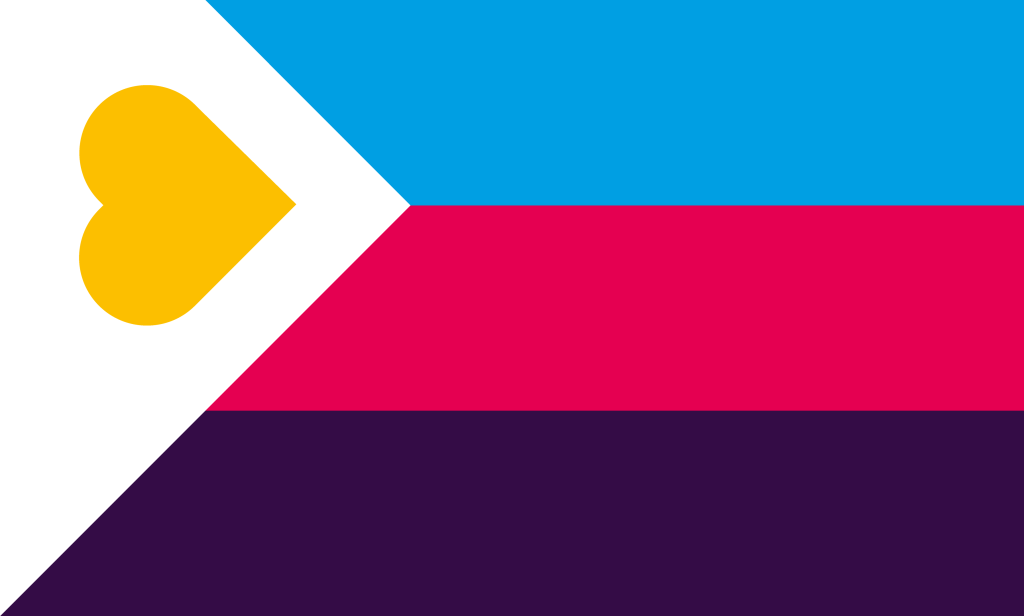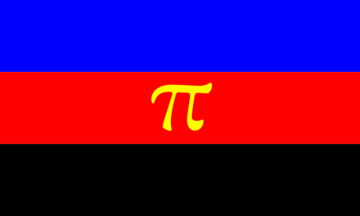Lorsque la première édition de La famille compte a vu le jour en 1994, les plus récentes données du recensement montraient qu’en 1991, le tiers (33,0 %) de la population du Canada âgée de 65 ans et plus était veuve1. En 2021, cette proportion a chuté à une personne sur cinq (20,0 %)2. Le nombre de personnes veuves est donc proportionnellement plus faible aujourd’hui qu’au début des années 1990, et ce, dans l’ensemble des groupes d’âge.
Divers facteurs ont contribué à une telle baisse ainsi qu’à la tendance vers un veuvage plus tardif. L’amélioration des soins de santé et les progrès médicaux soutenus par la science ont conduit à une augmentation de l’espérance de vie. La baisse des taux bruts de mortalité au fil des cinquante dernières années (c’est-à-dire le nombre de décès au cours d’une année donnée pour 100 000 habitants) a également réduit la probabilité qu’un conjoint ou une conjointe décède à un plus jeune âge3.
Au cours des 30 dernières années, c’est chez les femmes âgées que la probabilité de devenir veuves a le plus diminué. Cela s’explique par la réduction de l’écart entre les sexes en matière d’espérance de vie au cours des dernières décennies. Entre 1980-1982 et 2020-2022, l’espérance de vie à la naissance est passée de 79,1 ans à 83,8 ans chez les femmes, et de 72,0 ans à 79,3 ans chez les hommes4. Au cours de cette période, l’écart entre l’espérance de vie des femmes et des hommes est ainsi passé de 7,1 ans à 4,5 ans.
En 2021, 47,1 % des femmes âgées de 80 à 84 ans étaient veuves, comparativement à 16,6 % des hommes de la même tranche d’âge2. Ce n’est qu’à partir de 95 ans que la plupart des hommes deviennent veufs. De plus, si dans la majorité des mariages hétérosexuels, les hommes ont tendance à être plus âgés que les femmes, la différence d’âge moyenne entre les partenaires a diminué au cours des dernières décennies5. Cela a contribué à la diminution du pourcentage de personnes veuves, particulièrement chez les femmes.
Le déclin des taux de nuptialité y a également contribué. Le terme « veuf » ou « veuve » désigne les personnes légalement mariées dont le conjoint ou la conjointe n’est plus et qui ne se sont pas remariées. Les familles en union libre ne sont donc pas incluses dans les statistiques sur le veuvage, les partenaires ne s’étant jamais légalement mariés.
Pourquoi s’en préoccuper?
Outre le chagrin, la tristesse et le sentiment de solitude, le veuvage peut avoir des conséquences majeures pour les conjoints endeuillés et leur famille. Le veuvage entraîne des répercussions économiques, car il génère souvent des dépenses supplémentaires liées aux services funéraires et aux changements entourant le mode de vie. La perte d’un conjoint ou d’une conjointe signifie généralement aussi la perte d’une source de revenus familiaux, en particulier pour les personnes âgées dont les possibilités d’emploi s’avèrent limitées et/ou qui comptaient sur les revenus ou les prestations de retraite de leur partenaire. Pour les plus jeunes familles, il peut s’avérer difficile de combiner les responsabilités professionnelles et personnelles, tout en devant composer avec des changements dans la dynamique familiale pendant une période difficile.
Diverses initiatives et divers programmes ont été mis en place en vue de soutenir le bien-être économique des personnes veuves, notamment des prestations de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Sécurité de la vieillesse (SV). Ces programmes ont contribué à améliorer le niveau de vie des personnes âgées qui sont veuves. Les études montrent que le divorce a par ailleurs une incidence plus importante sur le niveau de vie à la retraite, comparativement au décès du conjoint ou de la conjointe6.
Source : Statistique Canada. (29 mars 2023). État matrimonial, groupe d’âge et genre : Canada, provinces et territoires et régions économiques2.
Sources : Statistique Canada. (1992). Population selon le groupe d’âge et le sexe, par état matrimonial – Canada, provinces et territoires, circonscriptions électorales fédérales et secteurs de dénombrement1.
Statistique Canada. (29 mars 2023). État matrimonial, groupe d’âge et genre : Canada, provinces et territoires et régions économiques2.
Références
- Statistique Canada. (1992). Tableau E9102 Population selon le groupe d’âge et le sexe, par état matrimonial – Canada, provinces et territoires, circonscriptions électorales fédérales et secteurs de dénombrement. https://www12.statcan.gc.ca/francais/census91/data/tables/Rp-fra.cfm?LANG=F&APATH=3&DETAIL=1&DIM=0&FL=A&FREE=1&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=86&PRID=0&PTYPE=4&S=0&SHOWALL=No&SUB=0&Temporal=1991&THEME=101&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF ↩︎
- Statistique Canada. (29 mars 2023). Tableau 98-10-0132-01 État matrimonial, groupe d’âge et genre : Canada, provinces et territoires et régions économiques. https://doi.org/10.25318/9810013201-fra ↩︎
- Decady, Y., et Greenberg, L. (Juillet 2014). Quatre-vingt-dix ans de changements dans l’espérance de vie. Coup d’œil sur la santé. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-624-x/2014001/article/14009-fra.htm ↩︎
- Statistique Canada. (27 novembre 2023). Tableau 13-10-0114-01 Espérance de vie et autres éléments de la table complète de mortalité, estimations sur trois ans, Canada, toutes les provinces sauf l’Île-du-Prince-Édouard. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310011401&request_locale=fr ↩︎
- Milan, A., Wong, I., et Vézina, M. (24 février 2014). Nouvelles tendances dans le mode de vie et la conjugalité des personnes âgées d’aujourd’hui et de demain. Regards sur la société canadienne. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006- x/2014001/article/11904-fra.htm ↩︎
- Mehdi, T. (8 mai 2023). Une comparaison entre cohortes des répercussions économiques du divorce et du veuvage sur les personnes âgées. Rapports économiques et sociaux. https://doi.org/10.25318/36280001202300400003-fra ↩︎

La famille compte 2024 est une publication de l’Institut Vanier de la famille présentant des informations précises et actuelles sur les familles et la vie de famille au Canada. Rédigée dans un langage clair, elle est composée de chapitres sur un éventail de sujets et tendances qui ont une incidence sur la vie familiale au pays. Ses quatre sections (la structure, le travail, l’identité et le bien-être des familles) trouvent appui sur le Cadre sur la diversité et le bien-être des familles.
L’Institut Vanier de la famille
94, promenade Centrepointe
Ottawa (Ontario) K2G 6B1
info@institutvanier.ca
www.institutvanier.ca

Cette publication est autorisée par Creative Commons – Attribution de licence – Pas d’utilisation commerciale 4.0 International.
Comment citer ce document :
Battams, N., et Mathieu, S. (2024). La proportion de personnes âgées veuves a chuté. Dans La famille compte 2024, L’Institut Vanier de la famille. https://institutvanier.ca/la-famille-compte-2024/la-proportion-de-personnes-agees-veuves-a-chute